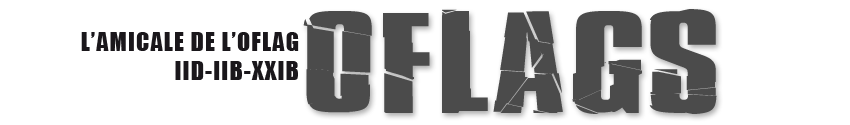Témoignage de Monsieur Antony BROCARD
sous-lieutenant vétérinaire au 89ème régiment d'artillerie divisionnaire hippomobile
Ces RAD eurent leurs heures de gloire pendant la guerre de 1914. Très mobiles mais assez vulnérables, ils avaient eu leur raison d’être en Flandre plus particulièrement où les tanks s’enlisaient dans les canaux et marais alors que les chevaux passaient avec leur canon de 75. Je logeais bien tranquille au château de Coquelle au pont de Leffrinkouque (propriété des chicorées Coquelle du Nord). En somme : ma drôle de guerre. Ce matin du 10 mai, réveillé tôt après une nuit agitée pleine de vrombissements anormaux d’avions et de sirènes d’alarme, je me rendis vite compte que tout était changé. Le jour même notre régiment, "fleur au fusil" pénétrait en Belgique, direction Breskens, passage de l’Escaut, entrée en Hollande à lite de Flessingue où les premiers obus nous firent instinctivement coucher sous les tables ! Premier contact avec la "vraie" guerre. L’intervention française en Hollande avait pour but de soutenir la petite armée alliée vite anéantie hélas, et notre régiment, touché lui aussi, dut se replier rapidement sur ses positions de départ. C’est terrible une retraite mêlant les soldats aux réfugiés terrifiés qui fuyaient les zones de combat. Quelle pagaille ! Enfin retour à Dunkerque après quelques jours de "week-end à Zuydcoote" dans les dunes de Malo-Les-Bains. On récupère quelques canons et tout s’organise pour la défense de Dunkerque, choisi comme port de réembarquement du corps expéditionnaire anglais. La poche de Dunkerque, réceptacle de toute une partie de l’armée alliée, se rétrécissait de jour en jour sous d’énormes bombardements. On a parlé de "l’enfer de Dunkerque" : des morts partout, des blessés et cela dura du 10 mai au 4 juin. A peine un mois, mais que ce fut long ! Puis la chute et la reddition. 40.000 prisonniers sur la plage, mais sauvetage d’une grande partie du corps expéditionnaire anglais et d’une partie importante du contingent français qui furent réembarqués dans des conditions effroyables (bateaux coulés, chavirés). Le souvenir de ma dernière nuit de liberté, du 3 au 4 juin 1940, me revient souvent en mémoire. J’étais à St Pol-sur-mer à quelques kilomètres au sud de Dunkerque. Nous tirions nos derniers obus sur les troupes allemandes dont l’avance inexorable était signalée par les fusées éclairantes qui se rapprochaient de plus en plus, un ciel de plus en plus sombre, masqué par les fumées noires des explosions de dépôts de carburant de St Pol, une odeur suffocante, les bombardiers Stukas déversant en vagues continues leurs étranges et terrifiants chargements, une bombe à droite, une bombe à gauche. Acculés à la mer sur la plage, nous attendions la marée montante pour, enfin à notre tour, essayer de gagner l’Angleterre à la rame sur une sorte de baleinière de fortune que nous avions récupérée. Enfin, 11 heures du soir, les fusées éclairantes à quelques centaines de mètres et l’eau enfin sous notre frêle embarcation ! Nous étions 13, je me souviens ! Quelle croisière de rêve !! Et quelle désillusion ! Toute la journée du 4 juin nous avons ramé à quelques encablures devant le port de Dunkerque, chacun à notre tour. Nous avons même essuyé un tir d’obus de moyen calibre. Un bateau anglais à moteur de plus fort tonnage fut notre dernier espoir : passant tout près de nous, il refusa de nous prendre à bord ! Désillusion. Plus on ramait, plus on remontait le long de la côte en direction du Nord. De forts courants, que nous ignorions bien sûr, nous ramenaient sur la côte française. A quelques centaines de mètres et près du sanatorium de Zuydcoote en bord de mer, une vague plus forte que les autres remplit notre chaloupe qui chavira et c’est déshabillés, trempés, sans chaussures... .mais sains et saufs que les 13 naufragés ayant rejoint la plage en barbotant se rendirent à une patrouille Feldgrau qui, surprise, immortalisa avec une caméra notre triste aventure ! Sur la plage beaucoup de cadavres (surtout des Tommies anglais) rejetés par la mer. Je récupérais quelques habits dont mon képi et ma vareuse à caducée, une paire de chaussures à ma pointure ?! Et je fus dépossédé brutalement par un adversaire plus méchant d’un porte-documents en cuir que j’aimais bien : hélas ! Prise de guerre. Mais, comme je parlais un peu allemand, par faveur il me rendit la paire de chaussettes qui était à l’intérieur Et ce fut la captivité. Le départ de Zuydcoote, notre marche à pied par étapes en direction d’Anvers se fit sur la caserne de l’Ecole militaire belge de St Nicolas (St Nicklas). Le voyage dura une quinzaine de jours : une sentinelle à l’avant, deux de chaque côté et une à l’arrière. Pas grand chose à manger. De temps en temps une boule de pain pour 6. Dans les villages belges traversés, de bonnes âmes nous donnaient quelques neufs, j’ai mangé des carottes dans les champs, de la verdure La vraie vie de Bohème "agrémentée" de coup de pied "au cul" pour nous faire marcher plus vite. Ah ! Les ampoules aux pieds à cause des chaussures mal ajustées ! ! Les soirs nous étions parqués dans des enclos de fortune (cimetières clos de mur, vieilles granges, usines, dépôts). Heureusement c’était en juin. Il y avait le soleil et les champs de tulipes en fleurs un peu partout. A Pervisze, je réussis à envoyer à ma maman une carte de la Croix Rouge (qu’elle a reçue et que j’ai toujours) lui annonçant que j’étais vivant mais prisonnier. Un soir, nous dormions dans un cimetière, mon voisin me dit : "J’en ai marre, je fous le camps." Fatigués, nous ne réagissions plus. Au matin, sa place était vide. J’ai regretté par la suite de ne pas l’avoir suivi. Mais les Allemands nous disaient tout le temps : "Ca sera vite fini, dans quelques jours, et vous rentrerez chez vous" Pour beaucoup, ça a duré cinq ans. Cette triste "randonnée", interrompue deux jours dans une usine désaffectée de Gand pour nous reposer un peu, fut suivie d’un voyage en train : par wagons à bestiaux fermés à travers toute l’Allemagne, au-delà de l’Oder, pour nous amener au camp définitif "Oflag II D" (Gross Born) fin juin. Quel voyage ! Wagons surchauffés, surpeuplés, sous-alimentés, sous abreuvés, attentes des heures entières sur des voies de garage encombrées de transports de troupes. Ne parlons pas du sanitaire ! De la promiscuité. Presque aussi sales que des cochons, pas de linge pour se changer, jamais déshabillés ! Et que dire de notre séjour au vélodrome de Dortmund où nous sommes restés "parqués" près de 10.000 hommes pendant trois jours. La "tourista" n’épargnait personne. Imaginez (peut-on dire) les "toilettes de campagne" : un énorme trou comblé tous les jours et réouvert le lendemain ! Quelques mètres plus loin. Le 25 juin, la France déposait les armes et, sous les regards hostiles des Berlinois, notre troupeau, toujours encadré de "Poster", traversait la ville en direction d’une gare de l’est de la capitale pour la dernière étape du voyage. Humiliés, abandonnés, le ventre et la tête vides, nous marchions comme des bêtes ou des zombies. Quelques jours plus tard, nous arrivions au camp terminal apparemment mieux organisé, près de la frontière polonaise, non loin de Schneid Mühl : Oflag II D (Gross Born) : trois blocks séparés, occupés chacun par près de 1.500 officiers. Morne plaine, noire, sablonneuse avec des forêts de résineux, des étangs et au loin un triste village, Redritz. (Il y a des noms que je n’oublierais jamais. Il y a deux ans, j’ai eu envie de revoir ces lieux où ne subsiste actuellement qu’une plaque commémorative. Le vieux cimetière a disparu : on mourrait beaucoup là-bas.) Arrivés au camp, il y eut le recensement, l’attribution d’un numéro de matricule attaché sur le ventre avec photo, j’avais le 4.022 (vierzig zwei und zwanzig), la restitution des "trésors" que nous avions pu conserver (j’ai pu sauver, cousus dans ma pèlerine kaki, trois vieux billets de 100 francs, rescapés de tous les "épouillages" obligatoires et fouilles diverses). Nous étions répartis dans des baraques en planches sans aucun confort, 27 par pièce, des châlits de trois (superposés) à même la planche répartis tout autour de la pièce : trois châlits de trois sur trois côtés, ce qui réduisait beaucoup la pièce garnie d’une table au milieu. Quelques bancs (pas assez), un poêle à bois alimenté l’hiver par les corvées de bois (dessouchage exceptionnellement autorisé sous haute surveillance hors du camp, on a même brûlé des planches des châlits par grand froid), une ampoule électrique toute pâlotte suspendue au milieu. De toute cette vie, je garde le souvenir d’une grande détresse. J’avais l’impression que je vivais là sans espoir. Le 17 juillet 1940, j’avais 24 ans ! ! ... c’est tout dire ... et j’étais pour combien de temps ! ! ! ... Question lancinante. "Vous qui entrez ici, perdez toute espérance". Cette phrase me hantait. Un pasteur allemand compréhensif ne nous avait-il pas souhaité pour le nouvel an "une année pleine de Dieu et vide de vous-même". Conscients de notre dépersonnalisation, notre vie, coupé de distribution de soupe de rutabagas et de pain "caca" partagé au milligramme près sur lequel on étendait une couche très mince de graisse ou plutôt d’ersatz de graisse, s’écoulait lentement et tristement. Heureusement, il y avait les copains. Nous étions quatre très unis. J’ai connu la belle camaraderie des gens malheureux ! ! Le partage du "rien du tout", les confidences au cours des promenades à deux (infra-barbelés), deux ou trois fois le tour du camp dont on reconnaît tous les cailloux mais où la pensée s’évade. En Oflag, on ne travaillait pas étant officier. Cette inaction était la pire des choses. Au bout d’un certain temps, on s’organise entre prisonniers : il y eut une université des camps. Les professeurs s’investirent, organisèrent des cours, on passa des examens dont les diplômes furent reconnus après la fin de la guerre. La vie fut la plus forte. Nous restions longtemps couchés dans nos châlits. Echecs, jeux de cartes, lectures et même théâtre ( j’ai joué dans "Le procès de Mary Dugan") furent notre consolation. Avec la radio clandestine nous avions des nouvelles et l’espoir renaissait. Il y eut des tentatives d’évasion, bien peu réussirent. Ce serait un autre chapitre. Faisant partie du service de santé en tant que vétérinaire, je fus rapatrié à ce titre en juillet 41. Retour en train qui dura une huitaine de jours avec plusieurs arrêts dans des camps intermédiaires. Enfin libre ! En ce début de période estivale, Hitler, grisé et fou d’orgueil, envahit la Russie, pensant en finir très vite, mais comme Napoléon avait eu sa Bérézina, il eut Stalingrad. Je pense que Hitler, trompé par son entrée rapide en Russie, a voulu faire preuve de mansuétude en libérant plus de prisonniers français, mais sa victoire fut de courte durée. J’ai donc profité d’une accalmie dans l’horreur en ce mois de juillet 41, euphorique pour lui et pour moi. Médaille Flandres Dunkerque 40 Charlieu, mars 2004 Antony BROCARD |