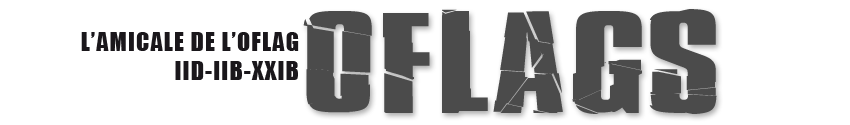Je suis d’accord avec eux :
I°) Que la situation des camps de concentration était bien pire que celle des camps de prisonniers, jusqu’à être cruelle et déshumanisante. Le Docteur Giroux, de Troyes, qui avait été à Dachau, ne voulait même pas parler de tout ce qu’il avait subi, tellement il était « dégoûté de l’homme », capable de faire tant souffrir d’autres hommes.
2°) Que ce n’est pas une raison de méconnaître ce que fut l’expérience de tous ceux qui ont vécu la situation des camps de prisonniers de guerre (P.G.). C’est une expérience très forte, bien que, comme vous dites, moins dure et beaucoup moins déshumanisante. Vous n’oubliez pas qu’elle a marqué la vie de 1.600.000 français. C’est une page importante de notre histoire de France, et qui s’est répercutée après la libération jusqu’à aujourd’hui par leur présence efficace « je peux en témoigner », quoique discrète, un peu partout dans la société française.
J’ai le droit d’affirmer cela, parce que je fais partie du bureau départemental de l’association des ACPG-CATM ( anciens combattants prisonniers de guerre - et combattants d’Algérie- Tunisie- Maroc ) où j’ai été heureux de travailler avec notre très regretté Bernard Pieds. Notre président actuel est Serge Auffredou, qui a pris contact avec vous à ce sujet.
Beaucoup de nos camarades plus jeunes, combattants d’Algérie - Tunisie - Maroc (C.A.T.M.) ont aimé s’unir à cette association, fondée en 1945, aimant partager son esprit d’ouverture et d’unité.
Cela dit, c’est qu’il y a lieu d’affirmer aussi, qu’il ne faut pas prendre pour une gloire d’avoir été prisonnier. On peut dire seulement qu’on a payé, chacun à sa place, la honte d’un pays, qui a essuyé une des défaites les plus désastreuses de son histoire, que fut celle de 39-45. Ce qui ne veut pas dire qu’on n’a pas fait son devoir au combat. Ce qui est humiliant, c’est d’être suspecté à tort. J’aime garder à ma boutonnière le ruban de ma croix de guerre pour protester au nom de mes camarades prisonniers contre l’injure qui nous est faite parfois de « chevaliers de la crosse en l’air ».
Ce qui est un honneur, c’est (après avoir fait tout son devoir à la guerre) d’avoir continué en captivité (qui est une guerre continuée autrement), de mobiliser toutes nos énergies, avec les camarades, pour rester pleinement hommes, et même fortifiés par l’épreuve, en pensant aux siens et à son pays, afin d’être prêts, au retour, à travailler pour la paix, avec tous les hommes, c’est à dire contre toutes les guerres.
Je pense à cette parole de la jeune philosophe Simone Weil, morte en 1943, dans son livre « La pesanteur et la grâce » : « Ce n’est pas le chemin qui est difficile, c’est le difficile qui est chemin ».
On a pu éprouver, sans désespérer, les ressources insoupçonnées du cœur humain.
( L’homme passe infiniment l’homme », disait Pascal ). On a pu réaliser ensemble, que la vraie camaraderie survit et même grandit dans les épreuves portées ensemble.
Quand on a vu, les uns et les autres, des camarades tués autour de soi, et qu’on est encore en vie, on est vacciné contre tout ce qui est mesquin dans l’existence. On a pu expérimenter, qu’il est rare entre français que les heures très difficiles à traverser, (alors qu’on aurait plutôt envie de pleurer), ne se concluent pas par un éclat de rire, déclenché par un camarade qui fait le clown, après quoi on retrousse ses manches, pour que tout aille un peu mieux.
A travers tout cela, on apprend à vivre la condition humaine, non pas dans la facilité, mais dans un chemin difficile.
Je lisais l’an dernier dans les journaux, cette parole de Fabrice Fleuriaux, qui a été, pendant 9 mois, comme journaliste, otage en Tchétchénie : « J’ai beaucoup plus appris la vie que la guerre », disait-il. J’aimerais montrer aussi dans ce témoignage, comment nous avons surtout appris à VIVRE, dans cet événement ( guerre et captivité ).
___________________________________________________________
Voici mon cheminement pour entrer dans le vif du sujet, pour qu’on puisse mieux s’y retrouver.
D’abord un mot rapide sur l’auteur que je suis. Ce qui aide à comprendre certains passages. J’avais de 25 ans à 31 ans, quand j’ai vécu ces événements. J’en ai parlé à l’occasion.
On m’a souvent demandé d’écrire ces souvenirs.
Je vais donc m’y mettre comme ça me vient à l’esprit. Ce n’est pas une oeuvre littéraire.
Ce sont simplement des réalités vécues. J’ai cette année 86 ans.
Mais ma mémoire n’a pas oublié.
Ma profession : prêtre depuis 1938. Un an professeur de 6ème. Mobilisé en août 1939, comme sous-lieutenant au 134° régiment d’infanterie.
Démobilisé en avril 1945, après un an de guerre, et 5 ans de captivité.
PANORAMA des sujets traités
1 - LA GUERRE
2 - LA DEBACLE
3 - JUIN 40, DEPART DES P.G. EN ALLEMAGNE
4 - LA VIE EN OFFLAG
5 - ETAT DES LIEUX. AMBIANCE DE GUERRE
6 - SOUCI CONSTANT DE S’EVADER
7 - VIVRE AU CAMP
8 - ORGANISER SON TEMPS
9 - LA LIBERATION PAR LES AMERICAINS le 6 Avril 1945
10 - LES RETROUVAILLES EN FAMILLE
11 - LE REEMBRAYAGE DANS LA VIE NORMALE
12 - REGARD SUR CE TEMOIGNAGE DANS NOTRE MONDE EN 2001
13 - « MESSAGE AU MONDE » des P.G.
_________________________________________________________________________
1 - LA GUERRE
LA DROLE DE GUERRE
D’octobre à fin novembre, temps de la drôle de guerre, au nord de Bitche en Alsace, au sud de DEUX PONTS en Sarre, avec seulement quelques escarmouches avec les allemands. Nous étions en première ligne. Mais on ne savait au juste où était l’ennemi, ni les villages où il était installé. Nous occupions une ligne précise, fixée par notre Etat-Major. Nous étions dans les bois, en bordure des chemins. On pouvait s’attendre à tout. La nuit, nous étions en éveil et en surveillance, et nous recevions parfois un ordre pour faire une patrouille chez l’ennemi.
Je reçois un ordre du colonel pour que ma section fasse une patrouille chez l’ennemi, avec un itinéraire précis, et mission de ramener des prisonniers. Ce n’est pas simple une patrouille la nuit, fixer les points de passage, s’entendre sur le mot de passe, avertir nos sentinelles, pour qu’il n’y ait pas de confusion (c’est ainsi, par erreur, que l’Abbé Jacquot, directeur du Foyer de St Martin, a été tué à cette date). J’ai pris la direction de la patrouille. Je me souviens qu’il faisait clair de lune. Les ombres des arbres, dans le bois, se projetaient dangereusement. Parfois on se planquait, entendant un bruit suspect. Finalement, tout s’est bien passé. Notre itinéraire a été à peu près suivi. Pas d’accroc, mais pas de prisonniers non plus (faire des prisonniers, c’est facile à dire. Mais... à faire, c’est autre chose !). Je fais un compte-rendu au colonel. Mission accomplie... Jusque là, tout allait bien. Mais le lendemain, nouvel ordre du colonel pour faire une autre patrouille par un autre itinéraire, avec mission toujours de ramener des prisonniers. On sentait l’insistance du commandement pour réaliser le contact avec les allemands. J’en appelle à mon sous-officier adjoint, qui s’appelait Thibaudin, en lui communiquant l’ordre du colonel, avec l’itinéraire, et le soin de préciser ensemble les modalités de l’exécution. J’ai compris qu’il réalisait durement le risque qu’il allait courir ( on sent vraiment dans ces moments-là ce que c’est que la guerre )... Il blêmit et me dit simplement, mais avec émotion: « Oh! ma femme et ma petite fille que je ne reverrai peut-être plus jamais ! ». Je me rappelle ce moment-là comme si c’était aujourd’hui. Je n’avais pas de femme et de petite fille. La vraie camaraderie selon l’évangile, n’est-ce pas aimer jusqu’à risquer sa peau. Alors j’ai fait la patrouille et je suis revenu. C’était mon vrai commencement de la guerre comme croyant, et cela m’est resté dans l’esprit.
Nous sommes restés en occupation sans gros problèmes durant les mois d’hiver, puis nous avons été en réserve dans la région de Noyon, en vue d’être rapidement transportés en Belgique en cas d’attaque allemande. Nous faisions partie de la 15° division motorisée, toujours en alerte.
Mes relations avec mes quarante hommes avaient toujours été sympathiques, dans des situations de guerre encore calmes, où nous avions simplement compris que, quoiqu’il arrive, nous pouvions compter les uns sur les autres.
Un fait m’est resté en mémoire. Un jour, un de mes chefs de groupe qui s’appelait Rouby, un gars de Dordogne, un instituteur intelligent, qui se disait incroyant, avec qui il était intéressant de discuter, rassemble toute la section dans une écurie, me fait un petit compliment ( car c’était le jour de ma fête ), m’offrant, au nom de tous, un crucifix, « symbole, disait-il, de l’amitié et de la souffrance ». J’en ai été très impressionné, ne m'attendant pas à cela.
L’ATTAQUE ALLEMANDE EN BELGIQUE
Peu de temps après, le 8 mai, départ de tous en vitesse, en cars, pour la Belgique, où les chars allemands avaient réussi une percée inquiétante contre l’armée belge.
Nous avons participé à la bataille de Gembloux, les 13, 14, et 15 mai.
Nous voici au nord de Gembloux. Notre compagnie doit défendre une ligne de terrain contre une attaque de chars allemands à prévoir. Notre centre, je me rappelle était la ferme de LIROUX, où tous les habitants se sont empressés de déguerpir au plus vite, par tous les moyens. A la tombée de la nuit, le chef de bataillon vient me voir. Il faut s’attendre à une attaque le lendemain. Nous n’avions que 2 canons de 25 anti-chars, en plus de notre armement habituel, nos grenades et nos fusils-mitrailleurs. Il fallait tenir coûte que coûte. Je rassemble en vitesse ma section pour la mettre au courant de la situation. En quelques mots, je leur montre comment on pourra faire face au mieux, en faisant notre devoir. Et je termine par un mot : » Vous savez que je suis prêtre, quoiqu’il arrive, je nous confie tous à la miséricorde de Dieu. Dans tous les cas, notre cœur sera confiant ». Et chacun est allé prendre sa place dans le dispositif. J’ai été frappé de ce moment silencieux et émouvant de la part de tous.
Le lendemain, nous étions encore tous vivants. L’attaque s’est portée sur la région voisine. Nous avons été déplacés sur un autre secteur de Gembloux, avec la mission de garder le Poste de Commandement du colonel du 134, sous des bombardements intenses d’aviation et d’artillerie, mais un peu en arrière du front.
Autres problèmes. Notre section, qui est à Corroy le château, est donc chargée de garder le P.C. du régiment. Nous sommes dans les maisons du village, sur une hauteur. Nous sommes repérés par l’artillerie allemande, et sans cesse un avion circule dans le ciel au dessus de nous ( le mouchard ). Le colonel me donne une consigne : chaque fois qu’il se posera un problème, j’aurai tous renseignements à la cave du P.C.
C’est alors qu’arriva près de mon colonel, un colonel français de chars, d’une D. L. M. ( Division Légère Mécanique ), qui revenait du combat contre une division blindée allemande. Il était très pessimiste. Il témoignait que nos chars légers étaient extraordinaires pour manœuvrer au combat, contre les chars allemands, mais qu’ils se heurtaient à des chars beaucoup plus gros, dont l’artillerie était beaucoup plus puissante, et contre quoi ils ne pouvaient lutter. L’impression qu’il en a retenue était que la France était perdue face à l’armée blindée allemande.
Pendant ce temps, on aperçoit vers le Nort-Est, direction Gembloux, un régiment d’infanterie voisin, qui a l’air de se mettre en position pour faire face à une attaque allemande. Au cours de l’après-midi, je reçois un ordre signé du colonel : « Faire face au Nord-Est. Attaque infanterie-chars. Résister sur place ». On sait ce que ça veut dire. Je vérifie mon dispositif. Voici qu’une giclée d’obus arrive tout près du P.C., de l’autre côté de la route. On est repéré. Je dis à Jean Mourey, un homme de ma section qui est tout près : « Mets-toi dans un trou, c’est dangereux ». Il me répond : « Mon lieutenant, je n’ai pas peur ». Je suis à quelques mètres à sa gauche. Je m’allonge dans une rigole de champ. On entend le sifflement d’une nouvelle giclée d’obus. C’est pour nous. Explosion, bruit épouvantable. Je perds un moment la notion des choses. Je reprends mes esprits et j’appelle : « Mourey.. Mourey » Pas de réponse. Une odeur de souffre et de chair brûlée m’entoure. Plus de Mourey !. Des morceaux de chair humaine un peu partout, jusqu’à la façade de la maison d’en face. On ramasse le tout avec une pelle 16. On fait une petite fosse où l’on rassemble tout. Avec quelques hommes de ma section toute proche, je dis une courte prière. L’enterrement est fait. Mais la guerre continue. Une éraflure au front. Je me demande si je n’ai pas un éclat dans la cervelle. Une épaule qui me fait mal. C’est tout pour moi...
Avec mon sous-officier adjoint, il s’agit de continuer à remplir notre mission. Etre prêt à défendre le P.C. : « Faire face au Nord-Est. Attaque Infanterie-chars. Résister sur place »
La nuit tombe là-dessus. On entend des bruits divers. Mais dans une telle situation, il ne faut s’étonner de rien. Le P.C. n’est pas loin. Il pense à nous.
Au petit matin (les nuits sont courtes en juin), comme le P.C. n’a pas fait signe, je fonce à la cave du P.C.. Plus personne. Tout le monde est replié. Que s’est-il donc passé ?
Je n’ai tout compris que plus tard. Pour le moment, il me fallait prendre seul une décision qui engageait la vie de mes 40 hommes, et les rendre disponibles à la défense française. Je me précipite à nouveau à la cave de l’ancien P.C.. Toujours plus rien. Je vois les avions allemands d’observation voler plus bas comme pour une attaque imminente. J’aperçois une section de la 1ère compagnie, avec son chef, le Lieutenant Saure, qui se repliait précipitamment. Je le rejoins à toute vitesse : « Vous partez ! .. Moi, j’ai un ordre de résister sur place ». « Oui, me dit-il, c’était vrai hier soir. Mais pendant la nuit, tout a changé. Tout le régiment est replié. J’étais le dernier, avec l’ordre de décrocher ».
Alors je prends ma décision à mes risques et périls, comme la seule décision qui puisse sauver mes 40 hommes et les garder disponibles.
Seul, devant Dieu et devant ma conscience, je donne l’ordre de repli, avec une direction approximative, vraiment dans la nature, d’après ma carte du terrain, et le bruit des balles et des obus, sur notre gauche, où sont les allemands.
Mon sous-officier adjoint veille à ce que le repli se fasse bien. Dès que nous arrivons à une certaine sécurité, derrière une haie, je fais le point de la situation avec mon sous-officier adjoint, mes chefs de groupe, et quelques hommes rassemblés avec précaution. « J’ai pris la décision seul. Hier soir, nous avions l’ordre de résister sur place. Mais cette nuit, il s’est passé des choses inattendues. J’ai la preuve par le Lieutenant Saure, que tout le régiment est en ordre de repli. S’il m’arrive malheur d’avoir pris cette décision, dites bien à ma famille et à ceux qui me connaissent ce qu’il en est ». Je me rappellerai toute ma vie de ces moments-là.
Par chance, au début de l’après-midi, joie de rencontrer mon bataillon. Le commandant était très heureux de nous récupérer. Il nous croyait perdus. Il ne comptait plus sur nous, notre section ayant été détachée, aux ordres directs du colonel. Et nous avons continué ensemble à la 6ème compagnie du 2ème bataillon, au cours de ce repli mouvementé et souvent tragique vers Lille et Dunkerque.
Mais j’attendais le jour où je pourrais rencontrer mon colonel, pour avoir le fin mot de l’histoire. Je ne l’ai rencontré que plusieurs mois plus tard, en captivité. Il m’a montré la complexité de la situation qui avait été la sienne. L’ordre de repli du 7ème corps d’armée lui était parvenu brusquement au cours de la nuit, si bien que dans la nécessité de joindre à tout prix beaucoup de grandes unités, notre petite section n’avait pas trouvé sa place. Il avait fait confiance à l’initiative du chef. Aussi le colonel m’a ardemment félicité de ma décision et du courage et de l’intelligence qu’il m’avait fallu, au service d’une mission qui me dépassait. Il a voulu souligner cela par une citation à mon nom, à l’ordre de la division, qui comporte l’attribution de la croix de guerre avec étoile d’argent. Si j’en cite le texte, ce n’est nullement par sentiment de vanité ( bien des soldats ont mérité une décoration et ne l’ont pas reçue ), c’est simplement parce qu’il me rappelle quelques grandes heures vécues avec les hommes de ma section, dans la force de l’amitié à toute épreuve, et dans la foi, et pour rendre grâce au Seigneur d’être encore là pour le dire.
« Officier de haute valeur militaire et morale, a été pour sa section un magnifique exemple de courage, de dévouement et de sang-froid. A Gembloux, le 18 mai 1940, le Régiment ayant décroché par ordre, a été laissé seul avec sa section sur le terrain pour jalonner l’avance de l’ennemi, s’est acquitté de sa mission avec beaucoup d’habileté et de présence d’esprit. Sur la Scarpe, le 27 Mai, a mené avec brio un difficile combat retardateur contre engins blindés ennemis ».
2 - LA DEBACLE
Après la trouée en France où toute la 1ère armée risquait d’être encerclée des Ardennes à Dunkerque, repli difficile où les chars allemands jalonnaient notre marche vers le nord de la France.
Du 19 au 27 mai, si nous étions réinsérés dans notre régiment, nous nous trouvions tous les jours dans une débâcle terrible. Les chars allemands étaient parfois tout proches. Je me souviens d’un moment difficile où le chef de bataillon, le capitaine Le Gouvello, m’a pressenti pour préparer une contre attaque aux environ de Charleroi. J’avais fait alors précipitamment un petit courrier à envoyer à ma famille avec un petit paquet contenant quelques mots de la situation, ce qui me restait dans mon portefeuille, avec mes sentiments affectueux. Finalement la contre attaque n’a pas eu lieu. Mais le paquet n’est jamais arrivé. Par contre, moi je suis revenu (ce qui valait mieux). J’ai pu rester constamment le point de ralliement de mes 40 hommes. Le P.C. du régiment nous communiquait fréquemment le chemin possible, à bien repérer sur ma carte d’Etat-Major. La nourriture arrivait mal ou pas du tout. La nuit était sans sommeil. A la moindre halte, les hommes tombaient de sommeil, et il fallait les réveiller à coups de pieds pour les faire repartir. A la tombée de la nuit, nous sommes toujours arrivés à décrocher, pour aller un peu plus loin dans la bonne direction. Des mauvaises nouvelles circulaient. Un drame s’est produit à la compagnie voisine.
L’adjudant-chef de la 5° Cie a été tué par un caporal-chef, parce que déprimé et défaitiste, il marchait pour passer à l’ennemi. C’était des heures noires, où il fallait bien garder la tête sur les épaules, se sentir très liés les uns aux autres coûte que coûte et tenir jusqu’au bout ensemble.
Le 27 mai, sur la Scarpe, comme il est dit dans la citation du colonel, notre section a repris position, et a essuyé quelques giclées de balles, mais sans grand dégât. Nous avons riposté. Le capitaine Assalet, adjoint au chef de bataillon, qui était prêtre, m’avait dit la veille, amicalement : « Faut pas vous en faire, le pire qui puisse vous arriver, c’est d’être tué » ( ça m’est resté dans l’esprit ).
Le 28 mai, nous arrivions à Lille, au Faubourg des postes. Nous étions encerclés de toutes parts. Après avoir brisé et enterré nos armes, nous avons été capturés le 29. Le colonel du 27° R.I. venait d’être tué tout près de là. Et le général Juin a été également fait prisonnier.
3 - JUIN 4O - DEPART EN PRISONNIERS POUR L’ALLEMAGNE
Désarmés, nous avons été pris en charge par des soldats allemands, qui nous rassemblaient en vue de nous envoyer en Allemagne. Aussitôt, j‘ai été séparé de mes hommes. Ce fut un moment émouvant.
Après quoi, remontée de toute la Belgique, en colonnes de prisonniers, harassés, dormant les nuits sur les places des villes, marchant toute la journée, tombant de sommeil, assoiffés sous le grand soleil de juin 40, jusqu’à la frontière de Hollande et d’Allemagne.
Un fait m’a marqué, durant cette période difficile. Le capitaine Baru, du 27ème d’infanterie, qui était dans la colonne, un peu avant moi, a été froidement tué par une sentinelle allemande qui gardait la colonne à ce passage. Il venait de boire un verre d’eau, que les belges compatissants nous offraient quand c’était possible. Il s’est fait durement renvoyer à sa place dans la colonne. Il aurait répondu « salaud ». J’ai vu alors ce soldat mettre son fusil en joue, et tirer. Le coup n’est pas parti (les culasses des fusils allemands ont une sécurité). J’ai pensé, étant quelques mètres en arrière, qu’il ne voulait pas le tuer pour cela. Erreur ! Il a enlevé la sécurité à la culasse de son fusil. Il a remis en joue et a tiré. Le camarade est tombé sur le nez. Je me suis approché, disant en allemand que j’étais prêtre, et que je voulais l’assister. Il a refusé, me menaçant à mon tour. J’ai dû remonter toute la colonne, pour dire à l’officier qui commandait toute la colonne que j’étais prêtre, et que je voulais entourer le camarade qui venait d’être tué. J’ai été accompagné pour venir jusqu’à lui. Il était mort. J’ai pris alors son portefeuille pour le faire passer à sa famille. Je l’ai confié aux autorités allemandes. En général les allemands sont « règlos » pour cela.
A la frontière de Hollande, nous avons été emmenés en wagons à bestiaux jusqu’à Aix la Chapelle, puis à Dortmund à un camp de regroupement, pour être expédiés ensuite dans différents camps, ou Stalag ou Offlag. Dans les offlag (camps d’officiers), la Convention de Genève interdit de faire travailler les P.G.
4 - LA VIE EN OFFLAG
On nous a transportés d’abord à l’Offlag II D, entre Stettin et Dantzig, un camp d’environ 3000 officiers. Quelques mois après, on nous a amenés à Lübeck Offlag XC (environ 2000). Mes deux dernières années se sont passées à l’Offlag VI A, en Westphalie.
A l’Offlag II D, en Poméranie, j’avais pu envoyer une carte P.G. à ma famille à Faux-Villecerf. J’ai reçu un mot au cours du mois d’août, qui m’a enfin tranquillisé.
Cinq ans à vivre de la vie de P.G. ! On ne savait pas que ça durerait si longtemps. Il faudrait un livre au moins pour raconter un peu tout cela (il y en eut beaucoup qui ont été écrits).
Ce furent 5 années éprouvantes, mais extrêmement fécondes, pour mon expérience humaine, et pour ma vie de prêtre. Toute ma vie en a été impressionnée.
Après 5 ans de séminaire, 5 ans de captivité passés avec des instituteurs, des professeurs, des avocats, des professions libérales de toutes sortes, avec des gens aussi bien incroyants ( tout de suite après les drames de la guerre, que nous avions vécus les uns et les autres ), ce furent des relations très riches, d’homme à homme, dans la vérité de la vie et parfois dans sa crudité.
Tout cela, à travers des moments bien difficiles, où l’on se sentait parfois poussé à bout, par la dureté des conditions de vie, et particulièrement par la faim. Des jours où l’on se sentait les uns et les autres, à la fois dans une sorte de sous-tension, et avec une sensibilité d’écorché vif. On avait l’impression que la lutte pour la vie se faisait sentir à fleur de peau, et parfois que, dans les plus petits actes de la vie, l’héroïsme et les « vacheries » étaient tout près l’un de l’autre (on en a vu des exemples).
Tout en se disant bien que ça pourrait être pire (on ne savait pas encore l’enfer que vivaient nos camarades qui étaient dans les camps de concentration).
5 - ETAT DES LIEUX … AMBIANCE DE GUERRE
La différence avec la guerre, c’est que les fusils sont d’un seul côté. C’est toujours comme à la chasse, le face à face entre le chasseur et le gibier, mais tous les deux sont des hommes raisonnables qui se respectent selon les lois de la guerre. (Que la guerre existe encore entre les hommes… c’est une autre question !)
LE CADRE MATERIEL
Un grand terrain en pleine campagne, loin des habitations, entouré de barbelés. Avec des sentinelles bien armées et présentes un peu partout. Des miradors (tours de surveillance)
aux quatre coins, et partout où le regard peut repérer ce qui se passe à l’extérieur des baraques, avec des jumelles et des projecteurs, et armés de fusils-mitrailleurs, la gâchette toujours prête à fonctionner. A quelque distance des barbelés, il y a un fil de fer qu’il ne faut pas franchir, sous peine d’avoir une balle dans la peau.
A l’Offlag VI A, un camarade (Vantelot) a été tué la nuit, par une sentinelle qui l’avait repéré du mirador qui dominait le camp, armée d’un fusil à lunettes, ayant réussi à sortir du bâtiment, la nuit, en vue de s’évader.
Les sentinelles sont présentes partout et quand elles veulent. Elles entrent dans les chambres à leur guise. Sur la boucle de leur ceinturon, comme de tout soldat allemand, on peut lire : « Gott mit uns » « Dieu avec nous ».
LES APPELS
Rassemblement de tous les P.G. du camp, souvent, pour l’appel de tous, sur la grande place, bien alignés. Ils sont comptés et recomptés. D’abord le matin au réveil, souvent le soir, parfois inopinément, pour une fouille de nos chambres, ou en cas d’évasion, ou pour une raison qu’on ignore.
Il y a environ 2 à 3000 P.G. par camp. Il fallait du temps, et l’hiver, on avait froid.
LOGEMENT
Baraquements, ou bâtiments en dur (souvent d’anciennes casernes). Chaque chambre est remplie de châlits à trois niveaux, contre le mur, avec des paillasses sur des planches. Au milieu de la pièce, il y a un peu de place libre, avec en général une table et des bancs. Il y a normalement 8 ou 9 châlits par pièce, soit 24 ou 29 occupants. Le vrai domicile de chacun est d’abord sa place dans son châlit (pour dormir, pour lire, pour écrire etc.). Autrement, chacun ne vaut que par son numéro (son matricule). On est toujours là, quand il n’y a pas assez de place dans la chambre ou quand il pleut dehors.
On laissait le niveau du bas à un camarade qui avait besoin d’une table pour écrire
(conférence à préparer, etc.). Il repliait sa paillasse vers l’avant, ce qui lui servait de table, et il s’asseyait sur la planche de dessous.
La plus grande partie du temps se passait dans la chambre, ensemble. On causait. On faisait sa correspondance. On lisait. On prenait des notes. On jouait à la belote ou aux échecs. On regardait ce qui nous restait dans les colis de la popote etc.
Je regarde la photo de l’Offlag VI A : A mon châlit, j’étais au 3° niveau. En dessous, Henri de Wendel, avec qui j’ai fait bien des parties d’échecs. En bas Trocmé, un cadre de la caisse des dépôts et consignations à Paris. Parmi les occupants : un avocat à la cour de commerce, de Paris, un ingénieur chimiste, un directeur d’un grand magasin de vêtements d’Epernay, un petit producteur de Champagne d’Epernay, deux capitaines d’active, mon capitaine Weil, un juif sympathique, un pêcheur de Bretagne, dont les colis contenaient des boîtes de sardines au beurre, deux instituteurs, un professeur à la Sorbonne, spécialiste de la recherche sur le plancton, un mandataire aux halles de Paris, au rayon des poulets etc.
On a eu le temps de se connaître, de partager nos raisons de vivre, et nos expériences de la vie, en toute sincérité et camaraderie, d’écraser ses puces. Quelquefois ça criait un peu fort, ou on chahutait.
Je me souviens d’un soir, à l’Offlag VI A, à Lübeck, à la nuit tombée, mon camarade Foulon, mandataire aux halles, me propose de se mesurer avec moi, pour voir qui mettrait l’autre K.O. Les autres sont couchés. On dégage le centre de la pièce. On choisit un arbitre. Il avait 40 ans, et moi 26. Il me toise de la supériorité de son âge. On commence le pugilat. On s’empoigne. On est par terre. On se retourne plusieurs fois l’un et l’autre. Et voici qu’il me dit « Arrête. J’ai la jambe cassée ». Et c’était vrai. On était très décalcifié. Nos os n’étaient pas solides. J’étais bien ennuyé. Et puis, c’était en pleine nuit. Les portes étaient fermées. On était en baraquement. On a eu toutes les peines du monde à alerter une sentinelle, pour qu’il soit transporté à l’infirmerie, et le lendemain à l’hôpital. Il en est revenu environ un mois après, disant avec satisfaction qu’il avait été bien nourri, et soigné par des sœurs.
Dans la chambre, on passait la plus grande partie de son temps dans une promiscuité sympathique. Parfois, les nerfs plus tendus, surtout quand la correspondance n’arrivait pas.
Je me souviens d’avoir un jour séparé deux camarades qui allaient se battre, parce que l’un avait accusé l’autre de lui avoir chipé ses mégots à l’occasion de l’appel.
Dans l’ensemble pourtant, notre éducation familiale, et nos responsabilités éducatives et sociales limitaient les éclats possibles. Il faut pourtant bien se rendre compte que la maîtrise de soi et la sympathie réciproque atteignent leurs limites dans certaines situations très tendues, surtout quand la faim s’y mêle et que, comme on dit « la faim fait sortir le loup du bois ».
On trouvait le temps long. La correspondance avec la famille de France avait une très grande importance. QUAND ON A PERDU TOUTES LES LIBERTES, ON A TOUJOURS LA LIBERTE INTERIEURE, ET LA LIBERTE D’AIMER. ON EN FAIT TOUT CE QU’ON PEUT. IL RESTE TOUJOURS LA LIBERTE DE CROIRE ET D’ESPERER.
6 - SOUCI CONSTANT : COMMENT S’EVADER ?
Evidemment, c’était notre premier souci.
REPERER D’AVANCE TOUS LES MOYENS POSSIBLES
Et rassembler, en le cachant, tout le matériel nécessaire (boussole, cartes etc.) avec un costume civil, pas facile à faire, et encore plus à camoufler. Il fallait être hanté par le problème. On pouvait passer tout son temps et ses énergies à y penser. Dans tous les cas, il ne fallait pas se faire tuer, car « nos gardiens » avaient la gâchette facile. Il y a des camarades qui ont réussi.
D’autres, le plus grand nombre, n’ont pas réussi (j’ai été de ceux-là). Cependant il fallait être prêt pour toute occasion possible, et en même temps occuper son temps utilement, surtout ne pas se laisser diminuer, par l’ennui, par le vide ou le découragement, voire la déprime. Heureusement, il y avait les copains, pour se stimuler les uns les autres, ne serait-ce qu’au travers des parties de belote, et, je le dirai plus loin, au moyen de tous les centres d’intérêt que tous ceux qui étaient là étaient à même d’aménager au service de tous. Il fallait mener simultanément les deux projets.
Ici c’est l’histoire des évasions qui nous donne la réponse. Les livres ne manquent pas sur le sujet. Dans les quatre offlags où j’ai été, il y a eu des astuces sensationnelles et des ratés décourageants. Ce qui fut le plus réussi, mais qui était un travail considérable, et occupait à temps plein les camarades qui l’avaient entrepris et ceux qui les aidaient : ce fut le souterrain.
UN SOUTERRAIN
Il fallait toute une équipe bien soudée, et des spécialistes de ce genre de boyau sous terre, une sorte de mine bien étayée. Il fallait aussi limiter drastiquement le nombre de ceux qui s’évaderaient le moment venu. Il y eut parfois de la bagarre à ce moment-là.
Le souterrain partait du dessous d’un châlit et allait déboucher au-delà des barbelés, le plus loin possible d’un mirador. Ce qui était extrêmement difficile, c’était de camoufler les déblais, car la terre fraîchement creusée n’a pas la même couleur que la terre à l’extérieur. J’ai aidé parfois à porter la terre, dans des petits sacs cachés sous la capote, pour la répandre dehors ; mais c’était risqué. Un jour, j’ai eu peur, parce que j’ai cru avoir été repéré par une sentinelle qui faisait les cent pas, à l’extérieur des barbelés.
Un jour, il nous est arrivé un gros pépin. C’était à Soest, où nous étions dans de grandes casernes à trois étages. Il y avait des super combles au dessus du grenier. On faisait la navette la nuit pour porter la terre au-dessus du grenier. Manque de chance ! La terre était si lourde, (et il y avait un très gros tas de terre), qu’une fente s’est produite dans le plafond et la terre a dégouliné au-dessous. On en a eu toute une histoire. Bien sûr, des « gardiens », toujours présents partout, et à l’affût de tout, s’en sont vite aperçus. Alors, appel pour tout le camp. Fouille de toutes les chambres. Ils ont vite découvert l’entrée du souterrain.
UN CAS : UN CAMARADE QUI REUSSIT SEUL.
Pour mon compte personnel, j’ai longtemps essayé de trouver une piste, en lien avec d’autres... Avec un camarade de Bordeaux, nous faisions des projets. Il ne fallait penser qu’à ça. Il s’est accroché, rassemblant le matériel nécessaire. J’en ai gardé le souci, tout en remplissant ma vie par ailleurs de dialogues avec les camarades, et d’enrichissements culturels divers. Un jour, il a sauté sur une occasion. Il y avait beaucoup de brouillard. C’était l’hiver. La neige recouvrait toute la nature. C’était le 23 février 43. Il s’est enveloppé d’un drap. Il avait repéré le matin, assez loin d’un mirador, un endroit plus franchissable pour traverser les deux rangées de barbelés, séparés à l’intérieur par d’autres rouleaux de barbelés. Il avait remarqué le matin, avec un camarade, le temps que mettait la sentinelle, pour faire les cent pas entre le mirador et cet endroit, (son camarade veillait à distance). Tout enroulé de son drap, il escalade en vitesse les deux rangées de barbelés. Il était libre. Il avait boussole et carte. Il avait étudié l’itinéraire le meilleur. Il a réussi. Il a raconté ensuite toutes les chances et les coïncidences, qui lui ont permis d’aller jusqu’au bout de son aventure périlleuse. Quelques jours après, il nous a envoyé de ses nouvelles, de Bordeaux. C’était l’Abbé André Dupouy. J’ai reçu de lui après la libération un fascicule qu’il a fait ( 52 pages ) : « Mon évasion de l’offlag VI A ».
Vous savez qu’il y a beaucoup de livres qui sont parus sur les évasions des P.G.
7 - VIVRE AU CAMP
A part le temps des appels, qui étaient interminables, tout était centré sur la chambre. Tous les jours, n’ayant pas à travailler, on improvisait au mieux notre emploi du temps. Petit à petit, des activités diverses s’organisèrent, du moins si on avait quelque chose dans l’estomac
L’essentiel pour vivre, c’était LA NOURRITURE et LES NOUVELLES
LA NOURRITURE.
Du camp
Le pain était la nourriture de base. Le pain gris carré, qui n’était pas appétissant, mais qui nourrissait, si on en avait assez. Les derniers mois, on avait un pain pour sept. Chaque jour, on allait chercher la pitance aux cuisines:
- soupe chaude avec différentes verdures qui nageaient dedans.
- puis, quand il y avait des pommes de terre, c’était merveilleux. En général, c’était plutôt des rutabagas.
- pâté de charcuterie, ou gros saucisson spécial, ou gros boudin, ou graisse à tartiner
- assez souvent un peu de fromage (?) ou de confiture (?).
Ce devait être assez équilibré médicalement, car on n’était pas particulièrement malade de ce qu’on mangeait (sauf quand on tombait sur des patates gelées).
Ce qui manquait, c’était la quantité pour chacun. Je sais que nous avions encore faim, au point que c’était chacun son tour à « lécher la gamelle ».
Il y avait le minimum pour tenir. Etait-ce calculé pour que les P.G. n’aient pas trop de
santé pour s’évader ?
C’est là que les colis étaient indispensables.
La dernière année, notre inquiétude grandissait. Il était temps que ça finisse. En Allemagne, les moyens de vivre diminuaient pour la population. Les officiers n’avaient pas à travailler ; il fallait d’abord nourrir ceux qui travaillaient, pour qu’il y ait du rendement. Les colis de la famille arrivaient de moins en moins de France. Chaque popote s’organisait comme elle pouvait. Dans les dernières semaines, chacun son tour, l’un d’entre nous allait chercher des épluchures de pommes de terre, au tas de déchets derrière la cuisine. On les lavait le mieux possible. On faisait cuire ; cela faisait une espèce de purée grise, après quoi on avait l’impression d’avoir moins faim.
J’ai le souvenir d’un camarade, qui avait demandé d’aller en stalag, pour travailler, espérant ainsi être nourri. Il ne fallait surtout pas qu’il revienne au camp. Il se serait fait arnaquer pour service à l’ennemi en temps de guerre.
Les colis
Les colis reçus de France, de la famille, et pendant une certaine période, des colis américains.
On s’organisait par popotes de 4 ou 5, pour répartir à peu près les réserves selon les arrivées prévues. On savait que notre camarade de Bretagne recevrait des boîtes de sardines au beurre. Moi j’avais la chance de recevoir de bons colis de la campagne. Le refrain qu’on attendait en revenant de la baraque-colis était : « As-tu des fayots »? C’est encore ce qui nourrissait le mieux, en un petit volume. Mais pour les cuire, c’était autre chose. On a inventé des cubilots avec des boîtes de petits pois. Le combustible était des boulettes de papier, mouillé, serré et séché. On était abonné au « Trait d’Union », qui était un journal de propagande allemand. Il servait de papier pour tous les besoins, et aussi pour du combustible.
Mais à l’heure où les cubilots marchaient, le couloir était irrespirable à cause de la fumée.
La distribution des colis
L’équipe allemande de la distribution était « sur les dents ». Surveillance extrême. Car c’est là que pouvait arriver le matériel interdit, pour les évasions en particulier (boussole, galène pour poste radio etc.). On ne recevait pas une boîte de conserve, mais son contenu, car il fallait faire attention au double fond. De même, on ne recevait pas un gâteau, sans qu’il soit coupé dans tous les sens.
LES NOUVELLES
Elles étaient aussi importantes que la nourriture.
La correspondance
La correspondance avec la famille était très contingentée, et avec des formulaires spéciaux. La seule façon de faire passer des messages secrets était le code secret prévu d’un commun accord, à l’avance, entre P.G. et leur famille, par l’intermédiaire des évadés ou des libérés. Il consistait en général à repérer le numéro des lettres dans la rédaction de la lettre et, en les recopiant sur une feuille, lire la phrase ainsi obtenue.
La radio
En particulier la radio de Londres, écoutée par des postes bien camouflés. Il y avait un moment de communication, organisé entre les délégués de baraques et de chambres, avec un guet soigneusement combiné, pour que les informations arrivent partout.
C’est ainsi qu’on a appris le débarquement de juin 44, le matin même.
Le bouche à oreilles
Très important pour l’information et pour l’opinion dans le camp.
Il ne faut pas oublier (j’ose le rappeler) les nouvelles qu’on attrapait en vol dans ce passage obligé qu’étaient « les chiottes » de la captivité. Un coin très pittoresque. Un poème en son genre. Oserais-je décrire les installations de fortune de l’offlag II D en Poméranie, en août 40 : Il s’agissait d’être assis en série, sur une barre de bois solide, au-dessus de fossés ad hoc, où il fallait calculer son équilibre.
A l’offlag X C, Lübeck, il y avait une marque de pissotières citée entre nous, pour connaître les nouvelles, surtout les nouvelles plus personnelles arrivées par correspondance, c’était la marque « Torfit ». On disait « As-tu un Torfit » ?
Peut-être ne devrais-je pas mettre cela en littérature, pour rester un homme de bonne éducation, et élevé dans nos humanités classiques. Pourtant, il ne faut pas oublier dans notre condition humaine de P.G., bien des servitudes quotidiennes, et notamment ce passage obligé très désagréable, mais haut-lieu pour respirer des nouvelles de nos familles de France.
Je conclus ainsi ce chapitre : oui, la vie en offlag était très conditionnée par LA NOURRITURE et par LES NOUVELLES, quelle que soit leur forme de transmission.
8 - ORGANISER SON TEMPS
Quand on était à peu près nourri, on pouvait faire travailler le cerveau et les jambes.
(je n’avais pas encore réalisé que l’estomac était si près du cerveau et des jambes).
L’étude et les sports, avec rien dans l’estomac, ça ne donne pas grand chose.
Il faut dire que durant la majeure partie de la captivité, on a eu le minimum indispensable.
Comment pouvait-on occuper son temps au mieux, dans cette situation difficile, en pensant à l’avenir, et en s’enrichissant l’esprit et le cœur ?
Ce chapitre est difficile à mettre en ordre et à classer. Il y aurait tant de choses à dire à ce sujet, durant ces cinq années. Je procéderai par centres d’intérêt successifs, où tout se recoupe.
Je m’attacherai davantage (puisque c’est un témoignage), à certaines choses que je faisais ou à certains regards sur la situation où je me trouvais.
NOTONS BIEN LE MILIEU OU NOUS ETIONS : UN REGROUPEMENT EXCEPTIONNEL D’HOMMES SOUVENT TRES QUALIFIES, PRETS AU DIALOGUE AMICAL ENTRE TOUS.
Il y avait des personnes qui représentaient toutes les branches de l’expérience, de la culture, des sciences, des techniques, des beaux-arts, du droit, de la philosophie, de la théologie. J’en cite quelques-uns : Paul Ricoeur, en philosophie, H. Bouxin, professeur à la Sorbonne en biologie, Roger Ikor, en littérature, Gabriel Garrone, en théologie, Guillaume Gillet, en architecture et peinture etc.. Nous avions beaucoup de camarades qui étaient enseignants à tous les niveaux du savoir, professeurs de facultés, de grandes écoles, etc.. J’avais beaucoup de camarades, professeurs de lycée, de collèges, d’instituteurs etc. il y avait aussi beaucoup d’avocats, de chefs d’entreprise et de commerce, beaucoup d’officiers d’active, des professions libérales, des prêtres etc…
Au bout de quelques mois, toute une université locale s’esquissait.
La direction allemande du camp aidait dans ce sens, tout en surveillant de près tout ce qui se passait et se disait. Elle pensait sans doute qu’on s’occuperait moins de s’évader.
On recevait de France beaucoup de livres qu’on demandait. On pouvait même en commander en Allemagne.
I ) ACTIVITES CULTURELLES.
D’abord, comment et où se retrouver pour communiquer utilement et étudier efficacement ?
Il y avait une grande salle et deux salles moyennes. De plus, les caves des blocs permettaient la rencontre de petits groupes. Dans les chambres au besoin, on se serrait pour permettre des rencontres par équipes. Par ailleurs, le dialogue à deux avait toute sa place dehors, quand il ne pleuvait pas.
Dans cette ambiance de « désenchantement » de ce monde où nous étions, et où nous avions vécu des situations où les hommes se tuent les uns les autres, pour être maintenant en prison, nous arrivions par la réflexion commune, la camaraderie, la foi partagée, à reprendre du souffle et du cœur.
Si je pars de la grande salle, où se rassemblait une grande partie du camp, et qui influençait l’opinion, je citerai entre autres les conférences de Paul Ricoeur et de Gabriel Garrone.
Avec Paul Ricoeur, le philosophe clair et attachant par la vigueur de sa pensée, qui nous aidait, à travers l’histoire de la pensée philosophique, à apprécier la valeur de tout vrai dialogue d’aujourd’hui, dans la profondeur de l’intelligence humaine..
Avec Gabriel Garrone, bibliste et théologien, qui nous aidait à redécouvrir à travers l’évangile, l’idéal profond qui est au coeur de tout homme : heureux ceux qui ont faim et soif de justice, de vérité et qui font la paix. Ils sont enfants de Dieu. Ils ont au coeur l’amour plus grand qu’eux-mêmes. Ils vivent dans l’espérance.
Je cite ces deux cas, qui ont retenu mon attention. Mais il faudrait évoquer tant de conférences de grande valeur faites dans la grande salle.
Il faudrait souligner surtout tous les multiples groupes où l’on s’enrichissait les uns les autres, à partir de nos expériences, de nos études et de nos découvertes dans un dialogue très ouvert.
II ) DES ACTIVITES ARTISTIQUES DIVERSES
Théâtre (il y eut des pièces remarquables), musique, chorales, peinture etc. Notons que les costumiers du théâtre réussissaient parfaitement les costumes pour les évasions.
III ) DES OFFICES RELIGIEUX.
Organisés à des horaires indiqués, ils étaient très suivis. Des causeries religieuses avaient lieu dans les salles. Un album de 120 pages a été édité aux éditions du Cerf dès 1943 :
« Une paroisse derrière les barbelés » sur ce qui se passait à ce sujet à l’offlag VI A. Le prieur des bénédictins de Kerbénéat, en Bretagne, était spécialiste du chant grégorien. Je me souviens que l’Abbé de LaTrappe, Don Sortais, nous montrait la grosse croix pectorale de bronze, qu’il avait sur la poitrine, où avait ricoché une balle qui devait le tuer.
IV ) Il y avait aussi LES SPORTS (quand on avait à manger)
Sur la grande place, on pouvait jouer au foot au besoin ; mais le terrain était dur. Un terrain de Basket. Nous avions organisé un tournoi des provinces de France. Je faisais partie de l’équipe Champagne-Ardennes. On a gagné. On n’était pas peu fier. On avait eu une foule de spectateurs.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CE QUI EST A NOTER DANS TOUTES NOS RELATIONS, QU’ELLES SOIENT CULTURELLES, ARTISTIQUES, SPORTIVES OU RELIGIEUSES, C’EST QUE, même si notre sensibilité était parfois à rude épreuve, et nos nerfs à fleur de peau, IL Y AVAIT TOUJOURS UNE GRANDE OUVERTURE RECIPROQUE. Il y avait une unité dans l’amitié, qu’on ne voyait pas dans la vie civile, et qui est restée d’ailleurs après la libération. On disait ce qu’on pensait sans aucun problème. Par exemple, quand je suis arrivé à Soest dans une nouvelle chambre, on m’a dit à l’entrée : « Toi le curé, t’es pour l’obscurantisme ». Je réponds aussi net: « C’est pas si sûr que ça. On a le temps d’en parler ». On a eu plus de trois ans ! C’est extraordinaire la qualité du dialogue entre ceux qui ne sont pas d’accord et qui disent pourquoi. On découvre des valeurs cachées qu’on ne soupçonnait pas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V ) Certains ont pu FAIRE UN TRAVAIL INTELLECTUEL POUR LE RETOUR.
Mon ami André Wanault de Troyes, instituteur, a composé à l’offlag VI A, des livres de pédagogie, qu’il a édités au retour.
Plusieurs camarades ont écrit un livre qu’ils ont fait paraître après la libération.
Ce qui n’empêchait pas d’avoir toujours un oeil sur les occasions pour s’évader ou pour aider ceux qui avaient besoin de nous pour y arriver.
VI) BIEN GERER JUSQU’AU BOUT SON TEMPS ET SES ENERGIES.
L’ennemi ce n’était pas seulement les allemands (ils ne seraient pas toujours là).
C’était perdre son temps et son goût de vivre et d’espérer. Personnellement, je rencontrais beaucoup de camarades. Je n’avais jamais le temps de faire le quatrième à la belote. C’était passionnant dans des jours pareils, de partager la nourriture du corps et du cœur.
Chaque matin, il fallait recharger les batteries pour retrouver la forme, en vue d’une nouvelle journée, dont nous ne savions pas ce qu’elle serait. La culture physique, si l’estomac avait ce qu’il fallait, était un moyen de bien se dérouiller. Je m’étais improvisé moniteur de culture physique. J’avais comme élève en particulier Gabriel Garrone, qui devait être plus tard expert au Concile, un des rédacteurs de la constitution « L’Eglise dans le monde de ce temps ». La captivité lui avait bien appris ce qu’était une partie du « monde de ce temps ».
Il tenait à la culture physique qui facilitait son gros travail intellectuel.
Mais nous avions aussi une culture physique plus spécialisée, qui a été très suivie : Ce furent les séances de gymnastique rythmique, organisées le matin en plein air, par notre camarade Bruxeille, un instituteur d’Aix en Provence, spécialisé en la matière. Un ami merveilleux, dont la vie avait été toute renouvelée par la rencontre du P. Congar, qui avait été P.G. avec lui à Mayence. Il faisait venir des disques de France. C’était très décontractant pour les nerfs, et pour partager ensemble dans le soleil (s’il était là ), la joie de vivre qui nous restait, tout en écoutant de la belle musique. On dit que c’est une gymnastique pour les femmes. Je me suis aperçu que pour les hommes en captivité, c’est très positif.
Cela nous a amené, à d’autres moments de la journée, à apprendre à danser la plupart des danses régionales de France, le fandango de Bretagne, les bourrées d’Auvergne, les danses provençales etc... On a même donné des séances de gala, sur la scène de théâtre de la grande salle, en costumes de papier crépon de toutes les couleurs. On a eu beaucoup de succès. Il parait que c’était ravissant. Comme nous n’étions que des hommes, et que j’étais plutôt de petite taille, je faisais toujours la femme dans les couples. Vous voyez que dans notre vie plutôt pas marrante, on se trouvait des heures où l’on pouvait rire de bon cœur.
VII ) L’OFFLAG ET LES FEMMES
Un proverbe chinois dit « La femme est la moitié du ciel ». Il n’est pas dit que les hommes soient l’autre moitié. Toujours est-il que nous n’étions que moitié de l’humanité sur place. Nous avions un camarade médecin psychanalyste, qui nous a fait à ce sujet une conférence très remarquée et adaptée à notre cas. Il nous expliquait bien, comme un médecin sait le faire, que la sexualité ce n’est pas que la sexualité physique (la sexualité du zizi, disaient les copains), mais la sexualité de la personne, de tout l’être humain, aussi bien le psychologique (le sentiment), le sociologique (la relation entre humains, hommes et femmes dans la société), le spirituel (il a parlé de sublimation), et qu’il fallait bien penser faire au besoin le transfert de l’un à l’autre pour un bon équilibre de la personne et des personnes ensemble. Nous avions reçu de notre mère à la naissance, des chromosomes féminins et masculins à gérer au mieux tout au long de notre vie. J’ai l’impression qu’au camp, on a réalisé un assez bon équilibre d’ensemble. Il est vrai que les excitants en nourriture et en alcool ne gênaient pas notre équilibre organique.
Toujours est-il que, si les femmes étaient absentes, elles tenaient beaucoup de place... Je me suis aperçu qu’il est faux le dicton « La femme est un sexe purement décoratif » car, si on ne les voyait pas, elles avaient une place considérable. Les camarades nous parlaient de leur femme et de leurs enfants, de leur mère. Ils nous montraient les photos. On les connaissait par cœur.
Un jour un camarade reçoit une lettre de sa femme lui disant que leur petite fille avait 40 de fièvre et qu’elle était inquiète. Il a fallu attendre le prochain courrier, un mois après, où sa femme lui disait qu’elle était guérie. Tous les camarades partageaient son attente. On s’encourageait en se communiquant les nouvelles reçues par la correspondance.
Mais il y avait aussi les heures noires, qui faisaient que tous noircissaient un peu. Un jour un camarade s’est jeté par la fenêtre du 3ème étage, parce que sa femme était partie. Il s’est cassé les deux jambes. Il a pensé qu’il avait eu tort et que ça n’arrangeait rien.
VIII ) QUAND ARRIVAIT LA 5 ème ANNEE.
Il était temps que ça finisse. La situation était de plus en plus difficile en Allemagne.
La nourriture devenait catastrophique. Il fallait tenir. On a appris le massacre de Buchères. L’espoir renaissait par la correspondance. La radio de Londres nous montrait la France qui se reconstituait. La résistance prenait corps un peu partout. Les américains progressaient invinciblement depuis le débarquement. Le Général de Gaulle prenait en main les destinées de la France.
9 - LA LIBERATION PAR LES AMERICAINS LE 6 AVRIL 1945
Je raconte ce qui s’est passé après la libération du camp par les américains, les lendemains du 6 avril 45. Une fois la porte du camp ouverte, je suis parti dans les champs avec deux ou trois camarades, en espérant trouver quelque chose à manger. Nous avons rencontré un groupe de P.G. russes, qui tuaient des vaches pour se nourrir, dans les champs. Je me suis approché, avec la seule monnaie d’échange valable entre P.G. : 4 cigarettes qui me restaient ( des « junaks » des mauvaises cigarettes polonaises ). Je ne connaissais pas le russe, et eux ne connaissaient pas le français. Je montrais seulement les 4 cigarettes, et en indiquant du doigt un morceau de beefsteak. Il a compris aussitôt et nous sommes rentrés au camp avec un morceau de vache sous le bras. On l’a fait cuire avec les moyens du bord. Je me souviens qu’il m’a été impossible de digérer la moindre bouchée. J’ai été plusieurs jours incapable de manger. Je ne savais que vomir.
Quelques jours après, les américains nous ont transportés à l’aérodrome de Paderborn. Malheureusement, mon camarade Bertaut, un voisin de châlit, a été victime d’un accident de camion, dans un virage. Quel drame amical, à pareille heure !
Les américains nous ont donné de leurs colis. Petit à petit, on s’est remis à manger.
10 - LES RETROUVAILLES A LA MAISON
C’est vraiment une grande chose que la famille. C’est un don de Dieu qu’on n’a jamais fini d’apprécier. On ne s’en aperçoit pas quand on a l’habitude d’en vivre tous les jours. Mais après un an de guerre et cinq de captivité ( alors que plusieurs fois, j’étais sûr que je ne les reverrais plus ), c’est formidable. Embrasser son papa et sa maman, ses frères et sœurs (ma petite sœur Cécile que je ne reconnaissais pas - elle avait 13 ans quand je suis parti et elle en avait 19 - et j’ai demandé : qui est cette jeune fille ? ), c’est une heure marquante de l’existence. Se souvenir ensemble de ceux qui ne sont plus là ( la mémère Martine était morte pendant ma captivité). Rencontrer jour après jour la famille proche, les amis, les gens du village. On avait tant de choses à se communiquer depuis 6 années, une de guerre et cinq d’occupation et de captivité, où papa me racontait que, comme maire de la commune, il avait eu bien du mal avec les allemands. De mon côté, ouvrir un regard neuf sur une situation toute nouvelle, où tout est inattendu ( ce qui avait été souvent pour moi l’inespéré ). Tout se bousculait dans le cœurs et dans le cerveau. On ne pouvait pas tout penser et tout dire à la fois.
J’ai été vite remis d’aplomb avec tout ça. En sortant du camp, je me sentais presque fichu, amaigri, avec un pauvre estomac. Je n’avais pourtant que 31 ans. Et voici que tout s’est remis en route en quelques semaines.
Retrouver la famille, la France, un immense champ de Dieu à moissonner ensemble. La guerre est finie. Une grande espérance s’ouvre pour un monde nouveau à faire ensemble dans la foi.
11 - LE REEMBRAYAGE DANS LA VIE NORMALE AVEC UN COEUR CHANGE
Quelques jours après, Mgr Le Couëdic, notre évêque, m’a fait signe, pour me donner un ministère dans le diocèse. Il se rendait bien peu compte de ce qui s’était passé en captivité. Il m’a nommé vicaire à Nogent-sur-Seine, « pour me reposer ». Je remplaçais le cher abbé COURTOIS, qui était malade et qui devait hélas mourir bientôt de la tuberculose. Il voulait d’abord me nommer, comme j’étais avant la guerre, préfet de discipline au petit séminaire. Mais je lui ai laissé entendre que j’avais assez fait d’internat depuis cinq années, et que je préférais un ministère en plein air et en plein monde.
Je suis donc parti à Nogent. Ce fut pour moi un temps merveilleux. J’ai eu un ministère exaltant. J’y ai retrouvé toute la France et sa jeunesse, et un milieu très accueillant et sympathique. J’étais heureux comme un poisson dans l’eau. J’ai foncé dans le brouillard, avec mes 31 ans, et une santé qui se retapait de jour en jour. Les jeunes de l’Intrépide, (patronage et société gymnique, sportive et culturelle, rencontres de dialogues et de réflexion), gars et filles, formaient un milieu enthousiasmant. Ils avaient les uns et les autres une équipe de direction dévouée et responsable. Les gars, avec Michel Canart (qui devait hélas ! être victime d’un accident de voiture les années suivantes), les filles avec Marie Françoise Masson. La directrice du patronage, Madeleine Benoist, toujours jeune malgré la cinquantaine passée, connaissait parfaitement tout Nogent et me mettait au courant et à l’aise sur tout ce monde là. Mon rôle était surtout d’être en contact avec tous, de stimuler la liberté de ces jeunes (ce qui était facile) pour créer quelque chose de beau ensemble, dans l’amitié et dans la foi. ( Je me souviens de telle pièce de théâtre, ou désopilante ou émouvante, où l’on voyait la population de Nogent participer à cet élan de la jeunesse). Le chanoine Bonnefoy, l’archiprêtre, qui avait subi quelques moments troublants de l’occupation, était heureux de tout cela. Il m’encourageait vivement dans toute ma part à la vie locale.
L’Union départementale de la Fédération sportive et culturelle de France, dont faisait partie l’Intrépide, nous avait repérés, pour organiser, à Nogent, la reprise après la guerre, d’un concours départemental (Gymnastique, sport, musique etc., avec défilé et manifestations diverses). Si bien que, fin juin et début juillet, il y a eu à Nogent une grande fête populaire, et même avec un feu d’artifice. Les jeunes y ont donné toutes leurs énergies et toute leur vitalité.
Ce qui me parut surtout une réussite, c’est que le lendemain, l’Espérance, la société laïque, et l’Intrépide, la société catholique, se sont retrouvées ensemble dans le parc du concours, pour une journée commune.
J’avais vécu 6 ans de guerre et de captivité, où nous étions tous des camarades, sans que rien ne nous sépare profondément, ni la situation sociale, ni la politique, ni la religion. J’ai rencontré à Nogent une bonne équipe d’anciens P.G., où nous vivions cela avec tous.
J’allais quitter Nogent. J’étais nommé au Foyer de St Martin à Troyes. Mais je savais que cette expérience-là m’avait aidé à faire ce beau passage pour toute ma vie : vivre vraiment le « Aimez-vous les uns les autres de l’évangile », aussi bien tous les jours, que dans les drames de nos vies.
12 - REGARD SUR CE TEMOIGNAGE, DANS NOTRE MONDE EN 2001
I ) Il RAPPELLE LE SENS DU VRAI DIALOGUE ENTRE TOUS LES HOMMES.
A ) Entre compatriotes, entre français, nous sommes appelés à nous considérer tous comme des camarades. Quelles que soient les différences ou les tensions de la vie. Comme dans un moment où il nous arrive un malheur, nous nous sentons plus proches les uns des autres. Entre les deux générations du feu, qui forment notre association, c’est une même camaraderie qui nous unit, malgré les conditions différentes de 39-45, et de la guerre d’Algérie.
B ) Avec les étrangers, à plus forte raison les ennemis qu’étaient pour nous les allemands, nous avons appris à nous respecter, comme des hommes avec qui la paix est à construire, même en y mettant le temps. La loi de la guerre a maintenu cela. On découvre souvent les hommes, dans leur attitude aux heures tragiques ou angoissantes.
II ) Par rapport à nos amis déportés, il faut essayer de comprendre combien la situation se présente psychologiquement bien plus difficile.
Combien faudra-t-il de générations pour refaire un dialogue d’avenir entre des peuples, là où il y a eu les horreurs, qui ont été commises en camp de concentration ! Dans ce cas, même la loi de la guerre n’a pas empêché l’homme de détruire d’autres hommes dans leur fonds d’humanité. On peut dire la même chose entre ce qui concerne la torture entre belligérants.
Il est bon d’entendre cette parole d’Edmond Michelet, qui a été à Dachau, et qui avait une grande foi en l’homme et en Dieu : « Aucun de ceux que j’ai vu mourir ne m’a chargé de le venger ». Seul l’amour construit un avenir. La haine est stérile.
III ) Par contre, les P.G. ont pu entr’ouvrir des liens d’avenir entre l’Allemagne et la France. Notons que nos camarades des stalags ont eu une influence plus grande. Ils étaient mêlés à la population, et parlaient assez vite la langue dans leur vie laborieuse et familiale (J’ai été reçu en Bavière, avec un confrère, dans la famille où il avait été prisonnier. Nous avons été accueillis très amicalement).
De mon côté, j’ai fait plusieurs stages, pour un dialogue franco-allemand, à Cologne, à Berlin, à Darmstadt. C’était très positif, pour bien se comprendre, et pour bâtir ensemble ce que serait l’Europe. Notre vie de P.G. avait été vraiment utile. La connaissance réciproque se développait.
Je retiens cette phrase du philosophe Paul Ricoeur, qui était avec nous à Soest, et qui éclaire tout cela : « Dans les relations entre les hommes, il faut toujours chercher à partager LE FONDS DE BONTE DU COEUR DE L’HOMME ».
J’aime rappeler en terminant, ce MESSAGE proclamé le 23 septembre 1979, au cours d’un grand rassemblement de P. G. à Lourdes, et qui a été retrouvé le 3 mars dernier dans le testament d’un camarade qui venait de mourir, transmis avec émotion par son épouse :
13 - MESSAGE AU MONDE
A vous, jeunes gens et jeunes filles, qui devez chercher votre chemin et de vos mains le construire.
A vous, que l’expérience de la vie a meurtri, trop tôt jetés dans le doute.
A vous, hommes et femmes, qui de par le monde, êtes abreuvés d’épreuves et sur le point de tout abandonner, y compris vos enfants et la vie... nous voulons dire que c’est l’espérance tenace et folle, à certains jours, qui nous a permis d’attendre et d’atteindre la minute historique et vitale où la captivité a basculé dans la liberté.
Aux hommes qui se divisent par la couleur, la langue, les rivalités politiques, sociales, financières, les croyances et les idéologies.
Aux hommes que l’on divise encore davantage, en excitant les divergences jusqu’à la haine...
Aux parents et éducateurs, chargés de transmettre aux jeunes les valeurs essentielles de notre civilisation.
Aux Chefs d’Etat, responsables de leur peuple, de la paix et de la liberté... nous voulons dire que c’est la fraternité et le partage qui nous ont permis de traverser les passes dangereuses et de survivre.
C’est donc l’espérance, et non le désespoir, c’est donc la fraternité et non la haine, c’est donc le partage et non l’égoïsme, qui, seuls, peuvent conduire les hommes jusqu’à la Paix et la Liberté.
Nous, captifs, qui avons souffert et combattu pour garder notre dignité d’hommes, à tous nous disons que seul, l’amour, c’est à dire une vraie fraternité, est capable de fonder une société. L’amour combat, conquiert, pacifie et libère.