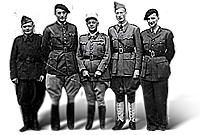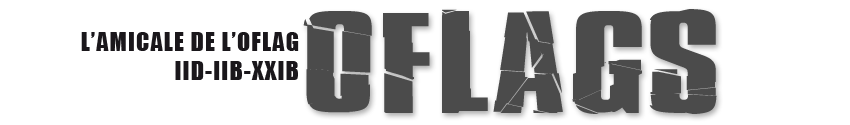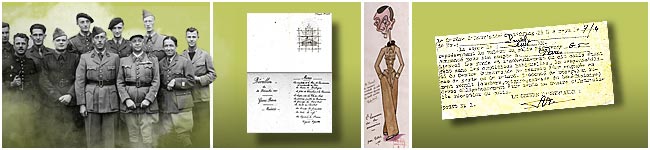"--- Le service des échanges "C’est celui qui fut le plus spectaculaire étant donné l’activité qu’il a déployée et les services qu’il a rendus. "Son but était, avant tout, de normaliser et moraliser les échanges dans le camp.
"Quand on voulut le mettre sur pied, il est bien évident que l’on écarta à priori la notion d’argent, puisque le Centre d’Entraide ne devait pas être une entreprise commerciale, mais un service à la disposition des camarades, moyennant une dîme pour chaque opération, cette dîme allant dans la caisse d’Entraide. "Aprés bien des discussions, il fut décidé que l’unité d’échange serait le paquet de cigarettes contenant 20 cigarettes de troupe ; et encore fallait-il faire la différence entre les "vraies troupes" qui portaient un numéro imprimé sur la cigarette, et les "francisques" qui étaient beaucoup plus mauvaises. Le paquet de cigarettes numéroté fut donc affecté du coefficient 100, autrement dit, il valait 100 points. II ne restait plus qu’à évaluer en fonction de ce paquet de cigarettes - ou plutôt de la cigarette valant 5 points - toutes les autres denrées qui se présentaient pour être échangées : plaques de chocolat, haricots, biscuits, sucre, etc. ... ainsi que vêtements, souliers, montres, lettres, vignettes et cartes. "Chaque semaine, une commission se réunissait qui fixait les cours ---
Il fut d’ailleurs très vite constaté, après les premières semaines de fonctionnement, que ces cours restaient relativement stables". (9) "--- Le Service de Secours, "Quand on commença à parler de distribuer des secours à des familles d’ordonnances, beaucoup répondirent : "les ordonnances gagnent bien assez d’argent avec le trafic qu’ils font avec nous". "Cette réponse était exacte pour une part, car il est bien évident que ceux qui faisaient du trafic ne méritaient pas que l’on vienne au secours de leurs familles, puisque certains, à cette époque, avaient déjà envoyé plus d’un million de francs chez eux ! Mais ils étaient la minorité et bien connus de tous.
Par contre, il y avait à côté d’eux des soldats parfaitement méritants et dont les familles avaient toutes les peines du monde à joindre les deux bouts ! "Quand le Centre d’Entraide parla également de distribuer des secours à certaines familles d’officiers, on poussa des hauts cris en disant qu’avec la délégation de solde et l’argent qui pouvait être transféré du camp sur la solde en Marks, personne ne pouvait avoir besoin d’un secours.
"C’est évidemment ici un sujet sur lequel rien ne peut être divulgué puisque jamais aucun nom de "secouru" n’a été publié, mais il peut être dit cependant que certaines familles d’officiers ont été secourues d’une manière quasi permanente, sans que personne ne s’en soit douté au camp. "--- La caisse d’Entraide était alimentée par les 10 pfennigs du service des échanges, ainsi que par tous les bénéfices réalisés sur les différentes manifestations qui avaient lieu au camp, et notamment par un prélèvement sur le prix des places de spectacle : c’était le droit des pauvres. "Les secours étaient décidés à huit clos par un comité composé du doyen du camp, flanqué d’un officier par bloc, et d’un sous-officier ; ce n’était pas le Centre d’Entraide qui décidait de l’attribution des secours.
"Parallèlement au Centre d’Entraide du camp, se créait à Paris, sous la présidence du commandant Baticle, et grâce à l’activité, au dévouement et à la générosité de Pierard un "Centre d’Entraide de l’Oflag IID-IIB", rattaché à l’organisme central du 68, chaussée d’Antin, devenu depuis l’Union Nationale des Amicales de camps... "
... Ainsi l’action d’entraide put être matérialisée non seulement par l’envoi de secours en argent, mais également par le soutien moral accordé aux familles qui se trouvaient en difficulté" (10). "Mais pour que ces secours soient efficaces, il fallait qu’ils soient donnés très rapidement… Il fallait donc trouver en France un "banquier" un peu clandestin ; et un jour, Glotin écrivit à son frère, à Bordeaux en lui demandant s’il accepterait d’avancer 200 000 francs au Centre d’Entraide, cette somme devant lui être remboursée par l’intermédiaire de la mission Scapini. "La réponse ayant été affirmative, à partir de ce moment, un secours décidé au camp, pouvait être effectivement touché par la famille désignée au bout d’une quinzaine de jours ... " (11)
Ce service de secours d’ ailleurs, dût être largement développé le jour où la mission Scapini, estimant que les camps d’officiers disposaient de ressources financières très supérieures à celles des stalags, eut l’idée de faire parrainer les stalags par des Oflags.
L’Oflag IIB-IID eut alors pour filleuls 8 stalags de la région. Mais pour ce parrainage, il fallait accroître considérablement la contribution de chacun, et c’est encore par le Centre d’Entraide et à son expérience, que revint la réalisation de cet acte de solidarité. Il fut décidé alors de demander à chacun des prisonniers de donner chaque mois le montant d’une journée de solde, soit le 1/30 de la solde mensuelle.
Seuls, dans le camp, trois officiers refusèrent. Par l’intermédiaire de notre "banquier", et grâce à un groupe d’une douzaine d’officiers du camp qui purent envoyer par l’intermédiaire de leurs familles les sommes recueillies - et sans que jamais les allemands n’aient semblé surpris de ce trafic - nous avons donc pu ainsi soulager les situations difficiles des Stalags qui nous avaient été confiés. "
— Service des colis. Autre service du Centre d’Entraide : celui des colis. Pour ce qui concerne les colis collectifs : (Croix Rouge, colis dit "Pétain" ou colis d’Alexandrie) les doyens successifs du camp avaient délégué leur responsabilité au Centre qui s’est chargé de leurs répartitions. Mais, à côté de ces envois collectifs, il y avait un certain nombre de prisonniers dont les familles, pour des raisons diverses, se trouvaient dans l’impossibilité d’honorer les vignettes mensuelles qui leurs étaient adressées. Le Centre d’Entraide a donc recherché et trouvé des sources d’envoi qui pouvaient se substituer aux familles défaillantes et ceci dans la plus grande discrétion, car il était souhaitable d’éviter la gène du destinataire de ces colis vis à vis de ses camarades de popote. "
-- Cuisine collective. A Arnswalde, fut créé par le Centre d’Entraide, pour la plus grande facilité de chacun à utiliser les envois de France, un service qui prit là une place prépondérante : celui de la cuisine collective.
Dans les colis individuels que nous recevions, on trouvait souvent des denrées nécessitant une cuisson :
pâtes, haricots, pois ... etc ... On a évoqué souvent les moyens généralement assez rudimentaires et les instruments primitifs - du genre schubinette (*) -utilisés par les uns ou les autres pour rendre ces denrées comestibles.
Tant que nous étions sur le sable de Gross Born, et que nous disposions d’un peu de bois, malgré quelques difficultés, le problème était relativement soluble. Il en fut tout autrement à Arnswalde, où nous ne disposions que d’un réchaud à gaz par bloc - et encore, le gaz fut-il très rapidement contingenté, quand il n’était pas coupé sous les prétextes les plus divers. Là encore, on s’est tourné vers le Centre d’Entraide qui a trouvé une solution.
"Il fallut d’abord obtenir des allemands qu’ils acceptent de mettre à notre disposition une des marmites qui servaient à faire la soupe de midi. A part la dépense de vapeur, cela ne les gênait guère puisqu’il n’y avait pas de repas le soir et que la main d’oeuvre était française. "Il y eut ensuite à organiser le ramassage des légumes secs ou des pâtes que l’on voulait faire cuire, et surtout à déterminer une équivalence entre les différentes sortes de légumes secs et les pâtes, car il ne pouvait être question de faire deux menus différents : ou bien on cuisait des pâtes, ou bien on cuisait des haricots secs ou des pois cassés mélangés avec des févettes.
"Mais quelle quantité de haricots secs devait correspondre à 250 grammes de pâtes qui étaient l’unité paquet ? "Après beaucoup de calculs et beaucoup de recherches, on arriva enfin à déterminer que 250 grammes de nouilles ou de macaroni, équivalaient à 2 quarts de haricots (nous employons le mot "quart" dans son sens militaire, c’est à dire le quart de soldat qui excluait la pesée, car nous n’avions pas de balance et qui permettait de puiser dans le tas de haricots, quart par quart). Equivalence trouvée, et approuvée, il fallut organiser
un véritable service de ramassage, de corvée et de cuisson. "Dans chaque étage, plus à la compagnie des Ordonnances, fut désigné un popotier, cela en faisait 13 au total, coiffés par le capitaine Clerc, promu à ces hautes fonctions par la création de la cuisine collective. "Les popotiers d’étage commençaient
par passer dans chaque chambre en demandant les denrées que l’on voulait confier à la cuisine collective pour un ou plusieurs repas éventuels. Les 250 grammes de pâtes étaient considérés comme 4 rations, de même d’ailleurs que les 2 quarts de haricots. Ils passaient donc dans chaque popote et marquaient sur un cahier, en recevant les denrées crues, le nombre de rations ainsi portées au crédit de ladite popote. Ce ramassage était fait pour une semaine. "Ensuite, chaque matin, ils passaient dans les chambres et demandaient combien il avait de rationnaires pour le repas du soir, sans qu’ils puissent dire quel serait le menu. C’était toujours une surprise ; et il valait mieux qu’il en fût ainsi car il faut bien reconnaître que, si les haricots étaient excellents, les pâtes l’étaient beaucoup moins .... " ... Quand les denrées étaient cuites, les chambres se succédaient aux alentours de 4 heures de l’ après-midi dans la cuisine, dans un ordre qui changeait chaque jour pour que les premiers servis ne soient pas toujours les mêmes .... " .... Et il ne restait plus à chacun qu’à rapporter dans sa chambre, la marmite contenant les légumes cuits et chauds, et à la placer dans une autre, dite "norvégienne" ; c’est à dire calorifugée .... " ... Cette cuisine collective a fonctionné pendant plus de deux ans, tous les jours, sans heurts et sans à-coups. Elle ne s’est arrêtée que faute de marchandises, puisque dans les derniers mois avant notre départ pédestre, les colis se faisaient de plus en plus rares, les popotes ne pouvaient plus donner qu’ une ou deux fois par semaine des denrées à cuire .... " (12)
Pour mémoire, enfin, citons quelques uns des autres services mis sur pied et rendus par le Centre d’Entraide : celui des objets trouvés par exemple - ceux-ci tarifés à 10 pfennigs - a pu disposer rapidement d’un stock important d’objets égarés et non réclamés : brosses à dent, mouchoirs, calots etc. .... Pour leur liquidation, on a eu recours d’abord à des ventes aux enchères, puis à une idée originale d’Alexandre qui a organisé, dans un bassin situé au centre du camp, un concours de pêche qui a eu un grand succès. Il y eut aussi un service de réparation de montres. Enfin, à chaque arrivée de camarades provenant d’autres camps, le Centre d’Entraide a organisé leur réception, en demandant quelles popotes pourraient, le premier soir, accueillir un ou plusieurs des nouveaux arrivants. Et Duquesne conclut : "Nous croyons que l’organisation du Centre d’Entraide de l’0flag IIB-IID, avec ses ramifications en France, a été le seul organisme du genre, ayant existé dans les camps de prisonniers de la guerre 1940-1945. Il y a eu certes partout des organisations d’entraide, mais il semble que nulle part, sauf là, on n’ait eu l’idée de pratiquer l’entraide autrement que par des dons en espèces ou en nature.
Ce fut le secret de la popularité de ce Centre d’Entraide que d’avoir réussi, dans tous les domaines où son activité a pu s’exercer, à établir en quelque sorte, des services publics entièrement bénévoles" .(13)
|