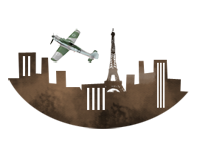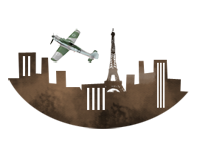Le 28 janvier 1945, à Arnswalde, les officiers de l’Oflag II B s’affairent. Ils ont compris que les allemands,
en raison de l’avance des armées russes en Poméranie, vont les faire partir vers l’Ouest, à pied.
Ils se mettent donc à préparer sacs à dos, musettes et valises et aussi à fabriquer des luges avec des planches
de leurs châlits en raison du temps neigeux qui sévit. Ils choisissent les vêtements qu’ils emporteront.
Ils cherchent, en sacrifiant le plus d’objets et de documents possible, à alléger leurs bagages. Ils ne retiennent que ce qui leur est le plus précieux et surtout les vivres les plus essentiels. Et le 29 janvier, réveillés à 4 heures du matin, rassemblés à 6H30, ils reçoivent, chacun, un pain et 4 centimètres d’une sorte de saucisson,
la Wurst, peu appétissant. Ils sont invités à regrouper dans le gymnase tout ce qu’ils ne peuvent emporter.
Après bien des difficultés soulevées par les allemands, une quarantaine d’officiers malades, qui ne peuvent
se déplacer à pied, sont autorisés à rester dans un des bâtiments du camp après le départ de leurs camarades.
En fin de matinée, trois colonnes d’environ 900 officiers chacune quittent successivement le camp,
encadrées de sentinelles armées et traversent lentement Arnswarlde, sous la neige. Ces trois colonnes vont alors suivre, d’abord, des itinéraires à peu de chose près identiques passant par Pyritz (*) (actuellement Pyrzyce), Sabow (actuellement Zabow), le pont de l’Oder, sur 1’autoroute contournant Stettin (actuellement Szczecin) par le sud, Krackow, Baumgarten, Falkenhagen, Göhren, Gross-Dratow, Waren. Dans cette ville,
environ
la moitié des officiers d’Arnswalde seront embarqués dans un train qui les amènera à Bremervörde.
De là, ils se rendront à pied au camp de Sandbostel. Puis, partie en train, partie à pied, ils seront envoyés
au camp de Wietzendorf pour être enfin installés, le 22 avril 1945, dans la ville de Bergen. Les autres officiers de l’Oflag II B quitteront Waren à pied et poursuivront leur route par Stepenitz, Wittenberge, Sanne.
Ils arriveront ainsi à Salzwedel après avoir parcouru 466 kilomètres à pied. Ils seront alors embarqués en train pour arriver le 19 mars 1945 à I’ Oflag VI A de Soest. Tous ces déplacements furent effectués sous
le commandement des officiers allemands d’ Arnswalde et avec un encadrement de soldats allemands disposant de leur armement individuel complété par quelques mitrailleuses. Les menaces avec des pistolets ou des fusils ne manquèrent pas, chaque fois qu’une tentative d’évasion était décelée où qu’un ordre était discuté
ou transgressé ; quelques coups de feu furent tirés. A un seul moment, à l’est de l’Oder, lorsqu’il apparut
que les unités russes n’étaient pas loin de Pyritz et pouvaient encerc1er les colonnes, les sentinelles relâchèrent quelque peu leur brutalité, craignant pour leur propre sort. Mais après le passage de 1’0der l’encadrement allemand reprit toute sa dureté. En contre partie, quelques civils allemands eurent, parfois, des gestes
de compassion mais ceux-ci furent rapidement arrêtés par les réactions des sentinelles.
En sortant de la caserne d’ Arnswalde, il fut possible de découvrir la situation réelle de l’Allemagne.
A l’est de 1’0der se trouvaient des unités en état de combattre mais on rencontrait aussi, des hommes manifestement en pleine retraite. A l’ouest du fleuve, s’allongeaient des colonnes de réfugiés, s’éloignant
avec leurs familles et quelques biens entassés sur des chariots. L’activité aérienne alliée était soutenue
et les effets des bombardements, dans les villes et dans les gares en particulier, devenaient de plus en plus spectaculaires au fur et à me sure de la progression vers l’ouest. Une des premières causes des souffrances subies pendant ce retour fut la rigueur du climat de l’Allemagne du nord. En Poméranie même, tempête de neige, verglas puis dégel rendirent les premières étapes excessivement pénibles. La température, pendant plusieurs jours, varia de moins l0 à moins 15 degrés. Le vent était glacé. La marche était extrêmement difficile, provoquant une grande fatigue dans des organismes déjà affaiblis par un manque de nourriture prolongé, pendant les 5 deniers mois à Arnswalde. On se traînait, on glissait, on tombait. Au dégel, il devint impossible d’utiliser les luges. Il fallut donc prendre sur le dos la partie la plus précieuse qui se trouvait sur ces dernières, essentiellement les vivres et abandonner le reste, courrier, documents fruit des travaux effectués au camp, objets divers, sur le bord du chemin. Après 1’0der, le temps fut plus supportable mais le vent fut souvent particulièrement froid, le gel réapparut momentanément et quelques averses posèrent le problème du séchage des vêtements trempés pour lesquels il n’y avait pas de possibilité de rechange. A ces conditions climatiques sévères s’ajouta le fait que la quasi-totalité de l’itinéraire parcouru à pied évita les grandes routes.
Il fallut marcher sur des chemins de terre, souvent boueux quand ils n’ étaient pas couverts de neige, parfois
à travers champs, à plusieurs occasions sur des voies ferrées ou I’espacement des traverses n’était pas régulier.
Les déplacements furent ainsi particulièrement épuisants. Quant aux cantonnements retenus
par les allemands, à chaque fin d’étape, ils furent à une ou deux exceptions près, spécialement déplorables.
Ne furent disponibles que des granges parfois très vastes, mal fermées, dans lesquelles durent s’engouffrer
des effectifs trop importants. Il en résulta des entassements incroyables, ne permettant pas de trouver le repos indispensable et rendant la promiscuité souvent irritante. A plusieurs occasions, une partie des colonnes dut passer la nuit à la belle étoile, sans abri, par des nuits glacées. Par ailleurs, ces cantonnements ne possédaient pas d’installations sanitaires. Les tas de fumiers étaient les seuls endroits où il était possible de se soulager,
alors que les cas de diarrhée étaient nombreux. Les cours de ferme devinrent ainsi, la plupart du temps, de véritables cloaques. En outre, faute de points d’eau suffisants, il n’était pratiquement pas possible, dans la majorité des cas, de se laver ; même l’eau potable manquait et la soif commença à se faire sentir à plusieurs occasions. Enfin, tout au long du parcours, la nourriture fournie par les Allemands fut totalement insuffisante.
Elle comprit un peu pain, des pommes de terre parfois avariées, mal cuites, peu nombreuses, une quantité infime de margarine, des brouets particulièrement liquides. Au bout d’un certain temps, une équipe
de prisonniers put prendre en main la préparation et la distribution de ces semblants de repas qui ne dépassaient pas, si ils les atteignaient, 1000 calories par jour. Cette mesure permit au moins de tirer un rendement maximum des rations insuffisantes fournies par l’encadrement allemand. II y eut, heureusement, pour lutter contre la faim qui commença à se faire sentir des le passage de 1’0der, deux circonstances favorables. La première fut la possibilité d’obtenir des Russes ou Polonais rencontrés dans les fermes, du pain
et du lard, en échange de cigarettes et surtout de montres, à des taux variables selon les circonstances.
La seconde fut la distribution d’un colis de la Croix Rouge à chaque officier, le 23 février. Ces colis furent particulièrement appréciés parce qu’ils apportaient un complément indispensable à la nourriture journalière mais aussi parce qu’ils permirent quelques trocs particulièrement avantageux. Quoiqu’il en soit,
les efforts physiques imposés par les Allemands, d’une part, la sous-alimentation prolongée, d’autre part,
rendirent rapidement inquiétant l’état sanitaire de la plupart des officiers des colonnes en marche vers l’ouest.
Les pieds de nombre d’entre eux furent douloureusement blessés. La dysenterie toucha presque tout le monde
et ne fut disponible qu’un seul remède, le charbon de bois fabriqué à chaque étape avec du bouleau ou de l’aulne. Les pertes de poids se généralisèrent. Et, malgré le dévouement et la compétence des médecins présents dans les colonnes, d’ailleurs démunis de tous moyens d’urgence, le nombre des malades ne pouvant plus effectuer les marches qui s’étalaient de 8 à 30 kilomètres par jour, ne cessa d’augmenter rapidement.
Les allemands essayèrent, avec brutalité, de ramener les traînards dans les rangs. Ils firent parfois partir
les malades avant les autres pour qu’ils puissent effectuer les parcours prévus lentement.
A d’autres occasions, ils mirent ces derniers sur des chariots. En fait, les plus touchés connurent un véritable calvaire. Quant aux trajets en train, ils furent moins pénibles que la marche mais ils ne furent
pas très confortables. Dans les wagons de voyageurs, les allemands imposèrent des effectifs incompatibles
avec les places normales disponibles et dans les wagons de marchandises ils dépassèrent largement la norme
des 40 hommes ; mais d’une part, ces déplacements furent courts (2 a 3 jours) et, d’autre part,
ils annonçaient la fin du voyage et c’était une raison de ressentir un réel soulagement. En fait, cette fin ne fut exempte ni de surprises, ni de désagréments, ni d’émotions, aussi bien pour ceux qui débarquèrent
à Bremervörde le 26 février 1945 que pour ceux qui arrivèrent à Soest, le 19 mars. Les premiers eurent d’abord à effectuer une marche d’environ 15 kilomètres pour atteindre le camp de Sandbostel. Ils y trouvèrent des baraques en mauvais état, sans lits, avec des cabinets bouchés, dans un environnement sale et boueux.
Ils prirent contact avec des sous officiers français envoyés dans ce camp parce qu’ils avaient refusé de travailler pour les allemands. aperçurent des prisonniers polonais, serbes, italiens, tristes, exténués.
Ils apprirent qu’à l’Oflag de Nienburg, situé à environ 160 kilomètres au sud de Sandbostel, 90 officiers français avaient été tués au cours d’un bombardement aérien. Ils furent soumis à un épouillage en règle.
En un mot, ils souffrirent du froid, de la saleté, de la lassitude, de la sous-alimentation. Le 5 mars, ces officiers repartent pour Bremervörde, y prennent le train pour Soltau et, de là, partent à pied pour Wietzendorf.
Ils sont installés dans des baraques sombres, sans lits, à 54 par chambre, à coté d’un camp d’italiens.
Puis les allemands leur fournissent des châlits à 2 étages. Ils vivent dans I’humidité, la moisissure, les odeurs nauséabondes, la saleté, les déchets, les gravats. Les waters sont insuffisants. Les alertes aériennes
sont fréquentes. Chacun se recroqueville pour lutter contre le froid, se sent vaincu par le dénuement.
En contrepartie, I’encadrement allemand d’Arnswalde est remplacé par un autre, plus coulant.
La discipline se relâche. En fait, l’immobilité ne procure aucun repos ; la fatigue reste grande et la lutte contre les rats, les puces et les punaises est permanente. Quant à la nourriture elle est, comme toujours, insuffisante.
Cette sous-nutrition provoque le décès d’un prêtre, le père Barba. Dans cette ambiance, toutefois,
deux évènements heureux se produisent : d’abord, l’arrivée de colis américains qui permettent, comme les colis de la Croix Rouge de Waren, de fournir un heureux complément d’alimentation, mais aussi d’effectuer quelques trocs utiles avec les italiens, possesseurs des objets les plus divers ; en second lieu, I’ avance des troupes anglaises vers le nord et vers l’est. D’ailleurs, les combats s’approchent, en fait, de Wietzendorf et le 16 avril,
les officiers allemands de l’encadrement, sauf un, partent pour le front. Les prisonniers sont ainsi virtuellement libres et les sentinelles sont désarmées. Mais le 17 avril deux sections allemandes arrivent au camp,
réarment les sentinelles puis s’en vont. Et ce n’est que le 21 avril que le colonel français responsable du camp est appelé à négocier une suspension d’armes de quelques heures entre anglais et allemands.
Le 22 avril, les français valides font 20 kilomètres à pied pour atteindre Bergen ou les rejoindront plus tard
les malades laissés provisoirement sur place. Les anglais les installent alors dans les maisons de la ville à la place des habitants. Ceux-ci en ont été expulsés en deux heures par les britanniques, après que ces derniers aient découvert l’existence du camp de concentration de Belsen. L’horreur des atrocités commises dans ce camp situé à quelques kilomètres de Bergen, les a révoltés. Enfin libérés, les officiers français de Bergen peuvent
alors bénéficier des produits alimentaires trouvés en abondance sur place et remplacer leurs vêtements
en mauvais état. Ils doivent attendre encore quelques jours avant un rapatriement définitif.
Mais ils découvrent à leur tour le sort atroce des déportés de tous âges. Ils sont bouleversés. Dès la fin avril,
et au cours de la première quinzaine de mai, les retours en France ; tant attendus, s’effectuent par convois successifs, en camions, en avion, par le train jusqu’ à Lille ou Valenciennes. Pour ceux de Wietzendorf,
la captivité est alors vraiment terminée. Pour ce qui concerne les officiers d’Arnswalde envoyés à Soest,
la libération s’est présentée d’une façon plus simple, avec, malgré tout, quelques émotions.
Ils sont arrivés dans un Oflag, le VI A, très organisé, situé dans une caserne importante. Ils ont dû s’installer, tant bien que mal, dans les combles des bâtiments, sans châlits, avec peu de paille, dans un environnement
pas très propre. Comme ailleurs, ils n’ont reçu qu’une nourriture insuffisante. Ils se sont partagés
les épluchures de rutabaga et les rognures de betteraves. Pour eux, la faim fut loin d’être jugulée.
Mais l’organisation existante leur permit de se reposer. Des activités diverses, des réunions leur donnèrent
la possibilité d’occuper leurs journées. D’autre part, ils apprirent la prise de Mayence et de Sarrebrück
et les alertes aériennes étaient fréquentes, preuves que les opérations militaires se déroulaient favorablement.
En fait, le 30 mars, Soest était encerclée par les américains. Ces derniers exécutèrent un tir d’artillerie
sur le camp, le 5 avril, tuant 21 russes et en blessant 17. Ils recommencèrent le 6 avril, causant la mort
de 11 français dont plusieurs officiers. Puis, ce même jour, enfin avertis de leur erreur, ils pénétrèrent
dans 1’0flag VI A, à 8 heures du soir. Pour les prisonniers de Soest, la libération était enfin acquise
et
un ravitaillement important était assuré à la fois par la logistique américaine et par les abondantes ressources alimentaires de la ville. Le 16 avril, le rapatriement par avion commença et se poursuivit jusque
vers le 25 avril, amenant environ 4000 officiers jusqu’au Bourget dont environ 800 venant d’Arnwalde. Particulièrement satisfaits de cet heureux dénouement, pensant que ceux qu’ils avaient quittés à Waren connaissaient un destin comparable au leur, ils ne pouvaient cependant pas oublier que certains de leurs camarades leur avaient faussé compagnie à l’Est de l’Oder. Or ceux-là avaient connu des aventures bien différentes des leurs. L’un d’eux sortit de sa colonne près de Pyritz. Il prit contact avec les avant-gardes russes passa l’Oder à Francfort sur Oder, contourna Berlin par me Nord. Arrêté par les allemands après de nombreuses péripéties, il rejoignit finalement une colonne et termina sa captivité à Bergen. Les malades, une quarantaine, qui le 29 janvier, restèrent à Arnswalde, commencèrent par se nourrir correctement avec les vivres disponibles dans le camp. ’Puis ils assistèrent pendant 14 jours, terrés dans les caves, à de violents bombardements et à des combats sévères qui aboutirent à la destruction d’une partie des bâtiments
de l’Oflag IIB ainsi qu’une grande partie de la ville d’ Arnswalde. Délivrés par les Russes, ils furent évacués
par ces derniers sous un tir d’artillerie allemand, à pied et en camions, vers l’Est, en passant par des villages détruits, par un froid glacial. Un de leurs camarades, gravement malade, décéda en cours de route.
Ils arrivèrent ainsi à environ 14 kilomètres du camp. Fractionnés en plusieurs groupes, ils se dirigèrent vers Lublin, à environ 500 kilomètres au sud-est, en partie en profitant de camions russes disponibles ou par voie ferrée, en suivant des itinéraires apparemment fantaisistes. Ils arrivèrent ainsi dans un camp immense.
Partis de là en train, ils arrivèrent dans un hôpital à Odessa le 28 mars et le 5 avril ils débarquèrent
à Marseille. Par ailleurs quelques officiers eurent une aventure moins heureuse. Ils réussirent certes à quitter
la colonne ou ils se trouvaient, avant I’Oder. Mais ils furent rapidement repris par les allemands.
Ceux-ci les amenèrent à Stettin en camions et les embarquèrent en train pour les faire rejoindre une colonne
en marche vers 1’0uest. D’autres réussirent à échapper à ce sort malheureux. Il semble que l’on puisse évaluer leur nombre à environ une centaine. Ceux-là réussirent, comme les précédents, à sortir des rangs,
malgré les sentinelles, soit en exécutant une décision mûrement réfléchie, soit en profitant d’une occasion favorable, soit en raison d’un état de santé empêchant une marche exténuante et prolongée.
Les uns et les autres eurent à effectuer, à partir de la région de Pyritz, des parcours difficiles et parfois pittoresques. D’abord, ils durent se cacher tant bien que mal, alors qu’il neigeait et qu’il faisait particulièrement froid, pour éviter d’être repris par des patrouilles allemandes éventuelles.
Ils assistèrent ensuite à des combats plus ou moins violents entre les unités allemandes en retraite et les premiers échelons russes. Certains d’entre eux, peu nombreux sans doute, participèrent même à des combats acharnés. De toute façon, tous éprouvèrent quelques émotions à l’arrivée, sur eux, des premiers soldats russes, souvent prompts à tirer. Ils purent constater que les unités de combat russes étaient correctement organisées
et équipées, que les officiers russes à tous les échelons étaient très jeunes, que les cadres et la troupe faisaient preuve d’une grande détermination, que la pitié envers les allemands n’ était pas leur fort.
Ils furent impressionnés par le caractère de horde des formations de deuxième échelon, d’ou l’insécurité qui pouvait résulter de cet état de fait. Assez rapidement, dans leur marche vers l’Est, les petits groupes d’officiers d’Arnswalde se rencontrèrent et se regroupèrent. S’agglutinèrent à eux, au hasard des étapes ou sous la pression des russes, des personnages de toutes provenances et de toutes catégories : prisonniers des Stalags, travailleurs rassemblés en Allemagne par le IIIè Reich, soldats enrôlés par ce dernier dans toute l’Europe, femmes seules ou mariées, représentant toutes nationalités, américaine, anglaise, italienne, polonaise, yougoslave, ukrainienne, française. Sur I’injonction des russes, les uns et les autres furent ainsi regroupés
dans des camps importants dont l’ effectif atteignit jusqu’ à 8 à 10.000 hommes qui y séjournaient parfois plusieurs semaines. Sous la pression des événements et aussi sur la demande des russes, des officiers français anciens prisonniers furent ainsi amenés à encadrer ces rassemblements hétéroc1ites, avec l’aide précieuse
de prisonniers des Stalags. Il s’agissait rapidement d’assurer un minimum d’ordre, un ravitaillement suffisant, la confection des repas, parfois I’habillement, avec les moyens limités fournis par les Russes.
Il fallut faire assurer les corvées concernant la lutte contre la saleté, un minimum d’hygiène, et de soins médicaux mais aussi, en Pologne en particulier, des travaux agricoles ou de terrassement et parfois
des manutentions de munitions, sans oublier une participation à l’exécution des déplacements en camions
ou en train. Toutes ces taches prises en charge par les officiers, se révélèrent difficiles et lourdes,
quelquefois mal comprises par une partie de ceux qui se trouvèrent ballottés en Pologne et en Ukraine.
Il est vrai que la vie de ces derniers comporta de réels problèmes. Le premier fut celui de la nourriture.
Certes, elle fut assez facile à trouver auprès de la population allemande restée sur place,
tant que les regroupements restèrent limités. La réquisition d’office ou le troc suffisait. Mais ensuite,
les Russes ne purent fournir qu’en quantités insuffisantes les vivres nécessaires dans les grands rassemblements et le millet ou le chou distribués en permanence ne pouvaient satisfaire tout le monde. Peu à peu la faim se mit à tirailler les estomacs. En second lieu, les déplacements furent sou vent très pénibles, qu’ils aient été exécutés
à pied, en chariot, en camions ou en train, parfois dans des wagons à ciel ouvert. En plus, ces déplacements suivaient des itinéraires et des horaires inattendus, cocasses ; ils étaient donc sources d’irritation, d’impatience, de fatigue. En troisième lieu, les comportements des russes étaient très souvent imprévisibles, incompréhensibles. Capables de grands gestes de fraternisation, ils avaient aussi des exigences brutales,
des commentaires vexants, que ce soit pour récupérer des montres ou autres objets ou vêtements, avec frénésie, ou pour imposer des consignes draconiennes, ou encore exiger des organisations manifestement inadaptées.
Il ne fut donc pas toujours facile de s’entendre avec eux, bien que des officiers de l’Oflag II B aient pu tisser
avec certains d’entre eux des liens de réelle amitié et recevoir de ceux-ci des marques d’estime précieuses.
Enfin, les personnels à rapatrier comprirent un nombre non négligeable de femmes : allemandes ou autres, mariées à des français ; femmes seules arrivées en Allemagne pour différents motifs ; femmes d’origines diverses essayant d’aller en France. Au milieu d’une masse d’hommes, elles posèrent des problèmes.
C’est ainsi que dans un centre de rassemblement important, elles furent regroupées dans une compagnie placée sous le contrôle d’un des officiers d’ Arnswalde, pour pouvoir régler plus facilement les difficultés
qu’elles suscitaient. Face à toutes ces conditions de vie pénibles, deux activités méritent d’être mentionnées.
D’une part, la religion ne fut pas oubliée et des prêtres purent célébrer assez souvent la messe.
D’autre part, dans les centres de rassemblement et même dans certains trains, furent présentés par les russes, mais aussi par des prisonniers libérés, des concerts, des spectacles de danse, des sketches et, à Odessa, des opéras.
Ainsi, peu à peu, les anciens d’Arnswalde avancèrent vers leur rapatriement. Certains passèrent par Vilno
puis Odessa, ce qui leur permit un retour par bateau qui les amena à Marseille le 10 juin 1945.
D’autres allèrent jusque dans les marais du Pripet pour revenir vers l’Ouest, pour se retrouver, via Magdeburg, à Paris à la fin du mois de juillet. C’est dire que tous ceux qui empruntèrent la voie des russes parvinrent
en France 3 mois après ceux qui transitèrent par Soest. Il leur fallut beaucoup de patience pour attendre,
pendant de longs jours, dans des conditions précaires, leur retour. Mais ils bénéficièrent, auprès des russes, d’une expérience exceptionnelle. En tout cas, 5 ans après les jours sombres de 1940, il restait,
pour tous les officiers de l’Oflag II B, de l’Oflag II D, des souvenirs qu’ils n’étaient pas près d’oublier.
|