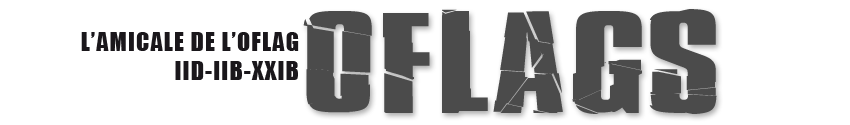Depuis la mi-septembre 1939, les douze Compagnies du Régiment, étalées sur un front de 40 à 50 kilomètres ont peiné rudement, sans repos et sans gloire.
Sans aucun des moyens mécaniques dont l'ennemi était si richement doté, sans autre outillage que la pelle, la pioche et la barre à mine nos pionniers ont creusé des kilomètres de fossés antichars ou de canalisations téléphoniques, planté des hectares de réseaux barbelés, coulé des blockhaus et laissé la trace profonde de leur patient effort tout au long de la frontière, de Charleville à Rocroi et de Maubeuge à Valenciennes.
Lorsque s'est déclenchée l'offensive allemande il y avait encore, tant sur le front des Ardennes que sur celui du Nord, de nombreuses fissures mais aucun des anciens, de ceux qui avaient vécu Verdun, notamment, ne doutait qu'on ne puisse résister des semaines et des mois aux assauts les plus redoutables et aux moyens mécaniques les plus modernes.
Si toute cette organisation formidable s'est lamentablement écroulée en quelques jours le courage et le moral de nos troupes, mêmes inférieurs à ceux de la grande guerre, ne sont pas seuls en cause. Cette débâcle a d'autres causes profondes, diverses et multiples.
Celui qui n'a été qu'un acteur obscur et de second plan de ce grand drame de l'histoire ne peut que rapporter honnêtement, fidèlement ce qu'il a eu sous les yeux. C'est ce qu'il fait. A d'autres de faire, de milliers de témoignages semblables, une vaste synthèse, de dégager les causes profondes, d'établir les responsabilités et d'en tirer pour l'avenir et la génération qui suit des enseignements féconds.
Nous sommes aux premiers jours de Mai. Trois semaines auparavant, une alerte nous a tenus sous pression durant 5 ou 6 jours. Le bruit, alors, a couru, que nous allions être postés en avant pour occuper, préventivement, le Canal Albert, cette ligne d'arrêt formidable mais qui ne vaut que par la qualité des troupes chargées de sa défense. Puis les jours ont passé, l'alerte a pris fin, tout est rentré dans l'ordre et chacun de dire, parmi nous : "c'est une partie remise et une occasion manquée, lorsque l'Allemagne attaquera la Belgique, nous arriverons trop tard !"
La 5ème et la 8ème Cie après avoir achevé leurs travaux aux abords de la Longueville ont glissé vers la gauche du secteur du Corps d'Armée en lisière de la célèbre forêt de Mormal.
La 5ème Cie a pris ses cantonnements au début du mois dans le petit village d'Amfroipret et au Cheval Blanc à 6 km de Bavay. C'est à Bavay que s'est installé l'Etat-major du Bataillon, Bavay la ravissante et antique cité de la reine Brunehault, au centre de la petite ville une série de grandes routes, toutes droites, empruntant, toutes, le tracé des voies romaines, ces autostrades de l'antiquité.
C'est dans ce cadre champêtre et riant, riche en pâtures et en arbres fruitiers, que nous allons prendre brusquement le départ pour la grande aventure. Nous pressentons tous qu'elle sera redoutable mais personne ne doute que nous n'en sortions vainqueurs !
Vendredi 10 Mai
Aux premières heures du jour la TSF propage la nouvelle de l'invasion de la Belgique et de la Hollande. Le fermier chez lequel je loge me guette, au sortir de ma chambre, pour m'en faire part.
Malgré l'heure matinale la Compagnie a déjà quitté le cantonnement ; elle est aux douches à Bavay. Je pars aussitôt l'y rejoindre en bicyclette. Six kilomètres, à toute allure, dans la fraîcheur du matin et j'arrive à l'usine Derome où sont installées les douches. Dès en arrivant je constate de l'inquiétude et de l'agitation dans le personnel. Nos hommes connaissent la nouvelle : déjà le Capitaine Danglard a fait savoir à la Cie qu'elle devait rejoindre au plus tôt son cantonnement. Je tiens cependant à faire terminer les douches. Je prends la mienne le dernier, charge l'adjudant François de ramener le détachement et file au bureau du Bataillon où je retrouve Danglard et le Lt Huet. Ils me confirment les informations de la TSF. Déjà l'alerte n°3 aété donnée, le dispositif "Dyle" joue, et nous devons décoller, le soir même, sur le circuit S2, dans le sillage de la Division Marocaine.
Je rejoins en hâte le Cheval Blanc où le Lt Druet m'attend pour déjeuner, impatient et inquiet. Le ménage belge chez lequel nous prenons nos repas fait peine à voir ; le mari doit rejoindre son centre mobilisateur sans délai. Pendant que nous déjeunons des chars défilent déjà sur la route du Quesnoy en direction de Bavay, échelonnés de 50 m en 50 m. Tintamarre assourdissant et grosse impression de puissance ; c'est ce que nous avons de plus moderne comme matériel.
J'écris quelques lettres. C'est la grande aventure qui commence et il est bon qu'on ne s'inquiète pas, outre mesure, si le courrier se fait rare ou moins régulier. Je surveille ensuite les préparatifs du départ, le chargement des voitures et je vais à Gommegnies, prendre les ordres du Colonel Vendeur du 7ème Marocains avec lequel nous devons marcher.
A 20 h. la Cie est rassemblée à la sortie du village avec la Cie Druet, la 8ème. A 21 h. le bataillon tout entier prend place dans la colonne du 7ème RTM qui s'ébranle en direction du Nord.
La nuit est claire, sereine, une belle nuit de Mai mais la route est longue, le chargement pesant et l'allure des Marocains trop rapide pour nos lourds pionniers. Déjà les chemins pavés font leur apparition et c'est une rude épreuve pour les pieds. Dans le lointain et le silence de la nuit, bruits de convois, roulement confus : par toutes les routes praticables c'est une armée entière qui déferle vers la Belgique.
Vers minuit nous traversons la frontière, sans plus de cérémonial qu'un simple passage à niveau. Des Civils à brassards et des douaniers nous y accueillent très simplement et nous repartons de l'avant. Aussitôt après la frontière nous atteignons une grande forêt dont la traversée nous demande plus de deux heures et dont le mystère impose silence aux conversations ; des rossignols, que le passage de la colonne ne semble pas impressionner, chantant éperdument.
Samedi 11 Mai
Lorsque nous atteignons le gros bourg d'Eugies, terme de notre première étape le jour se lève. Des civils, pour la plupart vétérans de la grande guerre, nous guettent au passage pour nous guider vers nos cantonnements respectifs. La 5ème Cie occupe une Ecole de filles dont les classes ont été débarrassées de leur matériel et dont les planchers sont nus. Les fourgons et les roulantes s'échelonnent sur le trottoir. Petit à petit le village s'éveille, des fenêtres s'entrouvrent, des visages intrigués apparaissent. Première vision de la Belgique d'une Belgique encore heureuse et paisible. La Cie casée et le jus servi je me fais conduire à la chambre qui m'est attribuée. Mes hôtes sont déjà levés et m'attendent, malgré l'heure matinale. Réception chaleureuse, petit déjeuner copieux, conversation animée. On tient à fêter dignement le premier officier français de passage. Le mari est très fier d'une ressemblance effectivement assez marquée avec le Pt Lebrun ; son épouse, par certains détails et son exubérance me rappelle Madame Hausser. Chambre toute blanche, confortable, méticuleusement propre, avec vue sur le petit jardin aux tulipes. Et, maintenant, quelques heures de sieste bienfaisante.
Midi. Je ne me sens pas le courage d'aller rejoindre les camarades rassemblés à l'autre bout du village. Il en est de même du Lt Druet, mon voisin. Nous trouvons sans peine un petit restaurant voisin qui nous prépare à déjeuner. Nous essayons de prendre le communiqué en TSF ; rien à faire, toutes les émissions doivent être brouillées.
Aussitôt après il faut préparer l'étape de la nuit suivante. Je m'installe dans la salle à manger de mes hôtes pour étudier notre itinéraire et l'ordre de marche qui m'a été remis. Dans la pièce voisine, ronflements puissants ; je passe la tête sans bruit et je vois le Caporal Bresson affalé dans un fauteuil du salon et qui récupère sans discrétion. Pour terminer l'après-midi, goûter et bavardages avec nos deux braves belges. Nous prenons, cette fois, notre dîner en commun dans une maison particulière où l'on s'est fait un plaisir de nous recevoir. La demoiselle de la maison qui nous sert, a peine à cacher son émotion, une émotion qui nous surprend un peu. Lorsque nous partons elle reste sur le pas de la porte et nous crie " je prierai pour vous tous, bonne chance !".
A 21 heures, toutes les Cies sont groupées au Carrefour de l'Eglise et la montée vers le Nord reprend. Danglard m'a confié la surveillance du convoi des voitures groupées en queue de la colonne. Nombreux coups de gueule pour mettre de l'ordre dans le convoi et stimuler les conducteurs. La route est dure, les grandes routes sont réservées aux convois autos et aux divisions motorisées. A nous les chemins détournés, étroits, tortueux, affreusement mal pavés. Tout l'itinéraire est parfaitement balisé ; les petites lanternes cubiques à lumière diffuse, posées au ras du sol semblent autant de gros vers luisants dans l'herbe et jalonnent les tournants et les carrefours.
La marche se poursuit de plus en plus pénible. Au fur et à mesure que nous progressons, les unités commencent à se mélanger et déjà nous dépassons quelques traînards. Notre colonne est fréquemment coupée par des convois autos, nous n'avançons plus que par à-coups.
Dimanche 12 Mai
Lorsque nous atteignons Bracquegnies, notre point de destination, il fait déjà grand jour ; il y a dix heures que nous marchons. Les derniers kilomètres semblent interminables. Les Cies débouchent enfin sur la place de l'Eglise, après avoir traversé le canal. Je ne puis m'empêcher, au passage, de dire assez vertement ce que je pense au Sergent Fauvel qui, frais et dispos, au volant de sa voiture, contemple, le sourire aux lèvres, le défilé des hommes harassés.
Ma Cie échoue dans un patronage. Les hommes, au fur et à mesure qu'ils arrivent, s'affalent dans la cour, se déchaussent, contemplent leurs pieds meurtris et blessés. La plupart s'endorment sur place, à même la terre, séance tenante.
Ici, premières traces de la guerre et du passage des avions. Quelques bombes qui visaient la voie ferrée se sont égarées, la veille, sur les maisons voisines. La maison où je suis invité, spontanément, à venir prendre un café chaud, n'a plus de vitres et des éclats sont venus y blesser grièvement une jeune fille ; un lambeau de chair que l'on me montre est resté collé au plafond.
Nous circulons un instant en ville, Danglard et moi, et nous nous heurtons à un groupe d'officiers belges, les premiers que nous rencontrons depuis notre entrée en Belgique. Présentation, accueil très cordial, apéritif. Pas de renseignements précis sur la situation. Nous déjeunons, tous réunis, au restaurant. Je vais ensuite dormir quelques heures chez le coiffeur de la grande rue où ma chambre a été retenue et où Delarue a déjà déposé mon barda. C'est une sage précaution car nous passerons encore la nuit prochaine sur la route.
Quelques alertes en cours d'après-midi. J'ai peine à réaliser que c'est aujourd'hui Dimanche et fête de Pentecôte. A quatre heures le coiffeur et sa femme m'offrent à goûter et déplorent que je ne sois pas venu déjeuner avec eux, ils comptaient sur moi à leur table. Leur fils est là, un bambin de dix ans très fier de son calot de soldat belge, qui m'observe et me détaille avec intérêt.
A 21 heures, départ. Aussitôt après avoir quitté Bracquegnies nous traversons Frameries, petite ville toute en longueur. La population, très dense est sur le pas des portes et le long des trottoirs et nous regarde défiler en silence. Nous gagnons la campagne. Le balisage se poursuit, nous épargnant toute hésitation quant à la route à suivre. Les étapes avec la fatigue accumulée et le manque de sommeil deviennent de plus en plus pénibles. Je renonce à marcher seul, je marché tantôt avec Tourgis, en tête de colonne, tantôt en queue avec le Docteur Dervaux. Nous faisons un effort pour maintenir la conversation et pour ne pas être assommés brutalement par le sommeil. La colonne s'étire de plus en plus, on commence à voir de nombreux traînards, affalés sur les talus et les tas de pierres. A un moment donné je me trouve retenu assez loin en arrière par la surveillance des voitures qui ont perdu le contact avec la colonne. J'en profite pour monter dans la 202 et aussitôt assis, je m'y endors. Le conducteur est dans le même état que moi et, par deux fois en moins de 500 m nous versons dans le fossé et n'en sortons que grâce à l'intervention des Marocains qui nous en tirent à la force du poignet. La voiture est indemne mais je préfère décidément terminer la route à pied.
Lundi 13 Mai
L'étape semble interminable, la cadence de marche est de plus en plus ralentie. Les jambes coupées par cette allure je prends les devants avec Danglard et, en activant un peu, nous atteignons Pont à Celles, notre point de destination vers 8 h du matin. Une heure après, les premiers éléments du Bataillon apparaissent. A la 5ème Cie échoit encore une école au centre du bourg, tout près de la place de l'Eglise. Toute la matinée les traînards, épuisés, vidés, rejoindront isolément ou par petits paquets, ployant sous la charge du sac, du fusil, des musettes.
Nombreuses troupes dans le village. Nous y avons été devancés par des tirailleurs marocains et des chars, ceux-là même que nous verrons repartir et défiler, dans l'après-midi, fleuris et décorés de petits étendards belges. Le bureau du Bataillon a pris possession de la salle des mariages, au premier étage de la maison communale. Nous nous amusons beaucoup de voir Danglard trôner sur l'estrade, au fauteuil du Bourgmestre. Au-dessus de sa tête les bustes en plâtre des souverains, aux murs les portraits agrandis de toutes les victimes civiles et militaires de la grande guerre.
Ma chambre a été retenue dans un ménage de jeunes mariés fort sympathiques. Beau bébé de quelques mois. Le mari est officier de réserve ; je vois, en entrant, son uniforme accroché au portemanteau. Il doit rejoindre son poste à l'Etat-major de Bruxelles le lendemain. Je suis immédiatement convié à déjeuner et à dîner, mais je décline cette invitation pressante pour ne pas être séparé des camarades. C'est en effet, à table, que, tous réunis, nous faisons le point et réglons toutes les questions que pose le service.
Tôt dans la matinée, première alerte. Elles vont se succéder sans interruption jusqu'au soir. Ce hurlement de sirène devient obsédant et agit désagréablement sur les nerfs. Les ordres qui nous arrivent dans la journée prescrivent le départ pour demain matin 3 h. Nous allons donc pouvoir passer quelques heures de nuit dans un lit.
Un moment de détente dans l'après-midi. Je vais flâner en ville en compagnie du Docteur qui m'entraîne aussitôt dans un magasin de tabacs. Moi-même je me laisse tenter par l'abondance, le choix invraisemblable et les prix et je fais, comme lui, une ample provision de cigarettes et cigares de luxe. J'enfouis tout cela dans ma cantine, certain de pouvoir les rapporter en France lors de ma prochaine permission.
Nous avons quelque peine à nous faire servir à déjeuner et à dîner. Tous les restaurants sont envahis par les troupes et démunis de provisions. Je rentre me coucher de bonne heure et trouve l'adjudant François attablé avec mon hôte et quelques membres de la famille. Sur la table une bouteille de Bordeaux est déjà débouchée, deux autres ont été mises à chambrer dans le four de la cuisinière. Il faut trinquer et boire au delà de ce que je souhaiterais mais refuser serait, je le sens, les peiner gravement. La conversation risque de se prolonger. Aussi je coupe court en m'excusant, et monte m'étendre, bien vite, sur un lit confortable.
Mardi 14 Mai
2 h 1/2. Delarue vient frapper à ma porte à l'heure précise. Mes hôtes sont déjà levés. Le petit déjeuner m'attend, bien chaud, copieux, réparateur. Nous nous séparons, non sans une certaine émotion ; nous sentons que l'heure est grave, pour les uns comme pour les autres, cependant, personne encore autour de nous ne pressent la tournure que prennent déjà les événements.
Nous décollons à 3 heures. Le jour n'est pas encore levé. L'étape sera sensiblement moins longue que les précédentes. Nous touchons maintenant au pays noir, au Borinage. Il fait cependant grand jour lorsque nous abordons, en direction de Viesville, un vaste plateau sans arbres ni couverts d'aucune sorte. Au-dessus de nos têtes les escadrilles allemandes passent sans arrêt et nous survolent entre 1000 et 2000 mètres. Jamais encore nous n'en avions vu une telle quantité à la fois, mais aucun avion allié pour leur donner la chasse. Quelle cible que notre colonne qui s'étire au grand jour sur plus de 1 kilomètre. Nous ne disons rien, mais nous avons tous les mêmes appréhensions. Je ferme la marche avec la "Celta" pour veiller sur le convoi des voitures et, en particulier, sur l'une de celles de la Cie dont une roue est en fort mauvais état.
Nous atteignons enfin Viesville, sans encombre et bien soulagés. Les escadrilles ennemies n'ont pas pu ne pas nous voir mais nous ont dédaignés. A Viesville nous bifurquons sur le Grand Sart où va prendre place la 5ème Cie. Les 3 autres Cies du Bataillon sont éparpillées aux environs sur un front de 15 à 20 km. Nous voici arrivés à l'heure précise et au point précis que nous assignait, depuis plusieurs mois, le plan d'avance en Belgique. Quant à la division marocaine, avec laquelle nous avons fait colonne depuis le 10, elle poursuit sa marche en avant pour prendre contact avec l'ennemi. Jusqu'à présent tout s'est déroulé sans à-coups mais, maintenant, de quoi demain sera-t-il fait ? Il ne nous reste plus qu'à attendre les ordres relatifs aux travaux qui vont nous être assignés.
Nous occupons la partie haute du village de Grand Sart, autour d'une petite et charmante chapelle gothique en brique, tapissée de lierre. A peine sommes nous arrivés que la sirène se met à hurler. Il en sera ainsi, vingt fois, trente fois dans la journée, à chaque survol des escadrilles ennemies. Les avions passent par groupes de 30 à 40, en formations impeccables ; pas une seule fois nous ne verrons une escadrille de chez nous ou un avion qui ne soit marqué de la croix noire.
Personne ne nous attend pour faire le cantonnement ; nous nous installons à notre fantaisie. Je me suis réservé une chambre au carrefour dans la maison d'une femme âgée et veuve, avec elle sa filleule, veuve également. Maison cossue, confortable, avec un grand jardin potager et fruitier entretenu avec le plus grand soin. Quant à notre popote nous l'avons installée dans une maison voisine, chez un marchand de tissus. Un certain nombre de maisons ont déjà été abandonnées, mais le village, très à l'écart des grandes routes, est intact.
Dès le début de l'après-midi nous voyons apparaître les premiers réfugiés qui refluent de la région des Ardennes. Ils défilent par le petit chemin creux qui tourne devant le bureau de la Cie et descendent ensuite vers la partie basse du village. C'est alors et par eux que nous apprenons que le Canal Albert a été franchi et les troupes alliées bousculées. La bataille ferait rage, en avant de nous, aux environs de Gembloux. Ce pitoyable défilé va aller s'amplifiant, d'heure en heure, jusqu'à devenir un flot ininterrompu qui s'écoulera, sous nos yeux, pendant quatre jours. Spectacle atroce et indescriptible. Gens harassés visages résignés, frappés de stupeur. Les femmes, les enfants, les vieillards sont en majorité. La plupart sont chaussés d'espadrilles et poussent devant eux des bicyclettes chargées de ballots, de provisions. Les véhicules les plus divers et les plus invraisemblables se succèdent : vieux coupés du siècle dernier, autos depuis longtemps à la réforme, chars à boeufs, tout a été mis à contribution. Il y a d'extraordinaires chargements notamment sur ces chariots belges tout en longueur où, sur une caisse étroite, sont juchés et entassés paquets, literie, vieillards résignés, enfants somnolents et tous les objets familiers qui ont pu être sauvés du désastre. C'est à croire que la région envahie s'est complètement vidée de sa substance.
Beaucoup de ces réfugiés stoppent un instant au tournant du chemin pour souffler quelques minutes et demander la direction de la France. Ceux qui répondent aux questions de nos hommes évoquent avec une terreur qui se lit encore dans les yeux les ravages de l'aviation, les colonnes de civils bombardées sur la route, les victimes abandonnées ça et là sur les talus et dans les champs. Tous les renseignements que nous nous efforçons d'obtenir sur la marche des opérations et la situation des troupes sont confus et contradictoires. Ce défilé a pour effet de semer la panique dans notre village. Je vois plusieurs familles qui rassemblent précipitamment quelques objets précieux, ferment leurs volets et leurs portes et se joignent, séance tenante, à cette lamentable procession. Les autres habitants nous assaillent de questions : "que faire ? Où aller ?". Que répondre à ces questions, toujours les mêmes et que ponctue chaque fois, l'expression du pays, toute pénétrée de résignation, d'une résignation qui fait mal "quelle affaire, Monsieur, savez-vous !". Nous les renvoyons à leurs autorités municipales, mais la plupart de ces fonctionnaires ont fui les premiers.
La journée s'écoule et s'achève sans ordres nous concernant et ce silence ne manque pas de nous sembler étrange. Les hommes sont maintenant reposés, beaucoup ont dormi en plein air, au soleil. J'ai fait occuper par mes conducteurs une ferme voisine abandonnée ; le bétail y souffrait de la soif et les vaches aux pis gonflés faisaient peine à voir. Je leur ai donné l'ordre de soigner les bêtes et de récolter le lait.
Quelqu'un me cherche, me dit-on, dans le village. C'est un jeune conducteur du 4ème train auto que j'ai peine à identifier et qui se présente : Fouché de la Couarde. Je me souviens maintenant de l'avoir rencontré chez le Pasteur Arbousset. Il conduit une voiture à chenilles et son groupe est garé dans un petit bois à 200 m du village. Je lui promets d'aller lui rendre visite et parler du pays.
Les bombardements d'avions étant à redouter par-dessus tout je fais creuser, dans les jardins et les pâtures avoisinantes, quelques tranchées étroites et profondes et m'efforce de faire comprendre à nos hommes que c'est là leur meilleure sauvegarde. Le ravitaillement est toujours normal, voire même surabondant, car des habitants en abandonnant le pays, nous ont donné, qui un veau, qui un mouton, un boucher le contenu de ses glacières.
Au soir nous passons un bon moment les camarades et moi, accoudés au mur bas de l'école, à contempler le panorama que l'on y découvre en direction de Viesville. Nous voyons se succéder les escadrilles de bombardement et les rangées de fumées, qui montent brusquement du sol, accompagnées de sourdes détonations nous indiquent les points de chutes des bombes. Les avions opèrent en toute quiétude, rien ne vient les déranger, si ce n'est une D.C.A. timide et sans efficacité. Quant à la sirène, installée dans la cour de l'école, elle fonctionne sans arrêt. Il y a de quoi mettre à rude épreuve les nerfs de toute la population et les nôtres aussi, par surcroît.
Mercredi 15 Mai
La nuit a été paisible et, pour tous, largement réparatrice. Encore une belle et chaude journée en perspective. De ma fenêtre j'aperçois en m'habillant un deuxième flot de réfugiés qui défile, cette fois, par la route du haut, celle du bas ne débitant plus assez. Le petit café, en face, regorge de réfugiés qui se restaurent au passage, soufflant un instant et bavardant avec nos hommes. Notre roulante est installée tout à côté, sous le hangar au jeu de boules, et, toute la journée, elle distribuera du lait aux enfants, du jus et de la viande aux plus affamés.
Le village continue à se vider petit à petit. Le bourgmestre et le curé, loin de rassurer la population y sèment la panique et prennent la fuite les premiers. Et, sans arrêt, se succèdent les sollicitations et les questions angoissées des habitants sur le qui-vive.
Des espions et des parachutistes sont signalés un peu partout dans le pays. Il leur est aisé de se faufiler dans cette masse mouvante de population et il nous est impossible d'interroger et d'arrêter tous ceux qui nous paraissent suspects. Ils sont trop ! Il faut cependant prévoir la descente de parachutistes dans les environs du village d'autant plus que des ordres nous ont été donnés, impitoyables : tout parachutiste pris sur le fait et revêtu de vêtements civils ou d'un uniforme allié doit être exécuté, séance tenante, et sans autre forme de procès.
Je vais faire une tournée dans le village avec l'adjudant François et nous repérons aussitôt un château d'eau qui domine la campagne de 20 à 30 mètres et qui peut faire un excellent poste de guet. Nous installons aussitôt, au pied de la tour, un poste d'une section et, sur le sommet du réservoir, deux guetteurs munis de jumelles et armés de fusils-mitrailleurs. De là ils signaleront tout ce qui leur paraîtra suspect. Je grimpe moi-même, par l'escalier en colimaçon, jusqu'au sommet de la tour. On y découvre, de là-haut, un panorama superbe dans toutes les directions : d'un côté les bois, la campagne plantureuse, quelques gros villages, à l'opposé le bassin de Mons avec des usines, des gros crassiers en forme de pyramides, le pays noir ! A ce même instant des escadrilles allemandes apparaissent à l'horizon. Je les suis aisément à la jumelle et je les vois bombarder la voie ferrée en direction de Viesville et des dépôts de munitions aux abords de Gosselies. Je vois nettement les bombardiers piquer à tour de rôle vers leurs objectifs et décharger leurs chapelets de bombes. Le dépôt de munitions semble avoir été touché ; des colonnes de fumée lourde s'élèvent qu'aucune brise ne dissipe et qui salissent un coin du ciel si bleu.
Nous trouvons de plus en plus étrange l'abandon dans lequel on nous laisse. Il faut prendre une initiative. Aussi, dans l'après-midi, je me fais conduire à Viesville où doit se trouver le service de santé auquel nous aurions déjà dû fournir des travailleurs. Je l'y trouve en pleine effervescence. On dresse en hâte de vastes tentes, on aménage des salles d'opérations, tout cela, en prévision d'un afflux de blessés attendus dans la nuit. Notre collaboration est accueillie avec empressement et le médecin-chef nous confie le soin d'aménager des pistes et des voies d'accès pour les autos sanitaires. D'accord avec lui j'enverrai, demain matin à la première heure la moitié de mon effectif sous la conduite de François.
En cours de route je ramasse le Lt Huet que son service appelle à Gosselies que, du haut du château d'eau j'ai vu bombarder quelques heures plus tôt. La charmante petite ville, célèbre par son Ecole Ménagère, si riante, si plaisante est déjà fort endommagée et en grande partie évacuée. A l'intérieur de Gosselies nous tombons à l'improviste sur le Lt Huet, l'autre, celui du génie avec lequel nous avons travaillé cet hiver, dans les Ardennes et qu'à la popote nous appelions "le grand sympathique". Il nous entraîne jusqu'à son 'P.C. qu'il a installé, comme par hasard, dans une brasserie. Il nous sert, lui-même, un demi frais tiré et nous donne quelques tuyaux sur la situation. Il arrive de Gembloux où la bataille fait rage. Nos chars et la division marocaine y sont engagés et tentent de s'opposer à l'avance allemande. Il nous confirme la présence d'une nuée d'espions et de civils suspects, ce que l'on commence à appeler, ici, la Sème colonne. Retour à Grand Sarts.
En mon absence le poste de garde a mis en lieu sûr, pèle mêle, quelques civils et réfugiés particulièrement douteux. Parmi eux un prêtre distingué, hautain, arrogant et qui prônait, au milieu d'un groupe de nos pionniers, les mérites du régime hitlérien. Je suis absolument désarmé et ne puis que lui intimer l'ordre de déguerpir au plus tôt.
Le village continue à se vider. Le fonctionnaire préposé à la sirène a pris le large à son tour. Cette fois, bon débarras !
Le soir, lorsque je rentre pour me coucher, je trouve ma propriétaire et sa filleule sur le pas de la porte. C'est moi qu'elles guettent. Elles ont décidé, elles aussi, de partir et elles m'abandonnent la maison, me priant, lorsqu'à mon tour je partirai, de fermer la porte à clé et de jeter celle-ci dans un fossé. Je les regarde s'éloigner et s'effacer dans la nuit, en direction de la France. Je suis tout impressionné de me trouver seul, soudain, dans cette maison abandonnée et où ne restent plus de vivants que le chat, les serins et les pigeons.
Nouvelle visite de Fouché avec lequel nous évoquons le pays natal, la Couarde, la forêt de l'Hermitain. Il se plaint d'être sans ravitaillement, ainsi que ses 15 ou 20 camarades. Je m'offre à les nourrir à la roulante, ce qu'il accepte avec empressement.
La deuxième journée à Grand-Sarts s'achève. Que sommes-nous venus faire ici? Où en est la situation ? Une inquiétude que nous n'osons pas nous avouer commence à nous envelopper. La maîtrise aérienne des ennemis, l'exode des populations, les renseignements que nous recueillons par bribes, la masse des suspects dont nous nous sentons environnés, tout cela crée un malaise et une atmosphère pesante. L'entrain de nos repas de popote s'en ressent. A la nuit on me signale, de divers côtés des lueurs inaccoutumées et des fusées d'un type nouveau qui ne peuvent avoir d'autre objet que de signaler, au passage des avions ennemis, la position de nos batteries, de nos convois et de nos troupes.
Jeudi 16 Mai
L'adjudant François, comme convenu est parti de bonne heure, avec deux sections, se mettre à la disposition du service de santé. Une heure plus tard, je me dispose à l'y rejoindre, lorsque j'aperçois la colonne qui revient sur Grand-Sarts. La corvée a été décommandée, l'hôpital de campagne que j'ai vu, hier, s'installer et dresser ses tentes a reçu, dans la nuit, l'ordre de se replier. Que signifie ce brusque contrordre ? Ce qui augmente encore notre inquiétude et notre désarroi c'est que nous ne recevons ni ordres, ni renseignements, pas plus de notre Colonel que du Corps d'Armée auquel nous sommes rattachés.
Le défilé des réfugiés ne s'est pas ralenti mais, maintenant, mêlés aux civils on commence à voir quelques soldats belges qui refluent vers l'arrière, encore frais et insouciants, comme on rentrerait chez soi, au soir, sa journée de travail terminée.
Je mets à profit ces heures d'inaction pour constituer nos équipes de brancardiers. Le Dr Dervaux et son sergent infirmier leur apprennent à utiliser les brancards et à faire des pansements.
Des avions sont encore venus bombarder un dépôt de munitions, tout près de nous. Nous entendons, pendant un long moment, se succéder, ininterrompues, de sourdes détonations.
Je continue à faire soigner le bétail à l'abandon dans les champs. J'en profite pour récupérer deux chevaux de trait dont nous avons grand besoin. Le caporal Cherrier qui s'y connaît, a mis la main sur deux superbes ardennais, à la robe rousse et à la croupe rebondie. Il me faut maintenant trouver un chariot susceptible de remplacer, un jour ou l'autre, notre voiture avariée.
Jusqu'à ce jour-là notre officier de détails, notre brave Pivert, nous a ravitaillés normalement, mais aujourd'hui le ravitaillement est incomplet et les fourgons ont été mitraillés en cours de route. Pivert, le bon vivant, commence à trouver que ça devient sérieux, il abonde en détails pittoresques pour nous dépeindre son baptême du feu.
En fin de journée visite inopinée d'un officier de l'Etat-major du Corps d'Armée qui vient me demander une corvée importante. Nos hommes doivent être enlevés, la nuit venue en camions pour aller décharger, dans une gare voisine, un train d'obus de 155. Je donne les ordres en conséquence.
Le propriétaire du café où les sous-officiers ont installé leur popote est parti à son tour en leur abandonnant sa maison et sa cave. Je suis invité à y boire un vieux Porto. J'en profite pour bavarder familièrement avec mes sous officiers, ce que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire depuis notre départ, je leur communique le peu de renseignements que je possède et m'efforce de leur rendre une confiance qui commence à chanceler. A voir ce qui nous entoure, dans la maison qui nous abrite nous nous demandons ce que vont devenir tous ces intérieurs à l'abandon où l'outillage ménager et le mobilier confortable indiquent assez combien la vie devait y être facile et aisée. Nous sommes dans une des riches provinces de la Belgique où il devait faire bon vivre.
Le ravitaillement nous ramène quelques lettres, les premières depuis le 10, mais ce sont des lettres anciennes et antérieures à cette date. Malgré tout, cela semble bon.
La nuit est venue. Les hommes de la Cie, sont là, équipés, qui attendent, couchés dans l'herbe, l'arrivée des camions. Le temps passe, les heures s'écoulent, 11 heures vont sonner et nous ne voyons rien venir. Les camions se seraient-ils égarés ? Cela n'aurait rien de surprenant tant les cartes que nous avons reçues en entrant en Belgique sont confuses et d'une lecture difficile. Las d'attendre je vais m'étendre sur mon lit.
Vendredi 17 Mai
A deux heures du matin le Capitaine Muller et le Capitaine Walter de l'E.M. du Corps d'Armée surviennent brusquement. D'un bond je suis dehors. En quelques phrases hachées ils nous expliquent, à Danglard et à moi qu'il n'est plus question de corvées, que les Anglais et les Belges ont cédé sur toute la ligne et qu'un repli général est à prévoir. Il s'ensuit que nous devons partir au petit jour, pour nous rabattre sur Bellecourt où le Bataillon va être rassemblé.
Les ordres de départ sont donnés. J'abandonne à Grand-Sarts le sergent Couestin et un conducteur pour aller chercher, dès qu'il fera jour le chariot que je veux emporter. Ils nous rejoindront à Bellecourt.
Je prends les devants, en voiture, avec Danglard, Huet, Pivert et le Docteur, pour préparer le cantonnement. Nous sommes à Bellecourt avant 5 heures. Le train auto vient se ranger sur la place, le long du chevet de l'Eglise. Quelques maisons détruites, mais le village est calme et presque désert. De nombreux chars et autos mitrailleuses dans les rues.
Nous répartissons rapidement le cantonnement des 4 compagnies et nous allons ensuite nous asseoir, dans un café, où nous nous faisons servir une tasse de café et une tartine de beurre. Le Bataillon ne va pas tarder à arriver. Nous sortons paisiblement du café lorsque, à ce moment précis, passent affairés, quelques officiers de chars qui nous crient : partez immédiatement, les allemands sont signalés à 3 km d'ici, ils peuvent déboucher d'un instant à l'autre. Déjà nous voyons les chars prendre leurs dispositifs de combat. Nous nous concertons. Faute d'ordres il faut cependant prendre une décision. Après avoir rapidement consulté la carte nous décidons de filer sur Binche et nous y rassembler, au cas où nous serions dispersés. Danglard, Huet et Pivert partent aussitôt avec les voitures de liaison. Quant à moi, je reste sur place avec les camionnettes, pour attendre les Cies et leur donner un axe de marche. Je n'ai pas longtemps à attendre ; c'est d'abord la Sème Cie que je vois déboucher, François en tête. Je n'ai rien à apprendre à celui-ci. Il a été alerté en cours de route et le Génie a fait sauter le pont sur le canal, aussitôt après le passage du dernier de nos hommes. Quelques minutes de plus et la Cie toute entière se trouvait coincée entre les allemands et le canal. En tous cas les deux hommes que j'ai laissés cette nuit à Grand-Sarts doivent être prisonniers.
Je donne à François l'ordre de poursuivre sa route sur Binche en forçant l'allure autant qu'il lui sera possible. Les hommes ont compris la situation, personne ne rouspète, personne ne se fait prier pour repartir. Je me mets ensuite en route, par un autre itinéraire avec les camionnettes. Je me suis perché sur le siège de notre Renault 5 tonnes bourré jusqu'au toit de sacs d'approvisionnements, de matériel divers et de cantines. Nous fonçons à pleins gaz. Une fois sur la grand-route nous sommes pris dans un flot de convois qui dévalent vers Binche : autos de liaison, chars d'assaut, colonnes d'artillerie belge, le tout en sens unique, sur trois files parallèles. Miracle qu'il n'y ait ni accrochages, ni accidents graves et surtout pas de bombardements, car les avions ennemis nous survolent à faible hauteur.
Nous atteignons Binche, la célèbre ville du Carnaval mais qui revêt aujourd'hui sa physionomie de guerre. Sur la grande place débouchent des principales voies d'accès, l'embouteillage est inextricable. Un agent régulateur, calme, stoïque s'efforce de canaliser ce flot convergent qui grossit à vue d'œil. Des avions passent qui lancent quelques bombes ; nous nous jetons dans une cave. Un des chauffeurs que j'ai envoyé à la recherche de Danglard le découvre, sans trop de peine. Dès son arrivée il s'est mis en liaison avec notre Colonel qui avait encore son P.C. à Binche. Ce dernier, également sans ordre et coupé de toute liaison avec le Corps d'Armée, nous fixe un nouveau point de rassemblement, à savoir, la sortie de Mons en direction de Valenciennes.
Je remonte en voiture avec Danglard. Nous arrivons à Mons que nous contournons par ses boulevards circulaires et nous stoppons à la sortie de la ville, au bord du canal, sur la route de Valenciennes. Nous nous asseyons sur des bornes et nous attendons, cependant que sous nos yeux, déferlent tous les éléments motorisés d'une armée, grossis d'une masse de civils qui abandonnent Mons en toute hâte. Nombreux sont ceux qui, voyant nos voitures rangées le long du trottoir, nous supplient de les mener jusqu'à la frontière ; certains nous offrent de grosses sommes pour trouver place sur un camion. A voir certaines détresses et certains visages décomposés par l'épouvante on se détourne, pour ne pas avoir à refuser ce qu'il nous est d'ailleurs absolument impossible d'accorder.
Il y a déjà deux heures que nous attendons et le Colonel n'est pas venu nous rejoindre au point de rassemblement qu'il nous a fixé. Des avions ont commencé le bombardement de la ville ; on voit monter de lourdes volutes de fumée vers le centre, aux alentours du beffroi, Danglard envoie Huet au devant du Colonel. Celui-ci le retrouve à Binche où il est encore et où il a pu reprendre contact avec l'Etat-major. Les ordres qu'il nous rapporte sont précis et catégoriques : nous devons rebrousser chemin jusqu'à St Symphorien. C'est là que la 5ème Cie, prévenue à son passage à Binche, doit aller cantonner.
Nous arrivons à St Symphorien vers midi, à peu près en même temps que la Cie. Le village, tout en longueur, le long de la grande route a été bien touché. Nous nous installons, par prudence à sa sortie nord, aussi loin que possible d'un dangereux carrefour. Le Colonel et l'Etat-major du Corps d'Armée se sont également fixés à St Symphorien.
Les 3 autres Cies du Bataillon ont dû recevoir, en cours, de route, des ordres leur assignant de nouveaux points de stationnement dans différentes localités voisines de celle-ci, mais nous avons perdu tout contact avec elles depuis la nuit. Nous nous demandons surtout si elles ont pu, comme la 5ème, franchir le canal avant la destruction des ponts. Danglard décide d'aller voir ce qu'il en est et me demande de l'accompagner. Nous prenons la Celta avec le Lt Huet et filons en direction de la Louvière où doivent se trouver Tourgis et Druet.
Nous arrivons sans encombre à la Louvière, amas de cités ouvrières, de grosses usines métallurgiques, de crassiers. Dans la rue principale une troupe fait la pause, c'est la 8ème Cie. Sur le seuil d'une porte, assis, la tête dans les mains, quelqu'un dort, absolument dégonflé, c'est Druet réduit à l'état de loque, incapable, comme d'ailleurs tous ses hommes, de faire un pas de plus. Ils ont couvert plus de 40 kilomètres depuis 2 h du matin. Nous poursuivons notre tournée et nous retrouvons dans un village voisin, Tourgis et Renard avec leurs 2 Cies respectives. A part quelques isolés, le Bataillon a pu franchir la ligne de repli en temps utile.
Nous allons regagner St Symphorien. Sur la route, droite, bordée de hauts talus et de grands arbres nous stoppons pour nous allonger dans des fossés pleins d’orties ; des avions survolent la route dans son axe et lâchent de courtes rafales de mitrailleuses. Il commence à faire chaud et cette position horizontale est dangereuse. En effet, nous nous y endormons l'un après l'autre jusqu'à ce qu'un lourd convoi d'artillerie, qui ébranle la route à son passage, nous réveille tous en sursaut.
Il est déjà 4 ou 5 heures et, maintenant que nous avons dormi, c'est la faim qui se fait sentir. Fort heureusement, le coffre de la voiture n'est jamais vide. Nous extrayons une boule, quelques boites de pâté, un bidon de pinard et, le dos au talus de la route, nous cassons la croûte, béatement ; la vie est presque belle, elle se borne, en ce moment, à la seule satisfaction de quelques besoins élémentaires.
Sur la route de Mons que nous rejoignons, le défilé des autos est moins serré que ce matin. C'est l'armée belge qui reflue maintenant dans le plus grand désordre, c'est une vraie débâcle.
Nous avons quelque peine à trouver une maison habitée pour nous faire préparer à dîner. Celle où nous nous réfugions ne le sera pas pour, longtemps. La famille entière est rassemblée dans la grande salle à manger où les ordonnances nous apportent la soupe de la roulante, assise sur des ballots de vêtements et prête à prendre la route dès la tombée de la nuit. Lorsque nous sommes entrés, la TSF achevait de diffuser un discours de P. Raynaud, nous n'en avons saisi que la péroraison : "…la situation est très grave, elle n'est pas désespérée" paroles qui retentissent en nous, lugubrement.
Pour passer la nuit nous n'avons que l'embarras du choix, il n'y a qu'à forcer la porte de la première maison venue. Je m'installe au premier étage de celle qu'occupé le bureau de la Cie ; Vandevyver couche dans la pièce voisine.
Samedi 18 Mai
Sur pied dès que le jour se lève. L'inquiétude nous a tenus en éveil. L'armée belge en débandade, mêlée à de nombreux convois français, n'a cessé de défiler sous nos fenêtres toute la nuit, en direction de la frontière.
Nous avons hâte de savoir ce que nous devons faire et, personnellement, je presse Danglard de provoquer des ordres puisqu'il n'en reçoit pas. Il se décide à envoyer Huet auprès du Colonel qui se trouvait, hier soir encore, à l'autre extrémité du village. La précipitation et le désordre dans lesquels refluent les troupes semblent bien indiquer que la situation ne fait que s'aggraver. Nous n'avons nous pionniers aucune mission de combat ; alors pourquoi ne pas nous replier, nous aussi, beaucoup plus au sud en direction soit de Valenciennes soit de Bavay?
Deux heures d'attente fébrile que nous passons à faire les cent pas dans la rue. Il est à supposer que Huet n'a pu joindre le Colonel. Quelques isolés du 1er Bataillon de chez nous passent en nous assurant qu'ils ont reçu l'ordre de se regrouper à Bavay. Les renseignements que nous recueillons, par ailleurs, de la bouche d'officiers d'artillerie, sont de plus en plus alarmants.
Je déclare alors à Danglard que, sauf opposition catégorique de sa part, je suis décidé à faire filer la Cie et les voitures vers Bavay sans plus attendre mais que, dans ce cas, je resterai avec lui jusqu'à nouvel ordre. Danglard hésite, puis acquiesce. A 8 h 1/2 la Cie se met en route, guidée par François à qui j'ai remis une carte et tracé un itinéraire.
A 9 h 1/2 Huet rentre enfin, très calme avec son sourire de gros poupon. Il a eu beaucoup de peine à rejoindre le Colonel, mais il nous rapporte des ordres formels : nous devons rester sur place et ma Cie doit mettre immédiatement à la disposition de l'Intendance une section et un sous- officier. Je saute à cheval et je pars à la poursuite de la Cie qui, fort heureusement, n'a guère fait que 2 ou 3 km, coincée qu'elle est par des chariots bondés de réfugiés et qui obstruent le chemin. Je détache aussitôt le sergent Mimoun et sa section, en leur indiquant le point où ils doivent retrouver les camions de l'Intendance et ramène le reste de la Cie à son cantonnement de St Symphorien. De la section Mimoun nous n'entendrons plus parler, la Cie est désormais amputée du 1/4 de son effectif et de son meilleur sergent.
En arrivant au bureau de la Cie, j'y trouve Danglard et le Colonel. Je devine que Danglard a dû se faire engueuler au sujet de mon initiative. Effectivement, car c'est à moi, maintenant que le Colonel reproche d'avoir cédé à un vent de panique et d'avoir mis ma Cie en route sans ordres de sa part. Je lui réplique calmement qu'il n'y a pas eu panique puisque, personnellement je suis resté, que je prends l'entière responsabilité de mon geste et que c'est dans des circonstances comme celle-ci qu'il faut savoir prendre des initiatives, au risque même d'en prendre de malencontreuses. Ces explications semblent satisfaire le Colonel qui se calme soudain et change de sujet.
Je suis convoqué vers midi au Corps d'Armée où l'on me charge d'organiser la surveillance et la garde de l'usine d'engrais située dans les parages de notre cantonnement. Je me rends à l'usine en question. Dans la cour un escadron de spahis, ou plutôt ce qu'il en reste, fait la grande halte. C'est l'escadron de la Division marocaine. Le seul officier rescapé me donne quelques renseignements sur les combats auxquels il a pris part. Les troupes françaises sont arrivées sur les positions, harassées, à bout de souffle, en même temps que les allemands, amenés en camions, frais et dispos. L'aviation allemande a tout écrasé. Il y a eu sur le canal Albert des défaillances criminelles et, sans doute, préméditées. Les pertes de la Division Marocaine ont été très lourdes. Très peu de camarades du 2ème Tirailleurs marocains, avec lesquels nous avons si agréablement voisiné à la Longueville, sont revenus de cet enfer ; quant aux indigènes ils ont été pris de panique sous les bombardements de l'aviation.
Nous assistons à quelques combats, très haut dans les nuages : ce sont des avions canadiens, aux ailes noires et blanches, qui s'attaquent aux croix gammées. C'est la première manifestation, que nous ayons sous les yeux, de l'aviation alliée. Mon caporal Cherrier récupère, à l'abandon dans les champs, un beau cheval de cavalerie, sellé et harnaché et très légèrement blessé d'un éclat dans la cuisse. C'est une bête très douce que je monterai comme cheval de selle, ce qui permettra d'atteler Champagne, en flèche, comme cheval de secours.
En fin d'après-midi, désœuvré, je vais flâner vers le centre du village où s'est installé l'Etat-major du Corps d'Armée, avec l'espoir d'y rencontrer M. Marchand. Au moment où j'arrive sur la petite place, je vois toutes les voitures du Quartier Général qui démarrent à toute allure. Si le Corps d'Armée se replie nous n'allons pas tarder à en faire autant.
Effectivement, lorsque je rentre au bureau je trouve l'ordre de départ. La Cie doit partir immédiatement pour Eugies, le premier village belge où nous avons stationné en montant en Belgique. Encore une longue et dure étape en perspective. Les voitures sont hâtivement chargées, la soupe distribuée, à peine cuite et la Cie se met en route, sous la conduite de François.
C'est à moi qu'incombe le soin d'emmener le train auto et je dois attendre le retour de Pivert et de ses camionnettes, qui ne sont pas rentrées encore du ravitaillement. La Cie est déjà loin lorsque Pivert rentre à St Symphorien. Il ramène deux conducteurs blessés par des balles d'avion. Nous pansons l'un d'eux sommairement et nous chargeons l'autre, à grand peine, sur une ambulance qu'il nous faut arrêter de force, sur la route, tant la panique et la hâte de fuir est grande.
On achève en toute hâte le chargement des camionnettes, on fait le plein d'essence et, en route. De nouveau, un flot serré de convois, qui glissent en direction du Sud. A minuit nous atteignons Eugies sans encombre.
Nous alignons les voitures sur un trottoir, à l'abri d'un couvert d'arbres et je me mets aussitôt à la recherche du bourgmestre. Nous arrivons juste à temps pour le voir monter en voiture, lui, sa femme et ses valises pour filer à son tour. Il prend cependant le temps de nous indiquer, comme cantonnement, les écoles et le dépôt des trains. Il fait nuit noire, personne dans les rues. Nous trouvons, sans peine, les écoles que nous connaissons déjà, mais, beaucoup plus difficilement, le dépôt des trains. Tout est fermé par le grand rideau de fer, pas de personnel, plus de gardien. A tâtons nous cherchons de quoi ouvrir et, finalement, c'est à grands coups de barres à mine, qui résonnent furieusement dans le village endormi, que nous défonçons les portes. Le cantonnement une fois réparti je prends la Ford avec Fauvel, et nous partons à la recherche du Colonel. Après avoir erré assez longtemps dans les rues désertes, nous finissons par le découvrir qui sommeille dans sa voiture près de l'Eglise.
Je reviens à notre convoi de voitures et me glisse dans la 202 où déjà Pivert et le Docteur dorment pesamment. En un clin d'œil j'ai perdu connaissance et je m'endors, la tête sur l'épaule du Docteur. Je dors depuis un moment déjà lorsque, brusquement, la portière s’ouvre ; un civil, dont nous ne distinguons que la silhouette, passe la tête et nous crie ; " les allemands sont dans le village, fuyez vite, des motocyclistes viennent de passer et demandent où se trouvent les troupes françaises"! Le réveil est brutal. Nous nous extirpons tant bien que mal de la voiture, transis, les yeux à peine ouverts. Nous nous précipitons sur nos armes, nous secouons les conducteurs, et donnons l'ordre de faire tourner les moteurs. Après nous être ressaisis et concertés nous décidons d'aviser le Colonel et de ne pas bouger avant l'arrivée du Bataillon. Ensuite, prudemment, en rasant les murs, le revolver à la main, nous partons inspecter les rues voisines. Personne ! Au bout d'un instant un bruit de moto qui nous immobilise. Un motocycliste passe et ralentit à notre hauteur, aucun d'entre nous n'a tiré, fort heureusement, car c'est un agent de liaison du Corps d'Armée, à la recherche d'une unité perdue dans la nature. Quant au civil chargé, cela ne fait aucun doute, d'aller semer la panique de ci et delà, inutile de se mettre à sa poursuite, il est parti plus loin continuer sa sale besogne.
Dimanche 19 Mai
II va être 3 heures et les Cies ne vont pas tarder à nous rejoindre. Je poste des agents de liaison à divers carrefours pour les guider vers leurs cantonnements respectifs et, n'ayant plus maintenant nulle envie de dormir, je fais les cent pas dans la rue. Quelques portes s'entrouvent, des habitants alertés par nos allées et venues viennent aux nouvelles, anxieux. Tous ceux qui restent sont prêts à partir aux premières heures du jour et, cependant, il n'y a qu'un itinéraire, il leur faut traverser la grande forêt qui nous sépare de la frontière et que, chaque jour, les escadrilles allemandes viennent bombarder avec acharnement.
Un homme m'aborde, sur le seuil de son épicerie, un magasin du type "Primistère". Il me donne quelques nouvelles et m'invite à venir me restaurer. J'accepte spontanément malgré la prudence qui s'impose en telles circonstances, j'ai tellement faim et soif aussi ! Dans l'arrière-boutique sa jeune femme et leur fillette qui sommeille dans un fauteuil. Ils sont décidés à partir dans quelques heures. Ils partent dans l'inconnu, ne connaissant personne en France, pour tenter de gagner la Normandie. J'ai pitié d'eux, je griffonne mon adresse sur une page de carnet et la leur laisse ; s'ils passent par Paris, ils auront, au moins, où trouver un conseil ou une parole de réconfort.
A 4 heures, les premiers éléments du Bataillon débouchent et vont occuper leurs emplacements. J'ai attribué à la 5ème Cie l'Ecole où elle a déjà gîté huit jours plus tôt. En passant je m'arrête devant la maison où j'ai reçu un si chaleureux accueil. Tout est fermé, mes deux braves vieux sont partis. Je pénètre par derrière dans le petit jardin aux tulipes, je m'y recueille un instant et je repars avec une rose ! La seule du jardin et la première de la saison.
La Cie a semé quelques traînards en route mais elle a retrouvé, par le plus grand des hasards, le sergent Coûestris et le conducteur Beaugrand que nous avions laissés à Grand-Sarts. Ceux-ci, alertés peu après notre départ par la fusillade et les explosions, ont encore eu le temps de passer le Canal sur une écluse et gagner le large en abandonnant et le cheval et le chariot. Depuis lors ils étaient à notre recherche.
9 heures. Je me suis reposé un peu sur le siège d'une voiture. Je vais prendre un quart de jus bien chaud à la roulante. Nous n'avons plus de ravitaillement pour la journée. Je fais prendre un veau qui erre dans un champ et le fais tuer et débiter immédiatement. Il est à peine dans la marmite que l'ordre de départ nous est transmis. Il nous faut repartir aussitôt et faire l'impossible pour passer la frontière et atteindre Onnaing, au sud de Valenciennes avant la nuit. Les hommes éreintés après la dure étape de la nuit ont dormi quatre heures, au plus.
Combien arriveront au bout, ce soir ? Nous nous mettons en route. C'est moi qui suis chargé de guider la marche. Je suis en tête de colonne, la carte à la main, avec Druet. Danglard a pris les devants et nous ne le reverrons qu'à notre arrivée à Onnaing.
Beaucoup d'hommes ont trouvé le long du chemin des vélos abandonnés dont ils se sont emparés. Il y en a une vingtaine à la Cie, sur lesquels on juche les sacs, les musettes et à tour de rôle, les plus éclopés des hommes. La Cie commence à prendre l'allure d'une horde. Le soleil monte à l'horizon dans une brume qui annonce une journée très chaude.
Les villages que nous traversons achèvent de se vider de leurs habitants. À tous moments nous dépassons des groupes de civils inquiets de savoir si la frontière française ne leur sera pas fermée. Nous traversons ensuite, de jour cette fois, la grande forêt, qui nous avait paru si mystérieuse la première nuit de notre montée en Belgique, de tous les sentiers et de tous les layons débouchent des civils dont la plupart ont campé, la nuit précédente, sous les arbres et coupent au court pour gagner la frontière. On voit, de ci, delà, des arbres massacrés, trace des bombardements des jours précédents.
La forêt traversée nous atteignons une campagne découverte, aux vastes horizons. Les coeurs battent à la pensée de la terre française, toute proche, comme si là devait être, pour nous le salut et la fin de nos tribulations. Cette perspective pousse en avant les plus fatigués ; le soleil monte et la chaleur augmente terriblement. Les escadrilles de bombardiers allemands apparaissent et nous contraignent à morceler et échelonner les Compagnies et même à nous coucher, par moments, dans les fossés.
Il y a déjà tellement de traînards que, vers midi, je me concerte avec Renard et Tourgis pour faire une grande halte qui permettra de souffler et de distribuer la soupe. François part en avant pour reconnaître un emplacement ombragé où hommes et voitures pourront se camoufler et s'abriter. Sur ces entrefaits le Colonel nous rejoint. Je lui rends compte de mes intentions, qu'il approuve, et il décide de s'arrêter lui aussi, avec nous, pour déjeuner.
Le Bataillon fait halte dans un charmant vallon encaissé et ombragé où coule un ruisseau que l'on entend cascader entre les pierres. C'est Dimanche, il fait beau et, pour l'heure, tout est calme. Il faudrait si peu de choses, dans ce décor de pique-nique, pour oublier la triste réalité. Que deviennent et où sont, à cette heure, tous les nôtres, Question que nous nous posons cent fois par jour, mais qui revient plus lancinante en ce jour, et à cette heure, et dans ce décor où rien n'évoque plus la guerre.
Je déjeune sur l'herbe, au milieu de mes sous officiers, assis en rond à l'ombre d'un pommier et, aussitôt après, gagné par le sommeil, je m'endors. Le Colonel en fait autant, de son côté, allongé le long du parapet sur un coussin de sa voiture.
A 14 heures il faut cependant se décider à reprendre la marche. Impossible de prolonger plus longtemps la grand' halte. Je suis très préoccupé par le ravitaillement. Une ferme abandonnée est là, tout à côté, qui renferme encore de la volaille. Je fais déployer la Compagnie, organiser une pittoresque battue et tuer toutes les poules et tous les lapins qu'il est possible d'attraper. Toutes ces dépouilles sont chargées sur la roulante et son avant-train.
La marche reprend, plus pénible que jamais. La chaleur devient torride et la route accidentée. Il faut cependant avancer coûte que coûte, pour permettre au Génie de faire sauter les ponts après notre passage. Je reste en arrière pour stimuler les traînards, dont certains, effondrés sur le talus de la route, sont incapables de la moindre réaction. Moi-même, je ne sais si j'aurais pu continuer sans la bouteille de bière que m'offrent, au passage, les habitants d'un village et que j'avale d'un trait, à même le goulot. Je suis exténué, j'ai une barbe de plusieurs jours et, sur la figure, un masque de sueur et de poussière. Je rencontre, à la pause suivante Sauve et Follet dont le Bataillon nous précède et dont la voiture est en panne.
Nos 4 Cies s'étirent maintenant sur 2 à 3 Kilomètres. Ce ne sont plus que des paquets d'hommes, dé-ci, delà, auxquels je donne, au passage, les instructions indispensables pour rejoindre Onnaing comme ils le pourront. Certains font un effort surhumain car nous approchons de la frontière et de la ligne de résistance et des blockhaus. Nous avons le sentiment que sur cette ligne a été organisée une défense sérieuse sur laquelle viendra se briser l'élan des ennemis.
Il reste encore 5 km à faire que j'achève en bicyclette de façon à prendre les devants et reconnaître les cantonnements. Il est 7 heures du soir lorsque nous passons la frontière. Il y règne un calme impressionnant ; quelques groupes de reconnaissance mettent leurs chars et leurs canons antichars en position, en pleins champs. Quant aux troupes de la ligne des blockhaus elles sont alertées dans leurs cantonnements mais paisibles et indifférentes, d' apparence, à ce qui se passe autour de nous, ignorant tout de la situation, sans journaux, sans TSF, sans communiqués officiels; ce n'est que plus tard que nous comprendrons que la vraie menace ce ne sont pas tellement les Allemands qui nous talonnent, mais ceux qui, sans le savoir, nous avons devant nous et qui après avoir fait la trouée entre Sedan et Maubeuge, sont en train, dans un vaste mouvement tournant, de nous encercler jusqu'à la mer.
L'arrivée à Onnaing à la tombée de la nuit a quelque chose de particulièrement sinistre. L'aviation y a fait des ravages. Tout le long de la route de Valenciennes qui traverse la petite ville ce ne sont que maisons éventrées, cadavres de chevaux, enchevêtrement de fils téléphoniques et de trolleys et, montant vers Valenciennes, des troupes venant de Belgique qui refluent dans un désordre indescriptible. Les hommes hagards, hébétés, en marche depuis 4 ou 5 jours, certains sans chaussures, beaucoup sans armes marchent droit devant eux, machinalement, comme des hallucinés.
Les officiers sont rassemblés dans une grande habitation bourgeoise qui a grande allure au fond d'un petit parc aux arbres splendides et aux pelouses verdoyantes et méticuleusement entretenues. Bel intérieur mais plus une vitre aux fenêtres. Nous dînons à la lueur des bougies, au milieu de courants d'air que nous ne parvenons pas à obstruer et qui nous font frissonner. Drut, guidé par un instinct très sûr est allé visiter la cave et en a remonté quelques grands crus qui prennent place sur table et auxquels nous faisons honneur. Les hommes couchent dans quelques maisons voisines dont les celliers renferment encore quelques sérieuses réserves. La plupart des magasins du quartier ont été méthodiquement pillés. Nous passons la nuit, tous groupés dans les chambres du 1er étage de la villa où nous avons dîné. Nous avons jugé prudent de ne pas nous déshabiller. La conversation, ce soir, n'est guère animée, Pivert et le Docteur, eux mêmes, les habituels boute-en-train de nos réunions sont mornes. Seul Danglard, comme mû par un sombre pressentiment ne cesse d'évoquer ses souvenirs de captivité de la dernière guerre.
Lundi 20 Mai
Sur pied de fort bonne heure dans l'attente anxieuse de nouvelles ou d'ordres. Le repli des troupes, remontant vers le Nord, n'a pas cessé de la nuit. Nous notons, avec surprise, combien d'unités ont perdu leurs chefs au cours de la retraite.
Le Colonel avec lequel nous avons maintenu la liaison, ne sait rien non plus. C'est pourquoi le Lt Huet est envoyé aux informations auprès de notre Corps d'Armée. En attendant, promenade solitaire et recueillement dans le parc, au milieu des massifs en fleurs, derrière la maison. Démarche de quelques vieillards, abandonnés par la municipalité, qui viennent implorer des vivres et des moyens d'évacuation.
Huet rentre vers 11 heures avec l'ordre de nous diriger, dans la journée, sur Petite Forêt, au Nord de Valenciennes et où le Bataillon tout entier cantonnera.
A midi, le Bataillon, s'ébranle par la grande route Onnaing Valenciennes. Villas coquettes et plaisantes de chaque coté de la route. Dans un champ, un gros bombardier allemand à la carcasse argentée marquée de la croix noire, gît, écrasé, cassé en deux. Il m'est impossible de retenir les hommes qui se précipitent pour contempler de près cette dépouille et en arracher un débris. Les Cies s'échelonnent sur la route avec, en queue, la file des bicyclettes, les éclopés, les traînards et aussi, hélas, ceux qui se sont attardés dans les caves d'Onnaing et que je houspille et harcèle sans pitié.
Nous atteignons Valenciennes que nous contournons par les faubourgs. Des avions nous survolent très bas et nous avons la satisfaction d'en voir un s'abattre brusquement, dans une traînée de fumée noire, atteint par une rafale de mitrailleuse. Nous faisons successivement deux poses prolongées pendant que François va reconnaître l'itinéraire le plus court et le mieux défilé pour le passage du point le plus délicat, à savoir, un nœud de voies ferrées, constamment bombardées. Premier arrêt devant les voies ferrées. A cet instant je vois nettement la manoeuvre des avions ennemis et les bombes se détacher au moment où l'appareil achève son piqué. Pas un chasseur de chez nous pour inquiéter ces escadrilles qui tourbillonnent impunément au dessus de nos têtes et se succèdent sans arrêt, en un impressionnant carrousel, pour survoler et bombarder les objectifs qui leur sont assignés. Deuxième arrêt à l'entrée du pont, au milieu d'un grouillement de réfugiés qui quittent la ville pour gagner la région de Douai où ils espèrent embarquer et de réfugiés de cette même région et qui reviennent vers nous, désemparés. Il en résulte une lamentable et inextricable cohue de pauvres gens qui tournent en rond, sans plus savoir quelle direction prendre.
La marche se poursuit pénible, mais sans incidents graves jusqu'à Petite Forêt où les éléments de notre Bataillon, mêlés aux unités des plus variées, arrivent enfin de journée. Les 4 Cies sont groupées au centre du village. La 5ème Cie occupe quelques maisons abandonnées et aux trois-quarts pillés déjà, quant au bureau du bataillon et au ravitaillement il prend position à l'extrémité de la cité ouvrière d'où l'on a des vues sur la campagne avoisinante. Personnellement je m'installe au-dessus du bureau ; la chambre voisine de la mienne est occupée par François et Van de Vyver. Nos pauvres chevaux eux aussi à bout de forces, fourbus, sont mis à la pâture dans un verger bien clos.
Mardi 21 Mai
Des troupes tantôt en unités constituées, tantôt par petits groupes continuent à monter vers le Nord. Les bruits qui circulent sont les plus contradictoires. Des batteries d'artillerie viennent prendre position tout autour du village dans les vergers et les jardins.
Pivert rentre du ravitaillement à Valenciennes. Il n'a rien pu toucher, mais il a reçu de l'Intendance l'ordre, qu'il nous transmet, d'avoir à vivre sur le pays. Heureusement que nous n'avons pas attendu cet avis officiel pour le faire. Malgré cela personne ne soupçonne encore que nous sommes complètement coupés de l'intérieur. Je fais aussitôt ramasser les volailles et les lapins qu'on trouve encore en abondance dans les maisons de la cité ouvrière. Toutes sont abandonnées, toutes ont été visitées et laissées dans le plus grand désordre. Pas une qui n'ait son jardin soigneusement entretenu, son poulailler et son clapier. Dans certaines des chiens et des chats sont restés enfermés et meurent de faim et de soif ; il faudra en abattre un certain nombre par crainte de la rage.
La roulante fume. On jette pêle-mêle dans les marmites, une trentaine de poules et de lapins dépouillés et vidés tant bien que mal. Cela tend à devenir le menu de tous les jours. Les jardins nous fournissent les légumes en quantité suffisante mais la question du pain nous apparaît insoluble jusqu'au moment -où nous découvrons un four et quelques sacs de farine. Il y a précisément deux boulangers à la Compagnie que je mets au travail séance tenante. Pendant trois jours, le bataillon tout entier mangera du pain frais sorti de notre fournil à raison de 4 à 5 fournées par nuit.
Vers 11 heures du soir la Compagnie entière reçoit l'ordre de partir en corvée avec ses outils. Elle se rend à 10 km de là, en bordure de la forêt de Raismes où les avions allemands ont coupé la route. Il y a d'énormes entonnoirs qui interdisent toute circulation et qu'il s'agit de reboucher au plus tôt. Tout autour, quelques cadavres d'artilleurs et des carcasses de camions et de caissons incendiés.
Mercredi 22 Mai
L'exode des troupes s'est ralenti, nous voyons même des éléments d'une division motorisée qui passe en sens inverse ce qui donne corps, immédiatement, au bruit qu'une contre-attaque est en préparation. Je m'efforce, entre temps, d'assurer la liaison avec les troupes cantonnées à Petite Forêt. Je fais poursuivre la récupération systématique de la volaille et des légumes ; il va d'ailleurs être prudent de se rationner si notre séjour ici se prolonge. Pour ce qui est du liquide la plupart des hommes de la Cie se sont chargé de leur propre ravitaillement malgré la surveillance que je fais exercer par les sous-officiers et les précautions prises ; c'est à croire que les hommes de ce recrutement ont un flair qui décèle le pinard à une lieue à la ronde. Il y a tant d'hommes ivres que je menace de faire des exemples.
Le Lt Pivert part pour Valenciennes avec ses camionnettes. On lui a signalé les entrepôts d'une coopérative et l'entrepôt des tabacs, l'un et l'autre en flammes et où la troupe s'efforce de sauver les stocks de conserves, de légumes secs et de tabac.
Au soir nous sommes tous réunis à la popote. Un grand plan directeur a été dressé sur le mur et nous essayons d'y situer la position de nos troupes. Un ordre du Général Blanchard, Commandant la 1ère Armée vient de nous parvenir dont nous devons donner lecture aux hommes ; il y est question de résistance à outrance et de contre-offensive. Sur ces entrefaites le vaguemestre rentre avec un chargement volumineux de lettres, les dernières que nous recevrons, mais cela, personne ne l'imagine encore. Je me sauve dans une pâture, comme un voleur pour y lire et relire en paix mes lettres ; la dernière en date est du 14. A la suite de cette distribution où chacun a eu sa part, les visages sont détendus, le moral a remonté de quelques points. Malgré cela le bruit commence à se répandre, insinueux, que nous sommes presque coupés de toute communication avec le reste du pays.
En prévision d'un nouveau départ je fais opérer une révision et une sélection dans les bicyclettes de façon à ce que chaque section ait la sienne et que la Cie n'ait plus l'allure d'une horde. Je fais choix, également, d'un gros tombereau pour y charger les havresacs et refaire un chargement plus judicieux de toutes nos voitures. Enfin j'écris encore quelques lettres, mais avec le sentiment qu'elles n'arriveront pas à destination ; qu'importé, c'est encore une façon de maintenir le contact, ne fut ce qu'en pensée. C'est un acte de foi.
A la nuit quelques coups de feu tout proches. Il y a encore quelques civils à mine patibulaire qui s’accrochent au pays et qui vont et viennent au milieu des troupes. Je fais fouiller, une par une, toutes les maisons de la cité ouvrière. -Tous ces intérieurs modestes mais confortables ont été abandonnés en hâte et visités, depuis, par les troupes en retraite. Les objets les plus divers, le linge, les papiers et les photos de famille gisent sur le plancher, les armoires ont été fouillées et les tiroirs vidés. Les rues également sont jonchées d'équipement, de munitions lancées à la volée, au passage et bécanes inutilisables.
Quelques éclats, le soir, à la popote au cours du dîner entre Danglard et Druet au sujet des embusqués du bureau du Bataillon qui mènent grande vie, dans la maison d'en face, avec des victuailles et des bouteilles récupérées à Valenciennes, pour leur propre compte. La situation a beau être ce qu'elle est, rien, décidément, de ce qui touche au ventre, ne le laisse indifférent.
Nous commençons à être très inquiets au sujet du Docteur Dervaux. Ce dernier nous a quittés à Onniang dans la Ford que conduisait Fauvel ; il allait voir le Colonel qui l'avait convoqué et la seule chose que nous sachions c'est qu'il a été requis, en cours de route, pour transporter des blessés à Douai. Depuis, aucune nouvelle de notre toubib, dont l'absence se fait péniblement sentir dans notre petit cercle.
Jeudi 23 Mai
Les ordres arrivent dans la nuit. Nous sommes rattachés à la 5ème Division qui assure la résistance sur l'Escaut, au Nord de Valenciennes. A deux heures du matin, les 4 Cies du Bataillon se mettent en route, en direction de Bellevue où elles doivent cantonner.
A 6 heures nous arrivons à destination. Nous débouchons sur la grande place de Bellevue à allure de champ de foire avec, au centre, un bouquet de grands arbres. Sur le côté de la place, une petite cité ouvrière faite de tristes et misérables corons où grouillent encore quelques ménages de Polonais. Le reste du village est désert. Il y a du bétail à l'abandon dans les prés et des vaches qui errent dans les rues en meuglant lamentablement. Plusieurs n'ont pas été traites depuis plusieurs jours et ne survivront pas à la fièvre qui les tient.
La nuit venue je m'allonge sur un matelas, dans la boutique d'un coiffeur pour dames, à la sortie du village en direction de Denain dont nous ne sommes qu'à 1500 m au plus. Dans la maison attenante, le bureau et les agents de liaison.
D'après un ordre du Corps d'Armée, la 5ème compagnie est, suite à la disparition du 72ème Régiment d'infanterie en ligne le long de l'Escaut, devant Denain. De bonne heure dans la matinée je pars en voiture avec Huet pour aller me présenter au Colonel du 72ème, au village voisin d'Escaudain. Je l'y trouve à la mairie, une petite mairie abritée le long du chevet d'une vieille Eglise qui a grande allure ; devant la mairie un beau jardin fleuri à l'ombre de grands murs. Le Colonel me donne l'ordre d'aller m'installer entre Denain et Lourches dans une grande cité ouvrière, dénommée cité Bessemer et de prendre contact aussitôt, pour les travaux à effectuer, avec les Commandants des 2 et 3ème Bataillons du 72ème R.I., en ligne.
Vers 6 heures de l'après-midi je pars en bicyclette avec François et deux agents de liaison, les deux plus débrouillards, Chaffenet et Martin, pour prendre contact avec le 72ème R.l.
Bellevue est presque un faubourg de Denain. Des dernières maisons du village nous apercevons la ville, ses usines, ses hauts-fourneaux, ses crassiers. Nous traversons à vive allure le pont et le quartier de la gare, bouleversés et retournés par les bombes. La gare a été coupée en deux par une torpille et, dans les rues avoisinantes, il faut contourner les entonnoirs et les amas de débris pour pouvoir passer. La ville, dans laquelle nous pénétrons, a été relativement épargnée. Quelques magasins éventrés, des barricades dans les rues, édifiées avec des pavés, des tonneaux, des matériaux de toutes sortes. Les soldats se sont amusés à dresser, dessus, des mannequins échappés à des devantures voisines. Après pas mal d'allées et venues dans les rues désertes nous parvenons à découvrir la porte de commandement du 3ème Bataillon. Il est installé dans les caves d'un grand immeuble industriel. On y a rassemblé, les agents de liaison, le téléphone, le poste de secours, le tout éclairé de maigres bougies. On y respire une atmosphère qui me rappelle la guerre de tranchées et nos P.C. en première ligne.
Le Commandant Vautrin nous reçoit et nous accueille à sa table. Belle silhouette de soldat, réconfortante et sympathique. Il va nous préparer aussitôt un plan de travaux pour le secteur de son Bataillon. Il nous confirme que les Allemands sont montés jusqu'à Amiens et que l'ordre est maintenant de tenir les rives de l'Escaut, au bord duquel nous nous trouvons, coûte que coûte, dans l'attente de la contre-offensive qui doit partir de l'intérieur en direction de Cambrai. Il nous confie deux de ses agents de liaison qui vont nous conduire au 2ème Bataillon à 3 km de là, en direction de Lourches. La nuit est tombée et nous ne connaissons rien du secteur ; les Allemands tiennent l'autre rive de l'Escaut, à 50 mètres, en certains points où nous devons passer. Nous nous mettons en route en écarquillant les yeux pour ne pas nous égarer au retour et lorsqu'il s'agira d'y amener la Cie. A défaut de la vue l'odeur nous guidera ; je sais maintenant qu'il faut tourner et changer de direction aussitôt après la vache crevée qui encombre la chaussée, le ventre ballonné et les quatre pattes raides et qui empeste l'atmosphère à 100 m. à la ronde.
À tout moment, coups de feu isolés, rafales de mitrailleuses, éclatement de bombes et de grenades. Les sentinelles nous arrêtent à distance, on ne parle plus qu'à voix basse, nous sommes de plus en plus près de l'ennemi ! Après d'innombrables détours nous échouons dans la cave d'une villa à moitié détruite. C'est là que s'est installé le Commandant du 2ème Bataillon. Prise de contact. La situation y est jugée très sérieuse, mais le moral est bon et les jeunes officiers qui entourent le Ct, gonflés à bloc. Il est convenu avec le Ct que nous arriverons le lendemain dans la nuit et que ma Cie, fractionnée en deux équipes pour les travaux sera cependant groupée, quant à son cantonnement, dans les corons de la Cité Bessemer, entre Denain et Lourches c'est-à-dire à la limite même des bataillons 72ème R.l.
Nous rentrons à Bellevue et je retrouve Danglard et les camarades à la popote. Celle-ci s'est installée dans la dernière maison du village, du côté opposé à Denain. Aussitôt après elle, ce sont les champs et la campagne, campagne toute plate, agrémentée de-ci, dé-là, de cheminées d'usines et de crassiers posés sur le décor comme de vastes pyramides de 50 à 60 m. de hauteur. A 100 m. de nous, dans un jardin une batterie de 75 est venue prendre position, simplement masquée par quelques arbres fruitiers et des filets de camouflage. Toute la journée des escadrilles ont survolé, très bas, la région, bombardant et mitraillant les batteries, les convois, les observatoires. Des heures entières un petit avion d'observation, lent et d'un modèle désuet n'a cessé de nous survoler et de nous narguer. Un seul chasseur de chez nous en serait venu à bout mais nous n'en avons pas vu un seul depuis notre montée en Belgique ! Les artilleurs qui redoutent les observations qu'il effectue tout à loisir l'ont surnommé "le mouchard" et restent silencieux quand il évolue à proximité.
Vendredi 24 Mai
De bonne heure dans la matinée et après une nuit au cours de laquelle l'artillerie n'a cessé de faire rage en direction de Lourches je reprends la voiture et je file à Escaudain, pour rendre compte au Colonel du 72ème de ma reconnaissance de la veille. La voiture me dépose dans le jardin de la Mairie. Le Colonel est sur le seuil, casque en tête, entouré de quelques officiers, penchés sur une carte. Il m'aperçoit et avant d'avoir pu lui rendre compte de quoi ce soit il me met au courant, en deux mots, des événements de la nuit. Au petit jour les Allemands ont réussi à franchir l'Escaut en un point, à hauteur de Roeulx dans le secteur du Régiment voisin, le 45ème, celui auquel est adjoint Renard et sa Cie. Les Allemands ont pris pied dans les marais qui, à cet endroit, bordent la rivière et, de là, cherchent à s'infiltrer en direction du Nord. Il est à craindre qu'ils se rabattent sur nous. Le 72ème s'organise en conséquence en orientant face à droite son bataillon de réserve. Quant à la 5ème et la 6ème Cies qui sont encore à Bellevue elles doivent organiser immédiatement la défense rapprochée du village.
Je rentre précipitamment et mets Danglard au courant de la situation et de ces ordres. En quelques instants les 2 Cies sont alertées. A ma Cie échoit la surveillance et la défense de Bellevue en direction d'Escaudain. Je fais reconnaître des positions de combat et des emplacements de petits postes et je mets la Cie en place. C'est la première fois que nos pionniers sont transformés en véritables combattants. La matinée est calme et la journée s'annonce encore très chaude. Je m'installe dans la cour d'une ferme, à 2 ou 300 mètres de la sortie du village, au centre du dispositif de la Cie. Nous sommes à proximité d'une batterie de 75 qui, chaque fois qu'elle se met à tirer, nous déchire les oreilles. Il y a longtemps déjà que l'infernal "mouchard" nous survole lentement, sûr de lui, sûr, surtout, de l'impunité. Je renonce à faire tirer dessus au fusil mitrailleur de crainte de nous faire repérer et, ensuite, bombarder.
Les heures s'écoulent sans incidents. Le temps est clair. A la jumelle je distingue merveilleusement les moindres détails du paysage, les villages voisins, les cités ouvrières, les crassiers, les puits de mine. Il est peu probable que les Allemands poursuivent leur infiltration en plein jour, à moins qu'il ne s'agisse d'une attaque massive. Les escadrilles ennemies, par groupes de 20 à 30 appareils nous survolent pour aller bombarder les batteries de la forêt de Raismes ou nos défenses du bord de l'Escaut. Elles repassent ensuite au-dessus de nous puis reviennent, elles ou d'autres, sans interruption, implacables et démoralisantes. Dès que "le mouchard" s'est un peu éloigné, nos voisins artilleurs, le torse nu, lâchent quelques rafales de 75 et courent se mettre à l'abri.
Il commence à faire tellement chaud que la nature semble s'être assoupie. Je vais faire une ronde et je constate qu'il en est de même des hommes. La plupart des hommes et même quelques sentinelles dorment à poings fermés, le nez dans l'herbe.
Comme le calme persiste j'envoie les sections, l'une après l'autre, manger la soupe à la roulante. A mon tour, je me fais remplacer par François pour aller manger un morceau, à la popote, toute proche. Ce déjeuner vivement expédié je retourne sur la position. Chaleur, désœuvrement. Je m'assieds sur un timon de chariot et je fais un croquis du paysage pour tuer le temps. Vers 16 heures un agent de liaison du 72ème en moto vient nous informer de la fin de l'alerte. La progression de l'ennemi a été momentanément stoppée par nos chars. La Cie regagne son cantonnement. Nous partirons dans la nuit pour la Cité Bessemer de façon à y arriver avant le lever du jour.
Au cours du dîner, à la popote, un bruit de moteur nous fait dresser l'oreille et nous voyons passer un avion qui vole si bas qu'il frôle les toits. Nous bondissons dehors pensant le voir s'écraser au sol. Il n'en est rien, l'avion continue à voler en rase-mottes, contourne un crassier et disparaît en reprenant de la hauteur. Il est à supposer qu'il a profité de la pénombre pour lâcher quelques parachutistes sur nos arrières. Huet part aussitôt en patrouille avec quelques hommes mais rentre, une heure plus tard, sans avoir rien découvert.
Samedi 25 Mai
La Cie démarre au petit jour pour aller prendre position entre Denain et Lourches qui se suivent sans solution de continuité. J'installe la Cie dans une rue de corons terminée par un cul de sac. La surveillance avec un poste de police à l'entrée unique de la rue s'en trouvera grandement facilitée. Les hommes sont casés par 10 dans chaque maison, toutes vides de leurs habitants. Je prends position avec les sous-officiers, dans une maison voisine, dans la grande rue. Devant nous et derrière nous les usines et les corons misérables avec leurs petits jardins. La cuisine roulante est restée à Bellevue, il serait imprudent de l'amener jusque là. Les légumes et la soupe nous seront amenés ici, une fois par jour, à la nuit tombante avec une voiture conduite par mon ordonnance et sous la surveillance du sergent chef Vandevyver.
Un officier du 72ème vient se mettre en liaison avec nous et nous trace un plan de travaux : constructions de barricades pour fermer les accès de Denain et pose de barbelés dans- la Cité Bessemer, pour parer aux infiltrations de l'ennemi. Pour ce qui est du secteur de droite c'est le Sergent Agnié qui s'en occupe et qui va se mettre en liaison avec le Ct Misart du 2ème Bataillon. La Cie se met au travail dès l'après-midi dans les rues étroites des corons dont quelques maisons de ci et delà, ont été écrasées par les bombes.
Je fais ensuite la visite des boutiques de la grande rue. Toutes celles dont les vitrines ont pu être défoncées sont déjà pillées. Il reste cependant quelques vivres dans les magasins d'alimentation ; je fais rassembler et mettre de côté, soigneusement, tout ce qui est conserves et légumes secs. Il ne manquera que du pain dont il ne saurait plus être question ; dorénavant nous ne mangerons plus que des biscuits. L'entrepôt d'un marchand de vins voisin renferme encore une appréciable réserve d'alcools variés et au moins 200 hectos de vin qui semblent avoir échappé à toutes investigations. Je fais surveiller cet entrepôt par une garde sûre ; je ferai distribuer à chaque homme un litre de vin par jour, prélevé sur cette réserve.
Grâce à un butagaz encore en pleine charge, les sous-officiers ont réussi à préparer un excellent déjeuner chaud avec les conserves et des provisions récoltées sur place. Il n'y manque que le pain. C'est une heure de détente qui nous semble bonne. Coquelin s'installe au piano.
En cours d'après-midi bombardement d'artillerie sur les usines et les crassiers à notre droite, en direction de Lourches. Les bombardements par avion reprennent eux aussi. On voit à l'œil nu, les grosses torpilles quitter l'avion à la fin du piqué. Toutes les maisons du quartier en sont ébranlées jusque dans leurs fondations. Et toujours le "mouchard" qui se promène à sa fantaisie, au-dessus de nos têtes.
Je fais reconnaître de jour, tout le quartier qui sépare Denain de Lourches. Il n'y a que des éléments très dilués pour tenir un secteur aussi étendu. Dans les rues quelques civils et principalement des femmes et des enfants aux figures inquiétantes se faufilent de maisons en maisons ou ressortent des magasins, un ballot sur le dos. Je leur intime l'ordre de rentrer chez eux en leur signifiant, qu'à la nuit tombée, je ferai tirer sur toute personne surprise dans la rue. Je remonte ensuite à Bellevue pour dîner à la popote et reprendre contact avec Danglard. Lorsque je rentre à la Cité Bessemer je trouve un ordre du Ct Misard me priant, vu l'urgence des travaux à exécuter, de mettre en permanence à sa disposition, cinquante hommes qu'il logera dans son secteur, à proximité de son P.C. Les cinquante hommes en question partent pour Lourches sous la conduite des sergents Agnié, Leclerc et Coquelin.
Le soir arrive. Il est à craindre que les Allemands ne renouvellent leur tentative de percée sur droite, auquel cas nous risquerions d'être pris dans un piège, entre les barricades qui transformeraient Lourches et, surtout Denain, en centres de résistance autonomes. En présence d'une perspective aussi peu rassurante je juge prudent d'aller à la recherche d'un cheminement qui nous permettrait d'évacuer la Cie sur Bellevue. La chose serait possible par un dédale de petites rues et, en coupant au court, à travers les hauts fourneaux.
Dès la nuit tombée le bombardement redouble à droite et à gauche. A gauche on reconnaît nettement le tir des obusiers et des canons de tranchée du Ct Vautrin qui, bien approvisionné en munitions, s'est juré de rendre la vie intenable à ses voisins d'en face. Il tient aussi à venger un de ses plus brillants Lieutenant, abattu, quelques heures plus tôt, par une rafale de mitraillette tirée de l'autre rive de l'Escaut. A droite c'est l'artillerie proprement dite qui donne, de part et d'autre. La nuit est noire, ciel d'orage, ciel tourmenté. Un gros incendie, au loin, mais juste dans l'axe de la rue, répand assez de lueurs pour permettre d'apercevoir ce qui nous entoure. Je laisse la Cie équipée, pour le cas d'une alerte avec une section entière sur pied. Un fusil mitrailleur installé dans une tranchée pratiquée à même le trottoir peut enfiler la rue dans les deux sens. Je décide François à aller se reposer et je reste, en bas, dans la rue, pour veiller jusqu'au matin.
La nuit est chaude, étouffante ; petite ondée vers minuit, les premières gouttes de pluie depuis notre montée en Belgique, la terre fume. Allées et venues d'agents de liaison. Un bataillon de renfort, monte en direction du 45ème R.I. L'atmosphère est encore plus lourde après la pluie ; tous les sens sont aux aguets. Il y a eu quelques accalmies passagères mais au petit jour le bombardement redouble. Je fais réveiller François pour aller m'étendre à mon tour.
Dimanche 26 Mai
Dès le début de la matinée la maison est ébranlée par les bombes que les avions déversent sur le crassier où ils soupçonnent la présence d'un observatoire d'artillerie. Nous suivons tous anxieusement le piqué des avions et le départ des bombes pour pouvoir se garer éventuellement. Pour varier les émotions, ce sont, ensuite, des escadrilles de petits avions de chasse qui passent avec un bruit effrayant et inaccoutumé ; il est aisé de se rendre compte que les allemands ont dû monter des sirènes sur le pot d'échappement des moteurs et ce bruit combiné du moteur et de la sirène est de nature à terroriser ceux dont les nerfs ne sont pas à toute épreuve. C'est la guerre des nerfs dans toute l'acception du terme
La situation ne s'étant pas aggravée je retourne déjeuner à Bellevue. Par Danglard je sais que Renard et sa Cie ont dû faire le coup de feu avec les fantassins, au moment de l'attaque des Allemands sur les marais de Roeulx, et qu'ils ont eu quelques blessés.
Dans l'après-midi une camionnette du Bataillon vient à la Cité Bessemer pour faire un chargement de vivres que j'ai récupérées la veille : conserves, barils de vin, sacs de haricots et de lentilles. Toujours des civils suspects qu'il faut constamment refouler de la rue principale sur les corons voisins. La veille, au soir, lorsque la voiture est venue apporter la soupe, quelques coups de feu ont été tirés dans sa direction. L'aviation ne cesse pas ses évolutions ; le "mouchard" est plus harcelant que jamais.
A 18 h un cycliste vient m'apporter un pli m'appelant d'urgence au P.C. du Ct Vautrin à Denain. C'est pour y recevoir encore un ordre de repli, un de plus! Notre droite a été complètement enfoncée et la résistance n'est plus possible sur l'Escaut. C'est sur la Scarpe que va s'établir la nouvelle ligne de résistance. Une Cie du 72ème va rester en position toute la nuit, pour amuser les Allemands et couvrir la retraite. Quant à nous, nous devons partir, dès la nuit tombée avec les autres éléments du 72ème, pour un point situé à 500 m à l'Est de Marchiennes sur la Scarpe que nous devons traverser sur une passerelle jetée, pour la circonstance, par le Génie. Le pont de Warlaing, un peu plus à l'est est réservé aux véhicules qui doivent être tous passés avant 21 heures ; le Génie le détruira aussitôt après.
Je suis extrêmement préoccupé pour nos voitures. Il n'y a pas une minute à perdre. Je donne à François l'ordre de rassembler la Cie et de la mettre en route, le moment venu, sur l'itinéraire que je lui trace sur la carte. Ceci fait je file ensuite, à toute allure, sur Bellevue. Le temps est de plus en plus lourd, de lourdes nuées d'orage s'accumulent sur nos têtes. J'ai hâte de voir Danglard, dont le silence m'inquiète. Lorsque j'arrive il vient tout juste de recevoir, de son côté, l'ordre de repli. Il n'est que temps de faire filer nos voitures quitte à abandonner sur place une partie du chargement. Il n'y a même plus une minute à perdre. Je fais venir le Caporal Cherrier et lui donne dix minutes pour charger ses voitures, avec le strict indispensable, atteler et prendre la route au trot.
A ce moment précis, l'orage éclate, avec une violence inouïe, accompagné d'une trombe d'eau et grêle. Les roulements du tonnerre arrivent à couvrir les échos du bombardement. Nous nous réfugions, un instant, dans la salle du dispensaire, sur la place. Les voitures sont chargées ; pour une fois les conducteurs ont réalisé le sérieux de la situation et ont fait des prodiges. Au moment de faire monter Mirza dans la voiture, coup de tonnerre assourdissant ; la chienne casse sa corde et, folle de peur, file ventre à terre. Adieu Mirza ! La pluie continue à tomber en trombes alternant avec la grêle. La roulante et les autres voitures s'ébranlent à toute allure et je prends les devants, en bicyclette, pour guider le convoi. En un clin d'œil je suis traversé jusqu'à la peau ; le papier sur lequel j'ai noté notre itinéraire et la carte que je consulte à chaque carrefour sont des loques détrempées. A Escaudain je disparais jusqu'au moyeu dans une mare que l'averse a formée sur la place. Je cherche un long moment la route d’Erre ; c'est un officier de chars, dont les engins sont sous pression dans la cour d'une ferme, qui me met sur la bonne voie
L'orage se calme. Ciel balayé, lueurs de couchant sur les flaques de la route, atmosphère détendue. Les voitures suivent au trot, bondissant sur les gros pavés. Nous abandonnons peu à peu le décor des jours précédents ; ce sont maintenant des prairies, des canaux, des marais, de petites fermes isolées en torchis. Pays bien irrigué. Nous approchons de St-Amand-les-Eaux.
A 9 h 1/2 et après avoir fait 15 km à train d'enfer nous atteignons la passerelle du Pêcheur à l'est de Marchiennes. Les sapeurs du génie sont à pied d'œuvre pour détruire le pont, le moment venu.
A quelque cent ou deux cents mètres de la passerelle j'engage les voitures dans la cour d'une grande ferme. Tout est au complet. Il ne manque que le Caporal Cherrier qui est resté en panne, dans la hâte du départ. Nous nous installons à tâtons dans la salle basse de la ferme, allumons une bougie et commençons à dîner avec une boîte de singe et quelques biscuits. La Cie, elle, a dû prendre la route sans avoir dîné. Il nous reste encore quelques heures à attendre avant que François ne passe la passerelle avec la colonne.
Nous sommes dans la ferme depuis une heure à peine que surgissent deux officiers d'Etat-major. Ceux-ci sont porteurs d'un ordre général destiné à tous les éléments qui traversent la Scarpe. Cet ordre est de repartir aussitôt pour gagner Maulpas en direction de Lille. Les Allemands progressent plus vite que nous et la défense, impossible sur la Scarpe, est reportée sur la Lys. J'ai tracé tant bien que mal, sur la carte, l'itinéraire que nous devons emprunter. Danglard et Huet nous rejoignent sur ces entrefaites avec les voitures de la 8ème Cie. Après nous être concertés, nous décidons d'attendre les voitures des autres Cies. C'est moi qui, une fois qu'elles seront toutes regroupées, les conduirai à Maulpas. Quant à Danglard il va guetter les 4 Cies au passage de la Scarpe pour leur communiquer l'ordre de déroutement et leur tracer leur nouvel itinéraire. Comment les hommes après avoir fait plus de 15 km dans la nuit trouveront-ils la force d'en faire encore 20 ou 25 sans le moindre repos et le moindre repas ?
Je parviens dans l'obscurité à regrouper toutes les voitures du Bataillon et je charge le sergent chef Echinard, perché sur le cheval de Tourgis de marcher en tête du détachement et de reconnaître la route. Pour ma part, je vais et viens, en bicyclette de la tête à la queue de la colonne et inversement pour m'assurer que tout suit sans à-coups. Nous sommes absolument éreintés. Personnellement j'ai dormi deux à trois heures, au plus, la nuit précédente. La route est balisée, comme pour notre montée en Belgique, mais l'encombrement dépasse toute imagination. Il y a une division entière, de 15 à 20.000 hommes sur la même route : piétons, convois hippos, batteries d'artilleries, voitures de liaison se doublant sans cesse en rejetant les malheureux fantassins dans les fossés. Nous devançons constamment des colonnes d'infanterie, elles-mêmes dans un désordre inextricable.
Lundi 27 Mai
Lorsque le jour se lève nous atteignons une grande route, une route nationale, je suppose, qui mène à Lille et que nous allons suivre un certain temps. Dès qu'il fait assez clair l'aviation allemande reprend ses attaques massives. Toutes les agglomérations en bordure de la route ont été atteintes.
Vers 8 heures nous arrivons à Maulpas, petite bourgade à 2 ou 300 mètres à l'écart de la grande route. Là aussi, et bien qu'il ne s'agisse que d'un groupe de pauvres petites fermes, il y a des maisons en ruines ou incendiées. Des convois de toutes armes y stationnent déjà. J'ai beaucoup de peine à trouver une misérable petite ferme abandonnée où abriter nos voitures. Les propriétaires l'ont évacuée mais une famille de réfugiés belges y campe, avec des vieillards et des enfants. Nous sommes à bout de forces. Les voitures mises à l'abri sous les auvents des hangars et les chevaux abandonnés en liberté dans une petite pâture je fais évacuer la salle à manger de l'habitation et m'y installe avec Vandevyver, les deux secrétaires et les agents de liaison. Je ne tarde pas à m'endormir sur une chaise sans avoir eu seulement la force de me déséquiper.
Vers 11 heures Danglard, Huet et Pivert arrivent en voiture devançant de peu les premiers éléments du Bataillon. Je suis informé que la 5ème Cie, la plus éloignée, ne peut guère arriver avant les premières heures de l'après midi.
Des escadrilles de 40 à 50 avions, mi-bombardiers, mi-chasseurs commencent à bombarder la route de Lille, les carrefours et les agglomérations. Ce sera, du point de vue de l'aviation, la journée la plus dure de toutes. L'arrosage ne cesse pas. A tout instant la maison est secouée par les explosions, certaines toutes proches. Il y a, dans la chambre voisine et la maison d'en face des gosses que j'entends hurler d'épouvante. Nos chevaux, fous de terreur, le poil hérissé, courent en tous sens dans leur enclos.
A midi nous déjeunons tant bien que mal avec Danglard, Huet et Tourgis. C'est Echinard qui s'est débrouillé pour trouver quelques victuailles et s'est transformé en cuisinier.
Il est 15 heures. Aucune nouvelle de la 5ème Cie. Les 3 autres sont arrivées, non sans avoir laissé de nombreux isolés en cours de route. A ce moment, redoublement des attaques d'avions. A 2 ou 300 mètres de nous la route de Lille ne cesse d'être arrosée et nous voyons, à l'œil nu, les grosses bombes se détacher des avions. C'est un vrai carrousel ; les appareils tournent en rond dans un bruit infernal de moteurs et de sirènes, des gros bombardiers laissent tomber leurs torpilles et les petits chasseurs qui les suivent tirent à la mitrailleuse, en piquant à la queue leu leu sur le but. Ils suivent la route en file, tournent, virent au-dessus de nous pour retourner prendre la route d'enfilade.
A 16 heures François et les premiers éléments de la Cie font leur apparition, fourbus, claqués. Comme je l'appréhendais ils se sont trouvés sur la route au moment des bombardements, à proximité d'un groupe de camions mis en feu par des torpilles. Les hommes qui n'ont pas mangé depuis 24 heures se jettent comme des bêtes sur la soupe qui les attend puis s'endorment, là où ils sont, d'un sommeil de plomb. Plusieurs sont estropiés, les pieds en sang.
18 heures. Ordre de départ impératif ! Il n'y a qu'un moyen de remettre les hommes sur pied, c'est de leur faire comprendre qu'il ne reste plus qu'une chance de salut, atteindre au plus tôt la Lys et s'y cramponner dans une défense opiniâtre. Je m'y emploie de mon mieux et je ne parviens pas sans peine à mettre la Cie sur pied. Il y a des hommes et des sous-officiers, effondrés sous le poids de la fatigue et du sommeil que nous ne parvenons pas à réveiller. A 19 heures cependant nous repartons par la route de Lille, en colonne par un de chaque côté de cette grande avenue de façon à trouver abri instantanément dans les fossés qui la bordent. Danglard, Huet et Pivert partent de leur côté avec les autos et notamment le camion qui contient nos cantines, pour Seclin. Nous ne devons plus nous revoir et, à partir de cette heure, c'est moi qui vais avoir la lourde responsabilité du Bataillon tout entier.
Nous progressons maintenant vers le Nord. Je suis recru de fatigue. J'ai, dans ma gourde une réserve de rhum à laquelle je n'ai pas encore eu recours. De temps en temps j'en bois une gorgée et grâce à ce coup de fouet je repars en avant. Pour m'alléger j'ai accroché ma musette et mon masque à l'arçon de la selle de mon nouveau cheval. C'est le sergent Filleul, blessé et incapable d'aller plus loin qui le monte.
Vers minuit nous arrivons sur un plateau découvert d'où l'on doit découvrir, en plein jour, tout le pays avoisinant. Nous avançons péniblement, toutes les 5 minutes la colonne stoppe. Tout à coup, rafale d'obus percutants et fusants qui nous sont manifestement destinés et qui nous jettent, brusquement dans les fossés. A l'horizon, lueurs d'incendies et des fusées qui montent dans le ciel dans toutes les directions. Je dis bien dans toutes les directions et cela signifie que le cercle s'est refermé autour de nous et qu'il n'y a plus, vraisemblablement, aucune voie pour échapper à l'ennemi. Qu'importe, s'il y a encore une chance, une maigre chance à courir, nous la courrerons.
A cet instant il me semble reconnaître dans la nuit la voix familière de Chambraud. Je m'approche. Effectivement c'est Chambraud qui fait la pause, le long de la route avec ce qui lui reste de son 3ème Bataillon, 300 hommes au plus et un seul officier, le Lt Van Der Hagen. Nous décidons de marcher de concert dans la direction d'Armentières et d'associer jusqu'à la fin notre mauvaise fortune. Chambraud d'ailleurs, a conservé l'énergie et le cran que je lui ai toujours connus.
Nous poursuivons la marche en avant. Les lueurs d'incendies se rapprochent. Le flot des troupes grossit rapidement. Nous sommes à tous moments dépassés et bousculés par les chars et les colonnes d'artillerie qui foncent dans la nuit, sans souci des obstacles. A un carrefour, nous devons, Druet et moi, mettre revolver au poing et nous porter au milieu du carrefour pour arrêter momentanément ce flot de voitures qui menace de couper notre colonne, notre misérable colonne de fantassins. J'ai vu le moment où Druet, au comble de l'exaspération allait abattre le chauffeur d'une voiture de liaison bondée d'officiers et de cantines, laquelle s'obstinant à vouloir foncer en avant.
Malgré cela notre colonne est constamment bloquée et chaque arrêt nous coûte 10 minutes ou I/4 d'heure et chaque minute perdue consacre notre impuissance. La marche est de plus en plus épuisante. A 2 km de Seclin arrêt complet. Devant et derrière nous, les troupes et les convois que la route ne parvient plus à contenir, ont débordé dans les champs, ce qui accroît encore la confusion et l'enchevêtrement des unités.
Nous coupons, nous aussi, à travers champs pour gagner Seclin. Le centre de la petite ville n'est plus qu'un immense brasier qui projette vers le ciel des tourbillons d'étincelles et des lueurs rougeoyantes : un spectacle infernal. Dans notre hâte de pousser en avant nous nous laissons absorber par un immense flot mouvant qui s'efforce de contourner la ville par la droite. Nous parvenons après d'invraisemblables efforts mais, de l'autre côté de Seclin nouvel arrêt. Nous sommes arrivés à l'entrée du pont qui enjambe le canal et sur lequel doivent nécessairement s'écouler toutes les troupes accumulées aux alentours de Seclin. Il nous faut une heure, deux heures, peut-être d'attente fébrile pour le franchir.
Tout autour de ce point de passage le bombardement a fait rage ; ce ne sont que trous et cratères occasionnés par l'explosion des torpilles d'avions, cadavres, chevaux éventrés, camions incendiés qu'il faut enjamber ou contourner tant bien que mal. La course en avant reprend aussitôt de plus belle. Nous arrivons à une fourche ; à droite, dans la direction que nous devons suivre c'est de nouveau un enchevêtrement inextricable. A gauche, l'autre route, qui a du être réservée au matériel roulant est noire à perte de vue, de camions. Nous avons l'impression Chambraud et moi, qu'il serait possible de passer en faisant progresser nos hommes en colonne par un le long de la file des véhicules.
Sur deux kilomètres au moins nous longeons une colonne de chars et camions tassés les uns contre les autres. Capots et arrières de voitures se touchent, les conducteurs, recrus de fatigue dorment sur les volants. Nous questionnons, au passage, quelques officiers. Ceux-ci ne savent rien sinon que la tête de colonne s'est heurtée à des éléments ennemis qui interdisent le passage. Maintenant, les véhicules sont si étroitement collés les uns aux autres qu'il est impossible, à aucun d'entre eux, de faire demi-tour. Ce formidable matériel est maintenant figé sur place, immobile, impuissant. Où sont les Etats-majors impuissants à remettre de l'ordre dans ce chaos ?
Cette nouvelle étape nous mène à Blanbourdin. Nous sommes maintenant à proximité de Lille. Il est deux heures du matin. Nous débouchons sur la place de l'Eglise. Là aussi, maisons éventrées et traces de bombardement. Des soldats dorment sur les trottoirs, des officiers inquiets, désemparés vont et viennent de tous côtés.
Mardi 28 Mai
Et maintenant que faire ? Où aller, Nous sommes irrémédiablement livrés à nous-mêmes. Nous nous engouffrons Chambraud et moi dans l'Eglise et, là, à la lueur d'une lampe électrique nous jetons un coup d'œil sur la carte. Nous essayons de repérer la route d'Armentières puis, finalement, nous décidons de filer sur Lille pour traverser ensuite la Lys et chercher, vers le nord, un passage. Nous avons encore avec nous la 5ème, la 6ème et quelques éléments de la 8ème Cie et enfin les débris du 3ème Bataillon, en tout 5 à 600 hommes. Des voitures il n'est plus question, elles sont restées coincées, quelque part, derrière nous et nous ne les reverrons plus. Avec elles, ma cantine, ma valise et mille choses personnelles qui me tiennent particulièrement à cœur.
Nous reprenons la route et, déjà, le petit jour commence à poindre lorsque nous débouchons face à une voie d'eau. Il s'agit de la Deule canalisée. Nouvel arrêt. Il y a bien un pont devant nous mais les troupes qui nous précèdent ont été saluées par des rafales de mitrailleuses. Pas de doute possible, nous arrivons trop tard ; l'ennemi occupe les ponts de la Deule, ou tout au moins celui-ci.
Nous tournons à droite en longeant le canal. Les Cies s'échelonnent le long du mur d'une usine. Petit jour lugubre, silence inquiétant ; on dirait une aube d'exécution capitale. Devant nous, à pied, tête basse, suivi de son Etat-major, nous voyons passer le Général Meslier, commandant de la célèbre division marocaine. Il est suivi de son escorte de goumiers, la carabine au poing. Il se dirige vers le pont suivant à la recherche, comme nous tous, d'une fissure dans le cercle qui se resserre d'heure en heure autour de nous.
Il ne saurait être question de rester ainsi à découvert au moment même où le jour se lève. Le Lieutenant Van der Hagen qui habite Lille et qui connaît bien Loos, où nous sommes maintenant, s'offre à faire une reconnaissance dans les environs immédiats. En attendant, je fais effectuer l'appel de la Cie, réduite à moins des 2/3 de son effectif, et je dépêche, Martin le cycliste le plus débrouillard, à la recherche du Sergent Filleul, auquel j'ai confié mon cheval et qui a du lâcher la colonne entre Haubourdin et Loos. Je ne verrai revenir ni Martin, ni Filleul, ni mon cheval, à la selle duquel j'avais accroché ma musette contenant ma trousse de toilette et un peu de linge. Cette fois je suis dépouillé de tout, il ne me reste plus que ce que j'ai encore sur le dos.
Van der Hagen revient et prend la tête de la colonne pour nous conduire, tout près de là, dans une grande propriété, celle du filateur lillois Thiriez. Grande villa, tapissée de lierre et isolée au milieu d'un grand parc enclos de murs. Il y a là de grands arbres, sous lesquels nos hommes seront à couvert, sinon à l'abri. Des artilleurs avec quelques pièces de 55, leurs réserves de munitions et d'essence et des anglais avec des camions bourrés de ravitaillement s'y sont déjà réfugiés.
Nous nous enfermons, Chambraud et Van der Hagen, dans le grand fumoir de la villa pour délibérer. Nous décidons, pour y voir un peu clair, de tenter la liaison, d'une part avec Lille et le Commandement que nous supposons devoir s'y trouver, et c'est Van der Hagen qui va essayer ; d'autre part avec les troupes voisines dans Loos et c'est Chambraud qui s'en charge. En leur absence je commence à faire rassembler dans le sous-sol de la villa tout ce qui m'est signalé comme traînant à l'abandon dans le parc. Ce sont des caisses provenant de l'intendance anglaise : biscuits, corned-beef, bacon, rhum, cigarettes.
Chambraud rentre peu après. Il a pris contact avec nos voisins les plus proches, un bataillon du 110ème R.l. dont un officier d'un régiment voisin vient de prendre le commandement. Il s'agit du Capitaine de La Motte Saint Pierre. Celui-ci a déjà commencé l'organisation du quartier en centre de résistance. L'usine Kuhlman en bordure de laquelle nous avons stationné ce matin le long de la Deule en constitue le noyau. Quant à Van der Hagen il nous rejoint à son tour. Il ne lui a pas été possible de pénétrer dans Lille car les Allemands y sont déjà, occupant les principaux bâtiments publics et quelques points d'appui. Seules entrent et circulent librement en ville, du consentement même de l'ennemi, les autos sanitaires chargées de blessés.
La situation semble pouvoir se résumer comme suit : l'ennemi occupe Lille et encercle les grosses agglomérations de sa banlieue, entre autres Loos où nous nous trouvons, mais aussi Lomme, Haubourdin..., où ont reflué en masses des troupes venant de la région de Valenciennes. Les éléments épars, imbriqués les uns dans les autres, sans commandement supérieur, sans liaison, ont cependant une idée commune, à savoir s'organiser en centre de résistance sous le commandement d'un chef unique, qui reste encore à trouver, et de tenir sur place le plus longtemps possible, dans l'espoir et l'attente d'une contre-offensive qui ne saurait manquer de venir à notre secours du Nord ou du Sud-Ouest.
Il nous apparaît prudent, ne fut-ce que par crainte des bombardements que nous n'allons pas manquer de subir, d'éparpiller notre occupation. Les éléments du 3ème Bataillon avec Chambraud et Van der Hagen resteront là où ils sont déjà et les éléments du 2ième Bataillon partiront avec moi, Tougis et Druet pour occuper, à 200 mètres delà, le château de Mr Lievin Danel, le gros imprimeur de Lille. Les deux parcs sont contigus et communiquent par un très vaste jardin potager. Les liaisons d'un bout à l'autre pourront s'effectuer aisément.
L'installation commence. Somptueuse résidence au milieu d'un parc de 3 à 4 hectares. Un canal longe la façade de la maison où l'on accède par un pont et un large porche. Vastes pelouses qui s'étalent devant la façade principale, grandes frondaisons, vénérables platanes. Devant les communs qui s'alignent sur un des côtés de la propriété il y a des massifs flamboyants de rhododendrons.
Les hommes s'installent, partie dans les communs et la maison du portier, partie dans le grand salon du château où je fais rouler dans un coin les tapis et les meubles précieux ; Chambraud et Van der Hagen viendront prendre leur repas avec nous dans la petite salle à manger. C'est dans le grand hall, à la fois salon, fumoir, salle de jeux et qui débouche de plain-pied sur le parc par de vastes portes fenêtres que nous camperons et passerons la nuit.
Je continue à faire inventorier et emmagasiner tout ce que nous pouvons récupérer de conserves anglaises : bacon, marmelade, biscuits et cigarettes. Il y en a encore quelques pleins camions dans ce parc-ci. Avec les légumes que nous trouverons en abondance dans le potager, il y a de quoi tenir mais en rationnant de façon très stricte dès maintenant, 5 à 6 jours environ.
J'explore les deux étages du château pour y trouver un peu de linge dont je suis complètement démuni. Tout décèle la fuite précipitée des propriétaires et des domestiques. Au rez-de-chaussée, surélevée de quelques marches et débouchant dans le grand hall, il y a une minuscule bibliothèque en forme de chapelle gothique. Elle renferme un nombre assez restreint d'ouvrages mais triés par un amateur au goût très sur, rien que des éditions rares et des reliures de prix. Les papiers de famille, la correspondance personnelle traînent encore sur le bureau. Je suis presque tenté de m'installer dans le fauteuil du maître de la maison, de fermer la porte et de me plonger dans la lecture de tel ou tel ouvrage familier. Sur le grand piano à queue du salon, la photo de la maîtresse de maison entourée de tous ses jeunes enfants. Quant à la propriété dans son ensemble, elle est entourée de grands murs et fermée aux bruits de l'extérieur ; nous ne sommes cependant qu'à 400 mètres au plus de la Deule canalisée dont l'ennemi tient la rive opposée.
Je tiens à ce qu'aucun de nos sous-officiers et même aucun de nos hommes n'ignore la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je les réunis en cercle et leur communique le peu de renseignements que je possède, je ne leur dissimule pas qu'il faille s'attendre à combattre durement, car plus nous tiendrons longtemps, plus nous aurons de chance d'être secourus. Je prends ensuite à part Coquelin et isolés, tous les deux, dans un coin reculé du parc nous faisons un petit culte.
Au soir nous apprenons que la résistance s'organise peu à peu sous la direction et l'impulsion d'un des nombreux généraux enfermés, comme nous, dans les faubourgs de Lille. Les unités se regroupent, les secteurs se délimitent. Nous avons devant nous, tenant la tête de pont et la rive du canal des éléments du 110ème R.l. auxquels nous allons apporter l'aide de nos 4 à 500 pionniers.
La journée prend fin. Elle a été paisible. Peu d'artillerie. Seule l'aviation nous a survolés et, encore, sans trop bombarder, soit que les Allemands nous sachant encerclés nous négligent pour des objectifs plus importants, soit qu'ils se regroupent en vue d'une action décisive.
Tourgis, Druet, l'adjudant François et moi, nous passons la nuit dans les grands fauteuils de cuir du hall. Les portes-fenêtres qui débouchent sur le péristyle devant lequel s'étendent, en pente douce, les gazons et les plans d'eau, sont restées entrouvertes. D'un bond nous pouvons être dehors. L'un de nous veille à tour de rôle, les autres sommeillent, tout équipés.
Mercredi 29 Mai
Dès le matin nous établissons la liaison avec le Bataillon du 110ème R.I. Le Capitaine de la Motte vient nous mettre au courant du regroupement des forces qui s'opère à Loos même. La difficulté est extrême. Elle provient de la multiplicité et du mélange des unités, quelques unes sans commandement car, hélas, quelques officiers ont filé et tenté de s'échapper sans plus se soucier de leurs hommes. Quelques autres officiers, en outre, sont partisans d'une reddition immédiate ; c'est, toutefois, le parti de la résistance qui l'emporte.
Nos pionniers se voient assigner une double tâche : travailler au renforcement de la position par la construction de barricades aux extrémités de toutes les rues débouchant sur le canal, à la défense des positions elles-mêmes et en cas de repli, du centre de résistance que constituerait la propriété Danel, que nous occupons.
Au cours de la nuit précédente les artilleurs et les quelques Anglais qui rôdaient encore autour de leurs camions ont disparu, les artilleurs avec leurs pièces mais les Anglais en abandonnant la totalité de leur matériel. Nous constatons aussi le départ précipité du groupe sanitaire installé dans la rue voisine. Cela est grave car nous sommes dépourvus de médecins et de médicaments ; si nous avons des blessés, ce qui est à craindre, il faudra les évacuer à bras et nous ne savons où.
Le déjeuner nous réunit dans la petite salle à manger. Le cadre est accueillant à souhait, le linge fin, l'argenterie somptueuse. Nous avons quelques conserves et biscuits et de la salade qui provient du potager voisin. Druet s'est occupé du vin. La cave, à l'instar de la bibliothèque a été constituée avec discernement. Elle abonde en bourgognes des grandes années et de Champagne des meilleures cuvées. Notre camarade a failli avoir une attaque en constatant dans quelle proportion la réserve de bouteilles a pu baisser au cours de la nuit et cela malgré la présence d'une sentinelle à l'entrée de l'escalier qui mène à la cave. Un seul détail lui avait échappé, c'est l'existence à l'autre extrémité de celle-ci d'un soupirail au ras du sol et qui peut laisser passage, à la rigueur à un visiteur leste et assoiffé.
Et maintenant au travail. Comme la nuit le bruit risque de gêner l'écoute des veilleurs c'est de jour que nous allons commencer la construction des barricades, mais en prenant, toutefois, les plus grandes précautions. Nous menons, François et moi, la Cie à pied d'œuvre en traversant de bout en bout l'usine Kuhlman, jusqu'aux ruelles qui débouchent sur le canal de la Deule et que nous devons obstruer. Nous trouvons sans peine sur place les matériaux appropriés sous forme de sacs de ciment que nous entassons, jusqu'à hauteur d'homme, de part et d'autre de la rue et à l'abri desquels, ensuite, les hommes progressent. Le travail est déjà bien avancé lorsque les Allemands qui se sont aperçu de nos manœuvres nous envoient quelques rafales de mitrailleuses, mais il est trop tard, nos travailleurs sont maintenant suffisamment abrités.
J'erre un instant dans l'usine abandonnée et apparemment déserte. Notre occupation n'est pas très dense ; de ci, delà mais a des emplacements judicieusement choisis, une mitrailleuse ou un fusil mitrailleur avec son équipe réduite au minimum et composée de jeunes ou, tout au moins, qui me paraissent jeunes au regard de nos vieux pionniers. Un véritable monde cette usine Kuhlman ! J'appréhende ce que pourrait donner un bombardement systématique sur ces magasins pleins de bonbonnes d'acides ou sur ces immenses réservoirs d'ammoniaque.
Aucune nouvelle de l'extérieur. Quelques sapeurs du génie livrés à eux mêmes, puis un sous-lieutenant indigène, séparé de son régiment viennent se mettre à notre disposition. Ce dernier nous amène deux sections de tirailleurs avec leur armement au complet. Nous allons les incorporer dans notre système défensif.
Après dîner je pars avec Chambraud pour voir les autres Cies au travail sur différents points du secteur. Nous emmenons deux agents de liaison et, à défaut de grenades, dont nous sommes totalement dépourvus, nous nous munissons de pistolets automatiques et de mousquetons. Nous constatons au cours de notre ronde combien de civils sont restés sur place. Les caves et les sous-sols des usines en regorgent. A l'usine Kulhman, entre autres, des femmes et des enfants sont venus s'entasser, quoi qu'on ait pu faire pour s'y opposer, dans les sous-sols, à quelques pas de nos mitrailleuses, là où ils seront le plus exposés en cas de coup dur.
Nous avançons avec prudence. Les divers éléments du secteur, qui s'ignorent encore sont sur un perpétuel qui-vive. Il est indispensable de se faire reconnaître des sentinelles par des coups de sifflets convenus et encore à bonne distance, faute de quoi, on risque fort un coup de mousqueton. A trois reprises différentes nous sommes arrêtés par des postes de garde qui nous remettent entre les mains des civils suspects. L'un d'eux est un jeune condamné, à la pâle figure de gouape, devant lequel se sont ouvertes le matin même les portes de la prison de Loos. Il y aussi un flamand sans papiers et un vieillard en apparence déséquilibré mais qui n'est peut-être qu'un dangereux espion. Nous les poussons devant nous pour les remettre au Capitaine de La Motte vers le P.C. duquel nous nous dirigeons.
Le Capitaine de La Motte est là, entouré des agents de liaisons et dans un état d'exaltation extrême. Il nous prend par le bras et nous entraîne au dehors, sur les marches du perron de la villa qu'il occupe. Et là, dans la nuit, pour l'instant tout à fait calme et sereine il nous confie, à voix basse, ce qu'il sait de la situation. Pour lui, et d'après les renseignements qu'il a recueillis dans la journée, il n'y a plus aucun espoir; s'il faut tenir encore c'est pour l'honneur et aussi pour infliger à l'ennemi le plus de pertes possibles, en le contraignant à un assaut meurtrier et à de sanglants combats de rues. Quant à lui, il se déclare résolu à ne pas tomber vivant entre les mains des ennemis. Il a pris ses dispositions pour tenir avec son bataillon jusqu'à la dernière extrémité, après quoi il tentera de fuir vers nos lignes en compagnie de son ordonnance. Il a pris, à cet effet, les dispositions les plus méticuleuses. Il nous plaint, Chambraud et moi, qui, d'une autre génération que la sienne avons fait la grande guerre, d'en arriver là et de vivre des heures aussi douloureuses. Et ce magnifique soldat, qui nous domine de la tête et qui évoque avec sa casaque de cuir et son casque sans visière un centurion romain, étouffe un sanglot, nous donne l'accolade et s'enfuit vers son bureau dont nous entendons claquer la porte.
Nous poursuivons notre ronde, silencieux, impressionnés par cet entretien. Des incendies, de plus en plus nombreux, illuminent la nuit, aux quatre coins de l'horizon. De longues rafales de mitrailleuses déchirent le silence de la nuit et sifflent au-dessus de nos têtes, nous contraignant à des plats ventres prolongés. Nous regagnons nos emplacements sans encombre. J'ai de la peine à m'endormir malgré la fatigue ou, peut-être, à cause de la fatigue et l'énervement. Je reste assis un long moment sous le péristyle de la villa. Il y a de temps à autre de longues accalmies pendant lesquelles on distingue nettement, venant de l'ouest, un roulement lointain et prolongé ; aucun doute n'est permis, l'artillerie fait rage à quelques 50 ou 100 km d'ici. Nous avons un tel besoin d'accrocher notre espoir à l'indice le plus ténu que nous voulons y voir la contre-offensive qui progresse vers nous, pour délivrer l'armée des Flandres.
Lundi 30 Mai
L'artillerie commence à se déchaîner avant même le lever du jour, la nôtre, qu'une oreille exercée parvient à distinguer de l'autre, crache par rafales précipitées, occasionnant, comme nous l'apprendrons plus tard des brèches sanglantes dans les rassemblements ennemis. Plusieurs de ces pièces sont en position, tout près de nous, sur une vaste place et tirent dans les intervalles laissés par de grands immeubles de 6 étages.
Quant aux obus ennemis ils s'éparpillent autour de nous sans viser particulièrement le point où nous nous trouvons. Dans une prairie voisine les artilleurs ont abandonné de nombreux chevaux blessés qui vont et viennent, lamentables, sans une plainte. L'un d'eux marche sur ses entrailles pendantes, comme un cheval de picador dans l'arène, un autre a la langue à moitié sectionnée par un éclat.
Nous pressentons que la fin du drame est proche. La conversation que nous avons eue, la veille avec le Capitaine de La Motte, me hante. Dès que je vois Chambraud, je le prends à part et je lui demande, à brûle pourpoint, s'il accepterait de tenter sa chance lorsqu'il apparaîtra que nous allons être pris et qu'il n'y a plus rien à tenter. C'est oui, d'emblée. Il y avait, lui aussi, longuement réfléchi, déjà. Il propose d'associer Van der Hagen à notre tentative et, moi, François. Quant à Drouet et Tourgis ils ne sont pas en état, pas plus au physique qu'au moral de tenter le coup ; inutile donc de s'en ouvrir à eux. Nous reprendrons la conversation le plus tôt possible.
J'étudie maintenant la façon dont nous pourrions organiser la défense de la propriété elle-même. Nous pouvons être attaqués de face où tournés de deux autres côtés. Par derrière nous sommes couverts par le Bataillon Chambraud. Nous pouvons d'ailleurs être aussi bien pris à revers par des troupes débouchant de Lille. Je suis absolument désemparé, je n'ai même pas à ma disposition un plan de Lille et des environs, j'ai fouillé en vain tous les tiroirs du château pour en trouver un.
Nos hommes, trop gâtés depuis le début de la campagne, trouvent sévère le rationnement auquel ils sont maintenant soumis. Pour éviter toute discussion nous alternons, François et moi, pour surveiller la distribution des vivres. Je soupçonne certains débrouillards d'avoir visité les camions dès notre arrivée ici et de s'être constitué des réserves personnelles. C'est pourquoi je fais effectuer la fouille des sacs, de façon à ce que le rationnement pèse sur tous également.
Aussitôt après le déjeuner, qui n'est pas plus copieux que celui des hommes et qui est expédié sans entrain, j'envoie un sous-officier pour abattre à coups de pistolets les chevaux blessés que j'ai repérés ce matin. S'il apparaît indispensable nous pourrons abattre aussi une bête indemne et la débiter pour nourrir notre petite garnison.
Brusquement les rafales d'obus se rapprochent et paraissent se concentrer sur nous. Cette fois c'est du gros calibre, du 105 ou du 150. Un avion est passé un instant plus tôt très bas qui a dû apercevoir nos allées et venues dans le parc et en a fait son profit. Inutile de donner l'ordre de se terrer. En un clin d'œil les hommes se sont aplatis dans les tranchées et n'en bougent plus. J'ai trouvé un abri relatif sous le porche du château avec Tourgis et Druet et nos agents de liaison. De là nous pouvons surveiller tout le parc. Les obus pleuvent maintenant de droite et de gauche et nous commençons à être entourés d'une fumée épaisse et acre dont, à vingt ans d'intervalle, j'ai conservé le goût au fond de la gorge. L'un d'eux vient éclater à quelques mètres derrière le porche où nous sommes encore rassemblés. Les éclats ont traversé les vitres de la salle à manger, criblant les boiseries, les poutres, la rampe de l'escalier ; une autre gerbe d'éclats est allée saccager toutes les vitres d'une serre à une vingtaine de mètres de là. La fumée dissipée nous nous comptons, nous nous palpons, nous sommes tous indemnes et c'est un vrai miracle. Deux heures durant, deux longues heures interminables nous allons rester là, les nerfs tendus sous les rafales que nous entendons venir et qui s'abattent un peu partout régulières, implacables.
Le calme revint avec le soir. Je me retrouve avec Chambraud. Il m'apporte l'adhésion de Van der Hagen et, moi celle de François. A quatre nous sommes décidés à tenter l'aventure. Ce qui pour un isolé serait une tentative très hasardeuse mérite d'être tenté par une équipe bien homogène. Nous écartons d'emblée l'idée de nous habiller en civils ce qui serait grave en cas d'échec. Nous envisageons de nous jeter au dernier moment dans une des nombreuses maisons abandonnées qui nous entourent et de nous y terrer dans la cave ou le grenier pendant deux ou trois jours. Une fois passé le flot des troupes ennemies nous essayerons de filer, de nuit, en direction du sud-ouest. Nous ne nous chargerons que de vivres, boussoles et cartes Van der Hagen nous servira de guide pour quitter les environs de Lille. Le gros obstacle et nous ne nous le dissimulons pas sera la traversée des rivières. Demain matin j'irai faire choix de la maison qui doit nous servir de cachette.
La journée s'achève dans le calme. L'attaque finale et décisive que nous attendons est remise à demain, sans doute. Il ne faut cependant pas songer à dormir. Nous aurions d'ailleurs de la peine à trouver le sommeil. Je rentre au château et m'enferme dans la bibliothèque. Je m'y recueille quelques instants et je griffonne une lettre d'adieu à celle et à ceux vers qui ma pensée n'a cessé d'être tendue, heure par heure depuis le début de l'aventure. L'enveloppe est libellée et placée dans la poche de ma vareuse de façon à ne pouvoir passer inaperçue en cas d'accident.
Vendredi 31 Mai
Le bombardement a repris au cours de la nuit, allant en s'intensifiant d'heure en heure. Les coups partent maintenant de tous côtés. Il est impossible de distinguer les départs des arrivées, ni le son des batteries allemandes de celui des nôtres, tant elles sont proches les unes des autres et tirent à courte distance. Tous ceux des pionniers qui ne sont pas de garde se sont terrés dans de nouvelles tranchées étroites et profondes que j'ai fait hâtivement creuser aux endroits découverts, au milieu des pelouses car, depuis hier, les Allemands utilisent des obus à fusées extra sensibles qui éclatent au contact de la plus petite branche. Les autres sont échelonnés en tirailleurs le long du mur de la propriété.
Je suis allé repérer la maison où nous pensons pouvoir trouver refuge, le moment venu. C'est un intérieur modeste, celui, je présume d'un ouvrier de l'une des usines voisines. Tout est resté en ordre comme si son propriétaire devait y rentrer d'un instant à l'autre. J'y dépose la réserve de vivres dont je me suis muni. La maison est discrète, un peu à l'écart de la rue, masquée par quelques arbres, c'est tout à fait ce qui nous convient.
La matinée s'écoule, interminable, avec de brusques accalmies et des recrudescences chaque fois plus violentes qui font sursauter. Vers 11 heures quelques rafales s'abattent en plein sur les deux propriétés, coupant en deux un arbre du parc et faisant deux morts et quelques blessés au 3 ème Bataillon. Le problème de leur évacuation se pose aussitôt. Nous n'avons ni médecin, ni médicaments, ni voiture sanitaire. Un débrouillard parvient à mettre en marche un des nombreux camions garés sous les arbres, le tailleur improvise un fanion à Croix Rouge et les blessés sont aussitôt dirigés sur Lille où les Allemands les hospitaliseront et les soigneront. Ceux qui sont morts sont enterrés, séance tenante, dans le parc, le long du mur de clôture.
Nous déjeunons en hâte pendant une accalmie qui, en se prolongeant, devient pesante car nous sommes convaincus qu'elle ne peut que préluder à l'assaut final. J'admire l'inconscience de nos hommes. Plusieurs d'entre eux, insouciants des rafales qui peuvent s'abattre d'un instant à l'autre et les mettre en pièces, cueillent de la salade dans le potager, deux autres, au milieu du parc, accoudés à la barrière du pont pèchent, avec des lignes de fortune, les carpes du bassin. Il est vrai que nous vivons en vase clos, à l'abri des mouvements de l'extérieur et que nos hommes ne connaissent ni nos craintes, ni nos angoisses.
Tout à coup, colporté par des tirailleurs marocains qui traversent le parc en courant et vont se mettre en position dans les rues latérales, se répand le bruit, que l'ennemi a réussi à franchir la Deule et s'infiltre dans Loos. C'est la bataille des rues qui commence. En certains points nos 75 débouchent à 0 sur les camions et les groupes ennemis qui progressent leur occasionnant des pertes sanglantes. Nous risquons d'être en contact d'un instant à l'autre. Je me concerte avec Chambraud pour savoir si nous devons persévérer dans une défense, maintenant sans espoir ou nous préparer à la reddition. Nous n'avons plus aucune liaison avec le commandement local et sommes, plus que jamais, livrés à nous-mêmes. J'ai, pour ma part, la responsabilité du bataillon, près de 800 hommes, et elle me pèse lourdement sur les épaules. Chambraud, dont le cran n'a pas failli, penche pour la résistance jusqu'à la dernière extrémité, mais avant tout autre chose nous allons essayer de reprendre le contact avec le Capitaine de La Motte, ensuite, nous aviserons.
Chambraud y part et, sur mon insistance se fait accompagner d'un agent de liaison, le célèbre Bouboule. Une demi-heure ou trois-quarts d'heure après nous voyons réapparaître Bouboule toujours souriant, mais à bout de souffle. Il lui faut quelques instants pour se remettre, après quoi il nous explique que le Capitaine Chambraud et lui ont retrouvé le Capitaine de La Motte à l'intérieur de l'usine Kulhman où il a battu en retraite. Perché sur un crassier d'où il domine les environs et entouré de quelques fusils mitrailleurs il tire sur les Allemands qui se faufilent de maison en maison, comme sur des lapins à la chasse. Au retour Chambraud a voulu s'arrêter dans une maison où la veille encore se trouvait un officier du 110ème R.I. La porte ouverte sans hésitation il s'est trouvé nez à nez avec un Allemand. Surprise réciproque. L'Allemand l'a mis en joue mais Chambraud avec un réflexe aussi rapide a sorti son revolver et, comme l'Allemand, reculait de quelques pas pour appeler au secours, Chambraud suivi de Bouboule se sont éclipsés à toutes jambes. Et Bouboule que cet incident ne semble pas avoir autrement impressionné rit à gorge déployée. La conclusion c'est qu'il faut que nous nous tenions sur nos gardes et que l'ennemi s'infiltre de tous côtés.
Le bombardement a repris, plus violent encore que dans la matinée et les avions passent et repassent très bas, en vagues serrées et rapides, lâchant leurs bombes un peu partout. Les tirailleurs indigènes qui se sont repliés sur nous, ainsi que nos pionniers échelonnés le long du mur du parc, tiraillent sur les Allemands que nous voyons progresser par bonds rapides, de couverts en couverts. Nombreux sont ceux qui ne se relèvent pas.
Nous tenons les trois côtés de la propriété le quatrième est appuyé sur la propriété qu'occupé et que défend Chambraud. Des balles sifflent maintenant au-dessus de nos têtes et leur claquement sec indique qu'elles sont tirées tout près de là. Il n'y a plus aucune illusion à se faire, aucun espoir à conserver. Nous sommes déjà virtuellement prisonniers. Je brûle les papiers militaires que je détiens, roule une couverture et enfourne dans une musette un peu de linge, quelques conserves, une poignée de biscuits. Je demande à mes sous-officiers de faire prendre à leurs hommes des précautions identiques. Ce que je redoute c'est que la prise de contact ne tourne au massacre, car les Allemands, depuis trois jours, ont subi trop de pertes, pour ne pas réagir violemment contre cette résistance imprévue et obstinée. Déjà hier leurs avions nous ont lancé des tracts menaçants, pour le cas où la résistance se poursuivrait.
L'heure du dîner est arrivée. Nous l'avions tous oubliée sauf Druet qui nous rappelle à la réalité. Nous ne voulons pas laisser passer cette occasion, la dernière sans doute, de manger en commun. Chambraud et Van der Hagen qui devraient être là ont laissé passer l'heure eux aussi et Druet s'offre à aller les chercher. Il n'y a qu'un saut à faire, le potager à traverser. A l'instant même où il débouche dans l'autre parc un réflexe le jette brusquement derrière le tronc d'un gros platane. A 100 m. devant lui, les débris du 3ème Bataillon, Chambraud et Van der Hagen en tête, défilent en direction de la sortie de la propriété, encadrés de fantassins allemands. L'infiltration de l'ennemi s'est effectuée simultanément par derrière et par devant et ce sont les éléments débouchant de Lille qui sont arrivés les premiers sur nous. Cela s'est fait si rapidement que Chambraud et ses hommes ont eu à peine le temps de tirer quelques coups de fusil et le bruit de la lutte s'est perdu dans celui du bombardement. Sans Druet nous ne nous serions aperçus de rien.
Deux problèmes se posent maintenant, aussi angoissants l'un que l'autre. Nous allons être attaqués par le seul côté où nous n'avons pas prévu de défense puisqu'il était tenu par le 3ème Bataillon. Il n'est plus temps de le faire, d'ailleurs à quoi bon ? Nous avons tenté tout ce qui était humainement possible et le devoir me semble devoir être maintenant d'éviter à tout prix un contact sanglant. Je demande à Tourgis, Druet et François de me donner à tour de rôle et en toute liberté, leur opinion. Les avis sont unanimes.
Nous décidons, en conséquence, de n'opposer aucune résistance aux Allemands lorsqu'ils se présenteront sur un point quelconque de la propriété et de hisser le drapeau blanc au-dessus du porche.
L'autre problème ne concerne que moi, C'est celui de notre projet de fuite. Privé de Chambraud et Van der Hagen je ne me sens plus le courage de tenter l'aventure et surtout d'y entraîner François. Les événements ont pris une tournure que nous n'avions pas prévue hier. En outre la situation est telle que je ne me sens pas le droit de fausser compagnie aux camarades et aux hommes à un moment particulièrement critique. Mon devoir si nous avions été dispersés en plein combat eût peut-être été de prendre la fuite pour tenter de rejoindre nos lignes, il est maintenant de rester. Cela s'impose à mon esprit, sans discussion possible.
L'attente devient terriblement pesante. J'ai les nerfs à bout et j'ai hâte que se déroule le dernier tableau du drame lamentable auquel nous sommes mêlés depuis 3 semaines.
Mais voici que des rafales d'obus s'abattent maintenant sur le parc. J'entends des cris qui partent du fond et j'aperçois des silhouettes qui vont et viennent, affolées, dans un nuage de fumée épaisse et acre. Un obus malheureux est venu percuter en plein sur une de nos tranchées. Il y a plusieurs morts et de nombreux blessés. Les plus légers d'entre eux se sont précipités vers le château pour chercher abri dans la cave où nous avions improvisé un poste de secours.
Il faut aller chercher les autres sur des brancards cependant que se succèdent d'autres rafales qui saccagent la propriété. En hâte on les allonge dans le hall où nous couchions, sur des matelas posés à terre. Pendant ce temps on descend des couvertures et des draps pour préparer des bandes et pansements.
Ils sont maintenant huit ou dix qui gémissent doucement ou hurlent à plein gosier lorsqu'on arrache leurs vêtements lacérés. Le Sergent-chef Braconnier a, dans le dos, un trou gros comme le poing et, déjà, crache le sang. Il s'inquiète de la gravité de sa blessure et chacun s'efforce de le rassurer sans beaucoup de conviction. Nous n'avons hélas qu'un infirmier qui ne sait plus où donner de la tête ; l'adjudant François et quelques bonnes volontés se dépensent sans compter pour lui venir en aide. La grande pièce, qui fut le décor de tant d'heures heureuses est maintenant un vrai charnier, le sang coule sur le plancher ; sur le piano, à coté de la photo de la maîtresse de maison et de ses enfants il y a un amas de linges sanglants et maculés.
Je sors bien vite de cette pièce la gorge serrée, j'ai besoin de conserver tout mon sang froid. A cet instant même je vois surgir sous le porche un groupe d'allemands. Les précédant de quelques pas, un officier, pistolet au poing, encadré de deux hommes, la mitraillette sous le bras, la bande de cartouches jetée autour du cou, les manches de grenades dans l'ouverture des bottes. Le gros de la troupe doit être immédiatement derrière.
Je me porte aussitôt en avant, seul, les bras tendus pour signaler que viens en parlementaire. Personne n'a tiré. Je me présente, en allemand comme le commandant de la garnison et je précise qu'il s'agit de pionniers c'est-à-dire beaucoup plus des travailleurs que de combattants. L'officier dont le calme et l'extrême jeunesse m'ont tout de suite frappé fait signe, à ceux qui l'accompagnent et commencent à apparaître sous le porche de stopper. Lui-même s'arrête, me rend mon salut et me demande de rassembler la garnison désarmée.
J'appelle Tourgis, Druet, François et leur transmet cet ordre. Au coup de sifflet les hommes qui ont assisté à cette scène se rassemblent rapidement devant la façade et déposent sur la pelouse armes et munitions. Je sais gré à l'officier de ne pas fouiller les officiers et de se fier à ma parole. J'ai d'ailleurs eu le temps de lancer dans le canal mon revolver et mes jumelles, vieux et précieux souvenirs de l'autre guerre. Je lui signale ensuite la présence de nos blessés à l'intérieur de l'habitation et de nos morts dans le parc. J'insiste sur le fait que plusieurs de nos blessés sont gravement atteints et que leur état requiert une intervention urgente. Il note ce que je lui signale et m'assure que le nécessaire sera fait aussi rapidement que possible, que les blessés seront transportés à Lille et les morts enterrés à l'emplacement même où ils sont tombés.
Je jette un coup d'œil sur les ennemis qui nous entourent. A l'image de leur commandement de Cie, tous sont extraordinairement jeunes ; j'admire leur calme qui contraste tellement avec le lamentable affolement dans lequel nous avons vécu ces jours derniers. J'admire aussi leur équipement et leur armement, si bien adapté, léger, maniable. Tous ces hommes portent la tunique courte, les manches retroussées ; aucun n'est embarrassé de sac et de musettes. Alors que les nôtres ploient sous la charge d'un invraisemblable barda ceux-ci ont l'équipement et l'allure de jeunes athlètes.
La colonne s'ébranle. Je suis en tête avec l'officier allemand qui marche à ma hauteur et engage aussitôt la conversation en allemand. Ses premiers mots sont pour me dire - thème immuable de la propagande nazie - que l'Allemagne n'a aucune haine contre la France, qu'elle lui a toujours tendu une main fraternelle, que le Fuhrer ne veut que l'extermination de l'Angleterre, des puissances d'argent et des Juifs. Lui-même qui a perdu son père à Verdun a la guerre en horreur et s'apitoie sur les ruines que nous côtoyons à cet instant même.
Nous traversons Loos où l'ennemi achève le nettoyage des derniers centres de résistance. Autour de nous ce ne sont que traces encore chaudes et fumantes des combats qui viennent de prendre fin. Débouchant d'autres rues, quelques débris de la célèbre Division marocaine défilent et nous voyons, stupéfaits, les Allemands présenter les armes à leur passage. Un officier, un artilleur, il me semble s'est raidi dans un garde à vous impeccable et à peine à retenir ses larmes. Nous apprendrons plus tard que le Général von Reichenaù qui commande devant Lille a manifesté son admiration pour la défense des faubourgs, en accordant les honneurs militaires à quelques-unes des unités qui y prirent part.
En parcourant les rues et en dépit de la nuit qui tombe nous voyons de toutes parts les traces de la lutte. Quelques cadavres étendus sur le trottoir, des canons de 75 que les servants ont fait sauter après avoir tiré à bout portant. On imagine sans peine avec quel carnage ont été menés ces combats de rues. Une grande usine, une filature achève de se consumer ; des pans de murs léchés et noircis par les flammes s'écroulent dans un fracas assourdissant et un tourbillon d'étincelles et il nous faut faire un crochet tant la chaleur qui se dégage du brasier est intolérable. Des obus isolés passent encore en miaulant au-dessus de nos têtes, derniers sursauts de la résistance.
Nous quittons l'agglomération de Loos pour gagner la campagne et couper à travers une succession de terrains vagues. La nuit est complètement tombée et nous nous dirigeons maintenant vers une immense masse sombre qui émerge à deux ou trois cents mètres devant nous. Il s'agit de la nouvelle faculté de médecine, en cours de construction et où l'ennemi a installé un poste de commandement important. Des centaines de prisonniers y sont déjà parqués, assis ou couchés en pagaille dans une vaste cour cimentée que surplombent de tous cotés, les 7 ou 8 étages de la bâtisse inachevée.
Il y a beaucoup d'effervescence dans cette masse grouillante. On s'interpelle dans le noir, on échange des nouvelles, voire des plaisanteries. Détente, joie humaine, joie animale d'avoir échappé à la mort, premier réflexe qui tourne à nouveau l'individu vers la vie ! Va-et-vient ininterrompu, au milieu de nous, de voitures militaires, motocyclistes, plantons, éclairs fugitifs des lampes électriques. Il règne chez l'ennemi une animation intense mais tout y semble parfaitement ordonné.
L'officier qui nous a capturés et conduit jusqu'ici me propose quelques cigarettes et prend congé, strict, correct. C'est un autre officier, en tenue de campagne, également jeune qui nous prend en charge. Il s'excuse de ne pouvoir mettre à notre disposition quelques autos confortables mais m'offre à prendre place dans sa propre voiture. Druet, Tourgis et nos deux adjudants s'entassent dans une voiture militaire qui va suivre la nôtre. Il a ordre de nous conduire au Centre de la Jeunesse annexe de la Foire de Lille. Nous traversons la ville à vive allure et dans une obscurité profonde. Plus d'électricité, pas une lumière aux fenêtres, tout semble mort. Il nous faut contourner des voitures renversées, des poteaux de trolleys abattus sur la chaussée dans un enchevêtrement de fils et toutes sortes d'obstacles. Il nous faut surtout la virtuosité de notre conducteur pour ne rien accrocher au passage.
Nous voici à destination. Le centre de la Jeunesse est un vaste bâtiment élevé à l'intérieur de la Foire commerciale. Il y a déjà là des centaines d'officiers de toutes armes et de tous grades, jusqu'à des généraux, qui dorment, effondrés dans toutes les positions sur le dallage des salles et jusque sur les marches des escaliers. La fatigue est telle et le sommeil à ce point profond qu'on croirait un alignement de cadavres sur les dalles d'une morgue. Nous avons une peine inouïe en enjambant et piétinant quelque peu ceux qui sont déjà installés à trouver assez d'espace pour nous allonger. Et aussitôt le sommeil se saisit de nous, un sommeil de brute, un sommeil que rien ne saurait troubler.
Les étapes de la captivité
Lille 1er Juin
Vers 8 h nous sommes réveillés par le brouhaha des allées et venues. J'ai dormi côte à côte avec Tourgis sous la même couverture, la tête sur nos musettes. C'est alors la ruée vers les rares prises d'eau. Nous sommes cinquante, plus peut-être, à prendre d'assaut un pauvre filet d'eau, pour essayer d'effacer une crasse de plusieurs jours. Au rez-de-chaussée du bâtiment il y a une boite en carton avec un amoncellement de lettres. Information prise, les Allemands permettent d'y déposer les lettres des prisonniers, certains s'empressent d'ajouter que ce n'est qu'un piège pour connaître nos réactions et notre moral et que ces lettres n'ont aucune chance de parvenir à destination. Qu'importé, je griffonne en hâte, appuyé le long du mur, deux lettres que je jette à mon tour dans la boite. Je m'accroche à cet espoir que mes lettres viendront vite calmer des angoisses que je n'ose imaginer.
Au cours de la matinée quelques autocars viennent enlever les officiers blessés qui se trouvent parmi nous et les plus éclopés. Les autres, et je suis du nombre, sont rassemblés en colonnes et nous quittons Lille. Nous traversons de nouveau ses faubourgs mais a l'opposé, cette fois, de Loos et, ensuite, la grosse agglomération industrielle de Fives. Beaucoup de civils aux portes, principalement des femmes et des enfants qui nous regardent défiler. On doit lire sur nos visages les traces de nos fatigues et de nos privations car de tous cotés on nous tend du pain, des œufs, du chocolat, du vin, de la bière. Nous nous jetons dessus comme des bêtes. On nous jette des paroles de réconfort et d'encouragement. Les sentinelles qui nous surveillent, débordées et impuissantes laissent faire, en houspillant, sans rudesse, ceux qui s'attardent. Si l'on était sûr des civils qui sont là, sur le pas de leurs portes, il serait facile de se jeter dans un couloir et de s'y terrer, mais il y a trop de témoins pour tenter l'aventure.
La route est longue et dure. J'ai sur le dos ma musette, mon porte carte et une couverture. Nous traversons sans nous en rendre compte - c'est la troisième fois en moins de 3 semaines - la frontière. Vers 10 heures nous atteignons Tournai.
Tournai 1er- 2 Juin
Nos guides arrêtent la colonne à la sortie de la ville sur un terre plein herbeux, sorte de terrain vague, au pied d'une grande bâtisse rébarbative et sévère et qui n'est rien d'autre que la prison. Aux allées et venues nous devinons qu'elle est déjà pleine de prisonniers de guerre. Pour l'instant nous n'avons rien d'autre à faire qu'à nous coucher dans l'herbe. Les officiers se regroupent par unités où échangent des impressions, chacun fait l'inventaire de ses pauvres bagages et de ses vivres. J'ai encore dans ma musette quelques biscuits et trois boites de conserve, les camarades à peu près autant. C'est heureux car personne ne semble se soucier de notre nourriture. Les sentinelles qui nous gardent vont et viennent parmi nous, l'une d'elles offre des cigarettes que quelques camarades attrapent, au passage, avidement. Ce geste leur vaut une apostrophe retentissante du Colonel Vendeur, du 7ème tirailleurs, porteur de l'épée que les Allemands lui ont laissée. Il fait appel à leur dignité d'officiers français.
Sur la grande route qui passe à proximité des colonnes de prisonniers défilent sans arrêt. Tout à coup nous nous dressons, il nous a semblé reconnaître, parmi toutes ces épaves, quelques figures connues. Ce sont tous les pionniers, capturés à Loos, avec nous, qui nous dépassent. En tête je reconnais Bresson, puis Coquelin et puis la foule des autres, tous les survivants du Bataillon. Je me précipite vers eux et toutes les mains se tendent vers moi dans un dernier adieu. Je me cramponne, mais lorsque le dernier a tourné le dos les larmes que j'ai eu tant de peine à retenir, se mettent à couler et je cours m'allonger par terre, la figure dans l'herbe. Au bout d'un instant, François qui a compris le drame qui se joue en moi, vient me rejoindre me tape sur l'épaule et très gentiment s'efforce de me réconforter.
Le soir arrive, sans changement. Alors seulement on se décide à nous faire entrer dans la prison qui déjà regorge d'occupants, prisonniers de toutes armes et de tous grades. C'est la lutte féroce pour trouver un coin ou s'allonger. D'ailleurs il n'y a pas de choix, ce ne peut être qu'une des centaines de cellules de cette prison modèle. Les cellules s'entassent sur plusieurs étages le long de galeries bordées d'un balcon de fer et qui, construites en étoiles convergent toutes vers un poste central de surveillance et de guet. Nous parvenons à nous assurer la propriété de deux cellules contiguës. Nous logerons à six dans ce qui constituait, quelques jours plus tôt l'espace vital de deux prisonniers de droit commun. Pas de ravitaillement. Nous commençons à prélever sur nos réserves de quoi faire un maigre repas : une boîte bacon anglais et quelques biscuits pour six. L'un de nous, qui a découvert une prise d'eau, remonte un seau plein et à tour de rôle nous barbotons avec délices. J'en profite, ô quel luxe, pour me raser. Malgré ce que le décor peut avoir d'hallucinant, avec son mobilier de détenu et la lourde porte et son guichet, nous nous étendons sur le plancher, à trois par cellule et, rapidement, le sommeil nous emporte. Au matin c'est le bruit des allées et venues sur le balcon métallique, le claquement des portes et les courbatures qui nous rappellent à la réalité. Grand remue-ménage dans toutes les parties de la prison. Nous y sommes d'ailleurs livrés à nous-mêmes, il n'y a de gardiens et de sentinelles qu'au poste de garde de l'entrée, sous le grand porche surmonté du lion des Flandres.
Ath 2 Juin
Des détachements se constituent pour une nouvelle étape. Je suis incorporé à l'un d'eux avec Tourgis et Druet et l'on nous embarque rapidement, dans de grands cars réquisitionnés en Hollande et dont la destination première était de véhiculer, ô ironie, des noces et leurs cortèges'. Nous ignorons tout de notre destination. Nous traversons quelques villages où sont visibles encore les traces des combats de ces jours derniers, sur les murs des maisons, des affiches blanches, fraîches collées, surmontées de l'aigle et de la croix gammée avec les prescriptions impératives de la Kommandantur locale. D'autres placards sur des maisons particulières signalent leurs propriétaires, de race flamande, à la bienveillance des troupes d'occupation. La randonnée est de courte durée. Nous arrivons très rapidement à Ath où les autocars s'engouffrent dans la cour de la caserne, grouillante, elle aussi de prisonniers. Les autocars ont peine à s'y frayer un passage, on ne sait où mettre les pieds.
L'aspect de ces bâtiments sordides à quatre étages est aussi rébarbatif, sinon plus, que celui de la prison que nous venons de quitter. A chaque fenêtre des prisonniers qui ont dû passer la nuit dans cette caserne. Faute d'un coin tranquille ou seulement d'une marche pour s'asseoir nous restons debout, notre barda sur le dos, parqués entre quatre murs comme du bétail à l'abattoir. Dans un coin de la cour, du côté des écuries on distribue une soupe. C'est aussitôt une ruée sauvage, que je contemple écœuré, et dont je reste à l'écart. A l'autre extrémité de la cour devant un autel de fortune, dressé sur caisse à conserves, un aumônier célèbre la messe. J'observe sa haute silhouette légèrement voûtée, ses cheveux drus et grisonnants, sa figure jeune et qui rayonne d'une extraordinaire douceur.
Comme hier à Tournai, une fournée se constitue de temps à autre, au hasard dans cette masse grouillante et franchit la porte de la caserne pour une nouvelle étape. J'ai hâte de fuir ce décor sinistre et étouffant, de retrouver le grand air. Je me faufile avec Tourgis et Druet, dans une colonne qui se rassemble près de la sortie et, sans plus tarder, nous repartons. La chaleur est torride et mon chargement mal arrimé. Je sue à grosses gouttes sous ma capote dont je n'ai pas voulu me séparer, et ma couverture en sautoir, les courroies de mes musettes me coupent les épaules. Cette fois, plus d'autocars. Devant nous la route poudreuse, sur nos têtes le soleil de Juin, impitoyable et, sur nos épaules, tout ce que nous avons réussi à sauver du désastre. Nous allons marcher ainsi des heures entières, sans un mot, faisant passer de temps en temps la charge d'une épaule sur l'autre -les sentinelles et le sous-officier qui nous conduisent sont assez compatissants pour ralentir l'allure, prolonger les pauses et veiller à ce que nous puissions nous ravitailler en eau fraîche à chaque arrêt de temps à autre nous croisons des convois allemands, files de camions gris foncé, matériel tout neuf, troupes jeunes qui chantent des marches entraînantes et scandées. Le long de la route des équipes de spécialistes, le torse nu, réparent des véhicules en panne, dégagent un carrefour, montent des lignes téléphoniques. De chaque côté des champs de blé dont les épis lourds attendent la moisson prochaine, et, au milieu d'eux une profusion de coquelicots et de bleuets. Par endroit aussi, une croix plantée, au point précis où est tombé celui qu'elle recouvre et, sur chaque croix un casque, casque kaki à grenade, casque rond et lourd d'Allemand, casque large et plat de Britannique.
Enghein 2-6 Juin
Vers 17 heures, arrivée à Enghein. Avant les premières maisons de la ville la colonne s'engage et stoppe dans un champ qui borde la route. L'herbe y a été longuement piétinée et les détritus qui la jonchent indiquent que d'autres convois y ont été parqués avant nous. De l'autre côté de la route un grand bâtiment qui peut être aussi bien un hôpital qu'un établissement scolaire et où vont et viennent des prisonniers. Aussitôt arrêtés la plupart d'entre nous s'étendent par terre, se déchaussent, certains s'endorment. Les plus valides et les plus débrouillards vont se presser le long de la clôture où quelques femmes et des enfants distribuent des tartines et s'offrent à faire quelques achats en ville. De nouvelles colonnes continuent d'arriver et viennent s'installer, elles aussi, dans notre enclos.
La soirée s'achève. On se décide alors à nous faire entrer dans le grand bâtiment d'en face. C'est le Collège St Augustin, un de ces grands internats religieux comme il en existe quelques-uns en Belgique, célèbres par leur confort et la qualité de leur enseignement. Il est déjà plein à craquer du rez-de-chaussée au grenier. Il y a des hommes de toutes armes, y compris des Marocains, des Belges, des Anglais dans les salles d'études, les laboratoires, les amphis. Les officiers occupent les vastes dortoirs, constitués par des rangées de petites alvéoles fermées par un rideau blanc. A l'intérieur de chacune d'entre elles un mobilier qui rappelle celui d'une cabine ; une couchette étroite, un placard, une table de toilette minuscule.
C'est dans ce décor, combien moins rébarbatif que celui de nos deux précédentes prisons que nous allons végéter pendant 6 jours, désœuvrés, livrés à nous-mêmes, simplement surveillés par un piquet d'allemands qui gardent les issues. Dès le lendemain de notre arrivée je retrouve dans la masse des prisonniers du rez-de-chaussée le sergent chef de la 7ème Cie qui s'empresse de me signaler la présence de Renard. Joie de retrouver notre vieux camarade. Nous sommes maintenant six officiers du 604ème regroupés. Deux jours plus tard un médecin français autorisé, pour les besoins du service, à circuler en ville nous glisse un mot de Chambraud. Ce dernier est interné, tout près d'ici, au couvent des Clarisses.
Avec le mobilier de deux petites couchettes contiguës - il y en a dans ce grand dortoir St Augustin 4 rangées de 50 environ - nous parvenons à organiser le couchage de notre petit groupe. Trois d'entre nous dormiront parterre sur les deux sommiers accolés, les trois autres sur les deux matelas.
Notre dortoir est au deuxième étage. Au-dessous de nous, par les grandes baies du couloir, la vue s'étend au loin sur la campagne. A nos pieds la pelouse grouillante de prisonniers vautrés dans toutes les positions et, de l'autre côté de la grille, la route que nous avons prise pour venir ici. Juste en face, la prairie où nous avons été parqués en arrivant de Ath.
Pendant trois jours nous allons être les témoins, sur cette route, d'une activité fébrile et vraiment hallucinante. Descendant sans arrêt vers le sud-ouest, c'est-à-dire vers la France, des convois de troupes avec des cris de joie et des chants bien disciplinés, des troupes jeunes, gonflées à bloc par une avance irrésistible. Toutes ces troupes sont motorisées, rares sont les unités qui se déplacent à pied. Le matériel roulant est neuf, uniforme, formidable de puissance. Certains camions sont des monstres impressionnants, traînant derrière eux deux ou trois remorques pleines de matériel humain, de ravitaillement ou de munitions. Alternant avec les convois d'infanterie motorisée, des batteries antichars ou anti aériennes, des services d'aviation, des convois de voitures sanitaires. Sur presque toutes les voitures des dessins ou des inscriptions à la craie où dominent les " Nach Paris" et les " Nach London". C'est l'armée hitlérienne, dans toute sa puissance, qui défile sous nos yeux.
Dans l'autre sens, comme soigneusement orchestré, les convois de prisonniers se succèdent sans arrêt - troupeau lamentable et pathétique, remontant des Flandres françaises vers le cœur de la Belgique. Certains jours nous évaluons leur nombre à dix mille. Dans certains convois ce sont les troupes indigènes qui prédominent, dans certains autres nous découvrons jusqu'à des marins capturés vers Calais ou Dunkerque. Beaucoup sont dans un état de délabrement qui fait peine à voir, les pieds blessés par la marche, les vêtements déchirés, n'ayant conservé du casque trop lourd que la coiffe de cuir. Parfois les traînards sont stimulés à coups de crosse ou de matraque. Chaque soir la grande prairie qui nous fait face accueille un de ces mornes troupeaux pour la nuit. Alors les feux de bivouacs s'allument de tous côtés, dans la nuit de Juin, et le spectacle de cette misère humaine, que nous contemplons de notre 3 ème étage, évoque en moi tel passage de la Débâcle où V. Margueritte a décrit si puissamment les rassemblements de prisonniers de 1870 sous Sedan.
Le ravitaillement reste toujours la grosse question à l'ordre du jour. L'intendance allemande, submergée sans doute par une telle masse de prisonniers, semble incapable de nous nourrir et se désintéresse de nous. Le peu qui nous sera distribué pendant notre séjour à Enghein le sera par les soins de la Croix Rouge belge de la ville. De temps à autre la femme du bourgmestre et ses filles viennent s'enquérir de nos besoins, un camion vient décharger des boules de pain blanc ou de quoi confectionner une soupe dans les somptueuses cuisines du collège. La distribution de cette maigre pitance donne lieu à des assauts furieux et des scènes épiques. C'est la foire d'empoigne la plus hideuse. Pour remédier à l'inévitable pagaïe un colonel français tente de répartir les quelques milliers de prisonniers en groupes de ravitaillement. C'est déjà une amélioration sensible, mais toutes ces mesures sont impuissantes à éviter la resquille de la faim et toutes les bassesses qu'elle entraîne, d'une faim qui commence à nous tenailler dur. Il faut voir la rapidité avec laquelle nous voraçons le quart de boule ou l'écuelle de soupe que nous parvenons à attraper au vol, avec quel regard mauvais nous considérons certains groupes privilégiés, officiers d'Etat-major ou d'unités motorisées qui se sont repliés jusqu'ici avec leurs voitures, leurs uniformes impeccables et d'abondantes provisions.
Ce régime ajoute à notre lassitude. Lorsqu'il me faut monter les trois étages qui mènent à notre dortoir j'arrive en haut les jambes molles et pesantes la sueur au front. Beaucoup d'entre nous ont trouvé des livres - il en traîne partout dans le bâtiment - et passent des heures entières allongés sur leur matelas ou sur la pelouse, le livre sur les genoux et le regard vague. Désœuvré, j'erre dans les classes, les amphithéâtres, les laboratoires, je vais fouiller dans la bibliothèque.
A force d'insister nous obtenons de nos gardiens l'autorisation d'envoyer en ville quelques délégués, sous bonne escorte, pour y faire des achats de vivres et d'objets de première nécessité. A l'autorisation succède un contrordre puis, après deux jours de négociation une autorisation, cette fois, définitive et formelle. Les délégués sortiront par groupes de dix et auront deux heures pour effectuer leurs achats. Pour dix délégués officiellement désignés par sortie il y en a cent qui se battent à la grille devant un feldwebel impuissant. Un remous m'amène au premier rang et, sans avoir rien fait pour cela, je me trouve hors des grilles, en bonne posture pour aller faire un tour en ville. Le sous-officier qui nous conduit se montre tout à fait complaisant. Les commerçants belges n'acceptant plus l'argent français qu'avec beaucoup de méfiance. Nous nous faisons d'abord conduire dans une banque où, avec bien des difficultés et à un taux de circonstance nous effectuons le change de nos billets français, après quoi c'est la ruée de boutiques en boutiques. Lorsque, au bout de 2 heures, nous regagnons le Collège Saint Augustin je suis tout heureux et tout fier de pouvoir sortir de ma musette devant les camarades impatients : quelques tranches de jambon, un pot de miel, une miche de pain, des cerises, quelques paires de chaussettes.
De temps en temps les Allemands prescrivent un rassemblement dans la cour. Ils s'efforcent de nous dénombrer, de nous classer par armes, par divisions. C'est peine perdue, les bâtiments sont si vastes et renferment tant de recoins cachés qu'un bon nombre d'entre nous échappent à ces investigations. Dès le 4 il y a des départs qui s'organisent. Y prennent part les plus valides et ceux qui désirent changer de décor, jusqu'à concurrence du nombre prévu. Il y a, en général, un autocar pour les estropiés et les officiers les plus âgés, les autres partent à pied. La prise d'assaut du véhicule ne Je cède en rien à celle de la soupe, ce n'est pas plus beau. C'est comme ça que Druet, qui conserve un souvenir douloureux de nos premières étapes, se glisse un jour dans un autocar en partance et nous fausse compagnie à l'improviste. Depuis ce moment là nous perdrons sa trace. Je suis toujours avec Tourgis, Renard, les adjudants François et Bazin.
La constitution des groupes de ravitaillement qui s'effectue par unités ou groupes d'unités, nous a rattachés aux troupes de forteresse. C'est à cette occasion que je prends contact avec deux chics camarades, Carlier et Contin, qui deviendront par la suite deux fidèles compagnons de camp, de stube, de popote, de misère quoi ! C'est leur départ, le 6, qui nous incite à les imiter pour ne pas nous séparer. D'ailleurs à quelques jours près, nous sommes tous appelés à quitter Enghein, à l'exception des adjudants qui ont peu de chance d'être admis dans un camp d'officiers.
Le 6 au matin nous figurons dans un groupe de départ de 200, 50 d'entre nous choisis par rang d'âge ou de grade ont droit à une place dans un autocar et je suis du nombre. L'autocar est bien suspendu, les coussins confortables, le temps est splendide, pour un peu et l'imagination aidant, on pourrait se croire en route pour une belle excursion en pays Wallon, où allons nous ? Personne ne semble le savoir d'une façon très précise, pas plus le conducteur qui suit les indications du sous-officier allemand, que ce dernier qui retourne sa carte en tous sens et qui paraît absolument désorienté. Au bout de deux heures nous avons roulé dans toutes les directions et passé trois fois de suite aux mêmes carrefours. Nous avons traversé, notamment Soignies et puis Mons, à un moment donné nous nous sommes même engagés sur la route Valenciennes. Comme nous n'en sommes pas à une heure ou à un crochet près et que nous commençons à avoir faim nous demandons à notre gardien de nous arrêter dans un patelin où il y ait quelques boutiques. Il accepte sans se faire prier. Un quart d'heure après notre autocar stoppe dans un gros bourg bien achalandé où nous trouvons du pain, de la charcuterie et même du vin. La nourriture de la journée est assurée et ce n'est pas peu de chose. Notre conducteur en profite pour se faire expliquer son itinéraire et lorsque nous repartons c'est pour filer tout droit, cette fois, vers Wavre. Arrivés à destination la voiture nous dépose le long de la façade d'un grand bâtiment de l'importance de celui que nous venons de quitter. C'est le séminaire de Basse Wavre à la belle et élégante façade de briques rouges dont tous les petits carreaux sont passés au bleu d'outremer.
Wavre 8-10 Juin
Notre nouveau gîte d'étape est assez plaisant. Ce n'est, en effet, selon toute vraisemblance, qu'une nouvelle étape vers le camp définitif. Devant la grande façade du séminaire une vaste pelouse hâtivement ceinturée de barbelés. De nombreux camarades nous ont déjà précédés et occupent la totalité du bâtiment depuis le rez-de-chaussée jusque y compris le grenier. Ici plus d'interminables dortoirs mais de petites cellules, de petites salles d'étude. Il y a longtemps que la literie a été réquisitionnée par les premiers venus et nous devons nous contenter d'une petite pièce au 2ième étage dont le mobilier se borne à une bibliothèque, une table, quelques chaises. Nous coucherons parterre, sur nos couvertures, à sept ou huit et nous n'en dormirons pas plus mal. Sur la pelouse, parallèlement à la façade, quelques cuisines de campagne ont été dressées, spectacle qui nous apporte un certain réconfort. Effectivement, deux fois par jour, des cuisiniers français improvisés nous prépareront une soupe consistante à laquelle la faim contribuera à donner une saveur toute particulière.
L'approvisionnement est encore à la charge de la Croix Rouge belge et des notables de la ville.
La surveillance est encore moins rigoureuse qu'à Enghein. Aux deux issues, celle par laquelle nous sommes arrivés et une autre qui débouche sur un sentier vers la campagne quelques sentinelles débonnaires assises sur des chaises, le fusil mitrailleur posé sur une table a portée de la main.
Une infirmerie a été aménagée au rez-de-chaussée et le service en est assuré par des sœurs et des infirmières de la Croix-Rouge belge qui viennent se relayer à tour de rôle. Chaque fois qu'elles arrivent au Séminaire elles sont assaillies par les prisonniers en quêtes de nouvelles ou désireux de leur confier des lettres et des commissions. Elles sont d'ailleurs d'une bonne volonté, d'une complaisance et d'un dévouement admirables. L'une d'elle, en particulier, une petite blonde, à l'air maladif et timide, les traits tirés par la fatigue, fait vingt fois par jour, peut-être la navette avec sa bicyclette, le produit de ses courses entassé sur le porte bagage de son guidon. Lorsqu'elle a pu se le procurer elle nous fait passer discrètement le communiqué français qu'elle accompagne de quelques paroles d'encouragement et de réconfort.
Nous allons passer dans ce décor trois journées aussi monotones et désœuvrées qu'à Enghein. Dans la bibliothèque de notre chambre il n'y a guère que des ouvrages religieux : exégèse en théologie. En fouillant plus à fond je découvre avec joie une Bible Crampon que je mets de côté pour remplacer celle que j'ai laissée dans ma musette. Au hasard je mets la main sur un ouvrage intitulé "L'irréprochable providence" et je vais m'étendre à l'ombre sur la pelouse grillée par le soleil. C'est une autre main que la mienne qui a dû me guider vers ce livre, tant il répond parfaitement à mes préoccupations de l'heure présente. C'est l'exhaussement sous la forme la plus inattendue de mes prières. Il prendra place dans ma musette, compagnon fidèle, à côté de ma bible.
La chaleur est toujours accablante. Un petit ruisseau légèrement encaissé, coule tout le long de la clôture de la propriété. Un certain nombre de camarades ont jeté des planches d'un bord à l'autre et, les pieds dans l'eau font la lessive. Je m'empresse d'en faire autant. Tout y passe et cependant que mon linge sèche sur les buissons voisins je me rince et me savonne à tour de bras. Le spectacle de tous ces corps nus à la peau claire mais où tranchent des têtes et des cous patines par le soleil qui s'ébrouent dans l'eau ou s'allongent, détendus, sur l'herbe des talus ne manque pas de pittoresque. Certaines nudités impudiques sont même allées s'étendre, au pied de la statue de la Vierge, au centre de la pelouse sous le grand soleil.
Le lendemain de notre arrivée je suis vautré dans l'herbe, près de l'entrée, à quelques pas de la sentinelle de garde. Une jeune femme élégante, distinguée, souliers de plage et robe claire à grands ramages débouche devant nous, saute de bicyclette et s'avance vers notre gardien et lui demande l'autorisation de s'entretenir avec son cousin, officier français prisonnier, elle nomme le Capitaine de R......, ici un des grands noms de l'armorial français. Notre gardien subjugué accepte et le nom de cet heureux mortel passe de bouche en bouche. Au bout de quelques minutes apparaît un grand diable roux, impossible, qui s'incline cérémonieusement pour un baise main très vieille France. Il a enfilé hâtivement sa vareuse à même la peau, ses jambes poilues émergent d'un caleçon court mais il a conservé son monocle. Le reste sèche au soleil je suppose. Nous nous écartons par discrétion. Heureux prisonnier !
Le 9, ordre de départ. Le séminaire doit être vidé de son contenu le lendemain matin. Les allemands nous annoncent une longue étape à pied. Pas de voitures. Seuls ceux qui seront reconnus incapables, par un major allemand, de faire l'étape, resteront ici.
Gembloux 10 juin
A 9 heures la colonne qui comprend quelques centaines d'officiers est formée dans le petit chemin de terre qui longe le jardin du Séminaire. L'encadrement, une douzaine de soldats sous la conduite d'un feldwebel est à pied d'œuvre. Chacun d'eux est muni d'une bicyclette, ce qui n'est pas bon signe. Notre feldwebel attend-il des ordres complémentaires ou, tout bonnement, comme dans l'armée française, le contrordre ? Toujours est-il que deux heures après nous sommes encore en place, assis mélancoliquement dans la poussière. Et pendant ce temps, le soleil monte et commence à se faire brutal. La colonne s'ébranle enfin et nous gagnons rapidement une grande route, du type de grandes routes nationales, et qui s'étend devant nous à perte de vue, désespérément droite, écœurante au possible.
A la première pause, après une heure et demie de marche, nous sommes déjà claqués, fourbus. La chaleur devient intolérable. Jamais le chargement ne nous avait paru plus lourd et les jambes molles. Nous nous précipitons sur les seaux d'eau que les habitants ont déposé à leur porte à l'arrivée de notre convoi. Certains veinards parviennent à attraper quelques tranches de pain. Nous repartons. La chaleur devient intolérable, le soleil, maintenant, tombe d'aplomb sur nos casques. Malgré les objurgations des sentinelles la marche ralentit, la colonne se traîne sur le macadam de la route que l'on sent mou sous la semelle. Déjà quelques officiers, à bout de forces, ont dû abandonner et sont restés sur le talus de la route sous la garde d'un allemand. Je me demande si je vais avoir la force de tenir jusqu'au bout de la pause. C'est à peine si j'arrive à mettre un pied devant l'autre, j'ai le souffle coupé. Comme les camarades qui m'entourent je marche comme un automate, la tête baissée, haletant. Je n'ai même plus la force de m'arrêter devant les seaux d'eau que les habitants posent au seuil des portes, à notre intention. J'ai le sentiment que si je ralentis seulement le rythme je n'aurais plus la force de repartir. Je suis devenu à ce point inconscient que la colonne s'arrête sans que je réalise parfaitement ce qui se passe. Un de nos camarades frappés d'insolation est allongé à l'ombre d'une maison ; deux médecins penchés sur lui l'ont déshabillé et s'efforcent de le rappeler à lui. Je me suis adossé à un mur, assis je n'aurais pas pu me relever, couché je me serais endormi.
A nouveau il nous faut repartir. Dès les premiers pas j'ai le sentiment que mes jambes n'obéissent plus. Mes yeux par instants s'obscurcissent. Instinctivement je me rapproche du terre plein gazonné de la route et soudain je m'écroule, évanoui. Ce n'est pas autre chose que de la faiblesse. Lorsque je reviens à moi une des sentinelles est penchée sur moi et me glisse entre les dents une pastille de menthe. Elle me demande alors si je suis en état de faire encore 200 mètres jusqu'à un carrefour où je pourrai monter dans un camion. Elle m'aide à me relever, charge sur sa bicyclette ma couverture et mes musettes et, tout doucement, nous atteignons le point fixé. Un quart d'heure après je suis juché en compagnie de quelques autres éclopés sur un camion de ravitaillement plein de fûts d'essence.
Nous filons alors rondement, nous dépassons la colonne que j'ai dû abandonner et nous ne tardons pas à atteindre Gembloux. C'est là que nos troupes et, notamment, la Division Marocaine avec laquelle nous sommes montés en Belgique a reçu le choc des troupes blindées allemandes. A Gembloux même et dans les alentours il y a eu de furieux combats. Certains quartiers de la petite ville que nous traversons ne sont qu'un amoncellement de ruines.
Deux heures après nous sommes tous rassemblés dans les écuries d'un haras, allongés côte à côte, sur une bonne épaisseur de paille. Nous avons tous des traits décomposés par la fatigue et la chaleur. La plupart se sont mis le torse nu et tordent leurs chemises, se sèchent, se frictionnent les uns les autres. Dès notre arrivée nous avons été ravitaillés : un quart de boule chacun et un morceau de concombre !
A huit heures, après avoir soufflé un peu, nouveau rassemblement. Nous repartons, en direction, cette fois, de la gare. Nous allons embarquer dans un train de marchandises à raison de 40 à 45 par wagon. L'installation est laborieuse. Pour ma part je suis assis dans un coin du "40 hommes - 8 chevaux" à côté du Commandant Vautrin. nous nous sommes mis d'accord, pour lutter contre la crampe et les courbatures, d'allonger nos jambes à tour de rôle, l'espace dont nous disposons ne nous permettant pas de le faire simultanément.
Voyage interminable, coupé d'arrêts prolongés en pleine campagne et qui ne prend fin que le lendemain matin à 8 heures.
Hasselt 11-14 Juin
Lorsque nous nous extirpons de notre wagon à bestiaux, moulus, fripés, courbaturés nous sommes sur le quai de la gare d'Hasselt et nous sommes toujours en Belgique.
Rassemblement prolongé devant la façade je la gare. Nous commençons à connaître la musique ; sans plus attendre nous jetons sacs et musettes à terre et nous nous installons sur le trottoir. Les bars et les cafés commencent à lever leurs rideaux de fer et à dresser leurs terrasses. Aussitôt c'est un rush général, devant nos gardiens impuissants, pour nous faire servir de la bière et des sandwiches. Je parviens à attraper au vol un demi et quelques tartines beurrées et lorsqu'au bout de deux heures au moins de stationnement nous nous mettons en route, la vie nous apparaît déjà plus souriante. Après un quart d'heure de marche dans les faubourgs d'Hasselt nous débouchons sur une grande place dans le fond de laquelle se dresse un bâtiment à l'aspect rébarbatif, qui commence à nous être familier. C'est une caserne de cavalerie.
Là encore nous retrouvons l'habituel rassemblement des prisonniers qui nous y ont précédés. Depuis le départ de Lille nous commençons à nous connaître un peu mieux, bien des figures nous sont maintenant familières, des groupes se sont constitués par affinités et sympathies et maintenant, lorsque nous arrivons quelque part, notre souci primordial est de ne pas être séparé des camarades du groupe, dès notre arrivée dans notre nouveau gîte nous parvenons à nous assurer une petite salle au rez-de-chaussée où il y a encore de la paille. Quant aux camarades qui nous y ont précédés leur premier soin est de nous signaler une salle de douches, installée à l'intérieur de la caserne, et qui fonctionne parfaitement. J'y bondis aussitôt pour m'assurer une place. Le soir, une soupe au riz nous est servie dans un réfectoire. Et, pour compléter le tout, une bonne nuit, reposante sans histoire, sur la paille moelleuse. Le lendemain matin nous sommes relativement reposés, le moral est meilleur.
A dix heures, ordre de départ qui survient à l'improviste. La caserne doit être vidée de tous ses occupants. Une fois de plus nous chargeons notre barda, refermons la colonne, entourés des mêmes compagnons de route et nous quittons la caserne. Il fait beau, la pluie qui est tombée la nuit précédente a rafraîchi la température ; nous sommes de taille, semble-t-il à faire une longue étape sans flancher.
Nous traversons les faubourgs de Hasselt et, aussitôt après par une passerelle de fortune lancée par les pionniers allemands, le fameux canal Albert. A quelques dizaines de mètres de là le pont normal que les Belges ont fait sauter et dont le tablier en fer, coupé en deux, est resté accroché aux puissants cubes de pierres. Quelle admirable défense antichar que ce large plan d'eau rectiligne à perte de vue. Comment imaginer que les troupes qui assuraient la défense de cette pièce maîtresse n'aient tenu que quelques heures !
Nous obliquons sur la droite et nous longeons ledit canal. Quelques maisons, dé-ci dé-là ont été touchées par des bombes d'avions, quelques toits sont éventrés, les alentours sont encore jonchés de tuiles, toutes les fenêtres sont béantes. La route que nous suivons longe, toute droite, le canal. Elle est bordée de part et d'autre d'arbres magnifiques : platanes, érables, sycomores. Les défenses avancées du canal entre celui-ci et la route sont intactes ; elles étaient, cependant, extrêmement puissantes et judicieusement aménagées. Les blocks en béton ne portent aucune trace de bombardement, pas la moindre égratignure, les réseaux de barbelés, comme la barrière antichars constituée par une armature d'énormes poutrelles et qui s'étend sur des kilomètres sans la moindre solution de continuité, sont absolument intacts. C'est dire si ce spectacle nous laisse rêveurs. Quel a donc pu être le rôle de l'armée belge sur ce point de la ligne ?
La marche se poursuit allègrement. Il semble que toutes traces des rudes fatigues des jours précédents aient disparu. On a placé en tête quelques types pleins d'entrain, qui marchent d'un pas régulier et bien rythmé. Pour la première fois quelques chansons de marche jaillissent spontanément, reprises en chœur par toute la colonne. Les sentinelles qui marchent sur notre flanc nous considèrent, légèrement étonnés. Devant moi la haute silhouette du père Dortais, en soutane et calot et qui entonne avec les camarades.
Au fur et à mesure que nous avançons nous voyons le paysage changer insensiblement. Le pays est maintenant parfaitement plat, verdoyant, marécageux par places. Nous sommes dans la province du Limbourg et le voisinage de la Hollande est déjà sensible, sensible dans le décor, l'architecture, sensible dans le parler des habitants. Au loin, seul accident de terrain sur cet horizon plat nous apercevons un crassier - réminiscence des paysages du nord du Borinage - nous devons donc approcher du petit bassin houiller du Limbourg qui s'amorce ici, et se prolonge en territoire hollandais.
Au bout d'une dizaine de kilomètres une auto nous dépasse et stoppe devant nous. Un officier allemand en descend pour donner l'ordre au sous-officier qui nous conduit de faire demi-tour. Aucune explication. Nous faisons la pause pendant dix minutes et repartons en direction de Hasselt. A mi-chemin un autocar nous rejoint et charge une partie de nos bagages. A quatre heures nous avons réintégré la caserne.
La garde y est plus importante et plus sévère que dans nos précédents casernements. Quelques délégués de la Croix-Rouge arrivent cependant à fléchir la consigne et à franchir le corps de garde. Certains acceptent les lettres que nous leur offrons et nous promettent de les acheminer vers leurs destinataires, dans toute la mesure du possible. Ici, il ne faut pas compter pouvoir sortir en ville pour se procurer quelques vivres. Nous avons chaque jour une soupe épaisse, une portion de boule et un morceau de saucisse ou de margarine, voire même de vrai beurre, mais c'est encore une bien maigre ration à côté de ce qu'exigent nos appétits exaspérés. Mais il y a toujours moyen de se tirer d'affaire. Des femmes et des enfants rôdent sans arrêt autour de la caserne aux fenêtres grillagées pour saisir une occasion de vendre quelques vivres, pain, chocolat, fruits. Dès que les sentinelles sont hors de vue les fenêtres s'entrouvrent et le ravitaillement s'effectue discrètement. Tournis que la faim travaille plus qu'aucun d'entre nous reste en position d'attente, des heures entières, derrière le portail de la caserne du côté des écuries, à l'opposé du poste de garde. Grâce à lui notre groupe parvient à corser un tant soit peu notre menu de prisonnier.
Les soirées dans notre petite chambrée lorsque nous sommes tous rassemblés et vautrés sur la paille ne manquent pas de gaîté. Nous avons recueilli un jeune dentiste du Nord, venu on ne sait d'où. Il a fait avec nous la dernière étape, vêtu d'un képi, d'un imperméable et de sandales de plage. Il est gros et gras, il a les cheveux blonds tout frisottants et le surnom de Silène, lancé par l'un d'entre nous, lui est resté. Il a la faconde de ce qu'on appelle les méridionaux du Nord. Il n'arrête pas, son répertoire est intarissable, il est étourdissant. Son plus grand succès, avant que la chambrée ne plonge dans le sommeil, c'est l'imitation des grands speakers de T.S.F. Lorsqu'il en arrive à Radio Toulouse c'est le fou rire, mais lorsqu'il achève sur Radio Stuttgart c'est l'étranglement.
Le 13, désœuvrement total. Nous restons sous pression dans l'attente d'un départ définitif, cette fois, mais qui n'intervient pas et c'est heureux car il pleut sans arrêt.
Le 14, au matin, rassemblement. La colonne se reconstitue sur la grande place face à la caserne. Le temps est beau et moins chaud, la pluie a cessé. Nous stationnons un bon moment au bord du trottoir. Il est 9 heures. C'est l'heure où la circulation commence à devenir active et où les ménagères rentrent du marché. Beaucoup de civils s'approchent de nous, prudemment d'abord et de plus en plus librement. Nous sollicitons des nouvelles des encouragements. La sympathie se lit sur presque tous les visages. Les hommes nous distribuent des cigarettes et du tabac sur lesquels certains d'entre nous se jettent avec plus d'avidité encore que sur le pain. Une brave femme devant moi sort de son filet les fruits qu'elle vient d'acheter et nous les partage. Que les deux ou trois fraises que j'ai mangées ce matin m'ont semblé bonnes! Une brave vieille nous entretient de son fils, mobilisé dans l'armée belge et dont elle vient d'apprendre la mort.
Les gardiens qui doivent nous encadrer sont maintenant en place. Nous nous mettons en route. Même itinéraire que l'avant-veille jusqu'au canal Albert. Nous passons à nouveau sur le pont provisoire mais au lieu de tourner à droite nous filons droit devant nous. La route que nous suivons est, comme la précédente confortable, bien ombragée, accueillante. Dé-ci dé-là des villas riantes, propres, confortables aux façades sobres et de bon goût, comme on en trouve peu dans notre banlieue parisienne. C'est le règne de la brique, mais de la belle brique dont les hollandais, tout proches savent user avec un art raffiné. Sur les toits de magnifiques tuiles vernissées bleu foncé ou vert bronze.
Nous avançons entre deux files de champs de seigle à peine jaunissant, parsemés de bleuets. Il y a des harmonies de bleus et de verts qui sont une joie pour l'œil. Par instant le ciel se couvre et le vent s'élève, un vent qui semble chargé de tous les parfums du large. Ce que la vie serait belle, sur cette route inconnue, le chapeau d'éclaireur sur le crâne, le bâton à la main et trente années de moins sur les épaules. Hélas, toute la gaîté qui se dégage de nous tous est bien artificielle, elle est un peu forcée ; nous sommes tous tenaillés par l'inquiétude où nous sommes, de tant d'êtres chers et quant à cette route accueillante elle nous mène tout droit, sans hésitation possible, vers la captivité.
Les habitants, au passage, sortent de leurs maisons et nous distribuent largement leur pain, déjà rationné depuis quelques jours, de l'eau, des œufs. Beaucoup d'entre eux, déjà, ne parlent plus le français. Seuls quelques flamands nous regardent d'un air narquois. Une institutrice a retenu ses gosses qui sortent de l'école pour nous regarder défiler ; ils ouvrent de grands yeux, se parlent à l'oreille ou désignent du doigt l'un d'entre nous.
A midi arrêt le long de prairies légèrement en contrebas de la route et où l'herbe fraîchement fauchée, est encore rassemblée en petites meules. A cet instant même un camion nous rejoint. Il est chargé de marmites norvégiennes pleines d'une ratatouille aux pommes de terre bien chaude. La distribution effectuée nous nous installons dans la prairie, la gamelle entre les jambes pour savourer ce repas inattendu ; nous ne sommes guère habitués à de telles attentions.
La marche reprend, il nous reste encore une quinzaine de km, à faire, paraît-il, nous en avons laissé une vingtaine derrière nous. Le pays que nous traversons est toujours plat, mais verdoyant et varié. Beaucoup moins de champs de seigle, mais des prairies qui alternent avec des bois, quelques fermes, des villages plaisants, d'une netteté nordique, quelques villas très modernes de lignes, une église entièrement construite en briques, d'une sobriété et d'une pureté de lignes absolument admirables. Un peu plus loin nous longeons les crassiers et la mine que nous avions entrevus de loin, deux jours auparavant.
Nous commençons à sentir le poids des kilomètres dans les jambes, mais l'entrain ne faiblit pas et il y a fort peu de traînards. Nous approchons du but qui est le grand camp de Beverlo, quelque chose comme notre camp de Châlons ou de Mailly. Au carrefour que nous venons d'atteindre un petit café est ouvert. Quelques camarades, aux premiers rangs de la colonne s'y sont glissés et nous invitent bruyamment à les imiter. La brave patronne a déclaré qu'elle servirait tout le monde, seuls paieront ceux d'entre nous qui possèdent encore de la monnaie belge. En un clin d'œil le café est plein à craquer, tout autour c'est la ruée pour attraper les verres que l'on se passe de main en main. Nos sentinelles ont dû s'arrêter et contemplent ce spectacle d'un œil placide. Quelques camarades, pour faciliter la distribution se sont partagés les rôles, l'un est installé à la tireuse, d'autres lavent les verres et font la navette, un dernier ramasse la monnaie. Je ne sais ce qui fait le plus de bien, ou du demi bien frais que nous savourons, ou de la générosité spontanée et touchante de cette brave flamande.
Encore une heure et demi de marche et nous arrivons au village du territoire duquel dépend le camp de Beverlo. Là encore les habitants se pressent sur notre passage et beaucoup sont venus les mains pleines : tartines de pain, œufs, tabac. Une jeune fille toute émue, toute rougissante, quitte sa mère pour venir jusqu'à nous et me glisse dans les mains quelques tablettes de chocolat, puis se sauve bien vite sans attendre le moindre remerciement.
Beverlo 14-24 Juin
Le camp de Beverlo, à première vue ne se différencie guère d'un camp de manœuvres français. Même alignement de petits bâtiments sans étages, d'écuries, de hangars entourant des boqueteaux et des landes. Toutefois l'accueil qui nous y est fait est tout à fait dénué d'aménité. Nous devons défiler devant deux haies d'Allemands le fusil à la main et plusieurs sous-officiers, le pistolet au poing nous mènent tout droit devant une rangée d'écuries où, en un clin d'oeil nous sommes répartis et cadenassés. Au bout d'une demi-heure la porte s'entrebâille et nous sortons un par un pour défiler avec nos bagages devant un officier installé en plein air, devant une table. Tout ce que nous possédons doit être étalé devant lui, tout jusqu'au contenu de nos poches et de notre portefeuille. Quand cette visite minutieuse est terminée je suis allégé de mon casque, de mon masque, de mon ceinturon baudrier, de ma boussole, de tout le papier à lettre et papier blanc que contenait encore mon porte-cartes. J'ai pu sauver les lettres personnelles et les photos qui avaient échappé au désastre. De tout cela, ce que je regrette le plus c'est mon ceinturon: il me facilitait le port de mes bagages et... il avait fait toute l'autre guerre, c'était un vieux compagnon de misère, un glorieux compagnon.
Après cela nous sommes répartis par 8 ou 12 dans de petites chambrées qui servaient au logement des sous-officiers belges. Nous y sommes à notre aise : lits en fer, paillasses, tables et bancs. C'est presque le confort. Nous n'occupons qu'une toute petite enclave entourée de barrières en barbelés dans ce camp qui s'étend sur 25 ou 35 kilomètres en tous sens. Nous occupons toute une rangée de petits bâtiments parallèles. Il y a aussi des prisonniers de troupe qui, eux, sont entassés sur la paille, dans de vastes écuries. Le soir tombé nos gardiens viennent fermer les portes de nos chambres et toute la nuit nous entendons les grosses bottes de la sentinelle qui martèlent le ciment devant nos portes.
Il y a dans le camp tout le matériel nécessaire pour faire la cuisine. Ce sont des cuisiniers français qui en sont chargés et qui s'en tirent fort bien. Cette fois, à défaut de la quantité la qualité y est. Deux fois par jour nous faisons la queue un par un, la gamelle à la main pour toucher un rata avec un soupçon de viande, un morceau de boule, un morceau de graisse ou de margarine.
Le lendemain nous assistons au départ des soldats belges qui avaient été capturés dans le camp au moment de l'avance allemande et qui, nous le supposons, vont être libérés. Aussitôt, nous nous ruons dans leurs chambrées pour récupérer ce qui y traîne encore, linge, vivres, bouquins ; nous en sommes immédiatement chassés par un sous- officier écumant qui, pour nous impressionner, tire en l'air quelques coups de revolver. Nous sortons en toute hâte par une porte, mais pour rentrer aussitôt par une autre et nos gardiens en verront bien d'autres !
Rapidement la vie s'organise. Les chambres ont été soigneusement nettoyées, aménagées ; c'est presque le confort. Nos farouches gardiens eux-mêmes s'apprivoisent, la discipline se relâche peu à peu. L'officier allemand qui commande la petite garnison vient nous faire de temps à autre de petits laïus. C'est lui qui vient nous annoncer, la figure épanouie, la prise de Paris ce que nous nous refusons à admettre. La propagande déploie ses efforts ; les alsaciens sont mis à part, pour bénéficier d'un régime de faveur, les juifs sont recensés.
Notre emploi du temps tient en peu de mots. Nuits prolongées béatement jusqu'à une heure avancée de la matinée, sieste sur le maigre gazon qui borde nos baraques - il faut doser ses forces à la mesure des aliments que nous absorbons - bridge en plein air, lecture, flânerie le long des barbelés.
Cette vie de farniente nous semble bonne. Le décor est plaisant, infiniment plus que ceux que nous avons connus jusqu'à ce jour, il fait un temps splendide, nous nous sommes familiarisés avec nos compagnons de misère et le moral est meilleur. D'ailleurs nous vivons tous dans l'illusion que la guerre est finie pour nous, que la paix va être signée, que notre retour en France est proche. Les Allemands que nous côtoyons en sont aussi persuadés que nous. L'officier chargé de la propagande nous réunit un jour pour nous annoncer solennellement que dans 18 jours -18 jours très exactement - les troupes du Reich auront débarqué en Angleterre. Nous entretenons en tous cas l'espoir que cette étape est pour nous la dernière et que nous ne quitterons pas la Belgique.
C'est ainsi que s'écoulent, sans bruit, sans incidents la période du 14 au 24. Nous ne sommes cependant pas au terme de nos tribulations. Le 13 au soir nous sommes avisés d'avoir à nous tenir prêts à partir le lendemain matin, pour une très courte étape, quelques kilomètres, pas plus.
Beverlo - Dortmundt 24-25 Juin
Une fois de plus nous avons rassemblé notre barda. La colonne, le 24 au matin est prête au départ. Nos gardiens, si rébarbatifs dix jours plus tôt, nous regardent partir souriants. Leur officier pousse l'amabilité jusqu'à nous souhaiter un prompt et heureux retour dans nos foyers. Et, le plus drôle, c'est qu'il était sincère j'en suis convaincu.
Quelle est notre destination ? Nous l'ignorons tous et les Allemands aussi à voir leurs hésitations sur la route à prendre. Pour commencer nous longeons les limites du camp, puis nous coupons à travers le champ de tir d'artillerie d'où émergent les buts silhouettes et les guérites de ciment des guetteurs. Un officier en auto rattrape la colonne et donne au sous-officier qui nous précède des ordres. Il s'ensuit un changement de direction. Nous avons nettement l'impression dé tourner autour du camp comme si nous allions, une fois de plus, revenir à notre point de départ. Il est cependant question d'un embarquement en chemin de fer. Nous traversons successivement quelques villages et l'accueil y est toujours aussi chaleureux. A remarquer que les hommes sont beaucoup plus réservés que les femmes, ceux-ci obéissent passivement aux ordres des sentinelles, les femmes au contraire font la sourde oreille, se glissent dans les rangs, esquivent les bourrades et les coups de crosse pour nous glisser des vivres ou du tabac. Certaines, qui n'ont pas eu le temps de donner tout ce qu'elles avaient, rejoignent la colonne en bicyclette pour achever leur distribution.
D'heure en heure les kilomètres s'allongent et nous en avons bien fait une vingtaine lorsque, au début de l'après-midi, nous venons échouer à la gare d'Ellesteren, une toute petite gare en pleine campagne où nous attend un train mixte attelé d'une locomotive en cuivre jaune, d'un modèle antique que l'on croirait échappé du Musée des Arts et Métiers. Nous essayons de circonvenir le mécanicien, un hollandais, mais lui-même ignore notre destination.
Vers 16 h notre train démarre et nous roulons plein est. Il n'y a plus d'illusion à se faire, dans quelques heures nous serons en terre allemande. Très rapidement nous pénétrons en Hollande, nous allons écorner la province du Luxembourg hollandais. Le paysage défile devant nous. Grosse impression de richesse et de confort, maisons d'une netteté, d'une propreté surprenante. La plus modeste d'entre elles, semble déceler un standard de vie dont nous n'avons aucune idée chez nous.
A 18 heures nous approchons d'une ville et nous longeons une usine impressionnante, une sorte d'immense verrière que surmonte un nom universellement connu et propagé par la publicité "Philipps". Nous sommes à Verlo. Le train ralentit le long d'un quai où les uniformes des policiers hollandais alternent avec ceux des officiers allemands. Un groupe de jeunes allemands en civil, porteurs d'un brassard à croix gammée, nous toisent avec une arrogance que nous n'avons jamais connue chez les vrais combattants. Les infirmières de la Croix-Rouge hollandaise s'affairent autour de nos compartiments et nous promettent que, dans un 1/4 d'heure, nous aurons une soupe chaude. Effectivement, à l'heure dite elles passent de compartiment en compartiment pour nous servir une soupe appétissante où nagent du céleri et des rondelles de carotte, mais qui dégage aussi, hélas, un goût de trop peu. Nous aimerions remercier ces charmantes infirmières mais aucune ne parle français sauf une que nous entourons aussitôt. Elle a vécu longtemps en France. Nous parlons avec émotion des heures qu'elle a vécues à Paris et à Nice, nous encourage, nous réconforte.
Le train repart, la nuit tombée. Nous approchons de la frontière allemande. Déjà nous traversons une région, de tourbières où se trouvaient les lignes de défenses ; fossés antichars, blockhaus et que les Allemands ont dû traverser sans coup férir. Bercés par le roulement du train nous finissons par nous endormir, dans la nuit un bruit assourdissant et métallique nous tire de notre torpeur. Nous mettons le nez à la fenêtre. Nous traversons un fleuve et à sa largeur nous en concluons que ce ne peut être que le Rhin.
A quatre heures du matin le train ralentit. Tout autour de nous des trains de marchandises, à perte de vue des voies, des aiguillages. Le train stoppe. Nous sommes dans une gare de triage dont l'importance dénote la proximité d'une grande ville. Le jour se lève, un jour blafard qui perce à travers des nuées d'orage. Nous commençons à percevoir la silhouette de maisons de rapport, sur les pignons de quelques-unes d'entre elles de grands panneaux de publicité. Nous sommes maintenant renseignés. C'est à Dortmundt que nous sommes venus échouer, Dortmundt la grosse cité industrielle et minière de la Rurh, le gros bastion de la résistance, au temps de notre occupation en 1919.
Dortmund 25-28 Juin
Un service d'ordre impressionnant nous guette à la descente du train. Immédiatement en route. Nous quittons la gare. La ville est encore endormie, les premiers trams commencent à circuler. Nous traversons un quartier cossu. Belles avenues macadamisées, bordées de beaux arbres, habitations particulières de grande allure construites dans le plus pur style allemand. Nous gagnons des faubourgs pour aboutir devant un parc d'où émerge une grande rotonde vitrée, c'est un vélodrome qui nous semble déjà plein à craquer de prisonniers. Nous contournons le vélodrome et nous avons alors la vision de ce qu'est un véritable camp de prisonniers avec des enclos de barbelés ses tours de surveillance, ses baraques, le tout strictement compartimenté, surveillé. Nous sommes dirigés sur un enclos vide de façon sans doute à ce que nous ne puissions communiquer avec les autres camarades qui nous ont précédés ici, et que nous voyons déambuler lamentablement dans les enclos voisins. Nous sommes répartis aussitôt dans de grandes tentes qui peuvent abriter une bonne cinquantaine d'hommes. Entre-temps l'orage s'est déchaîné et la pluie tombe à pleins seaux. Après quelques heures d'attente il nous faut à nouveau défiler pour la fouille, une fouille aussi stricte, aussi sévère que celle de Beverlo. Cette fois je suis soulagé d'un sifflet, de ma lampe électrique. D'autres camarades au hasard des censeurs auxquels ils ont eu affaire ont dû abandonner qui son couteau, qui son briquet, qui son stylo.
Nous allons passer dans ce camp, qui n'est qu'un camp de triage, quatre journées infiniment pénibles. Aucune vexation ne nous est épargnée par nos gardiens. Quelle différence avec l'attitude des vrais combattants, de ceux qui ont couru les mêmes dangers que nous. C'est humain et j'imagine que n'importe quel prisonnier allemand a dû faire, en France, les mêmes constatations. Nous ne sommes exempts d'aucune corvée qu'il nous faut exécuter sous la surveillance d'un sous-officier armé. Impossibilité d'échanger le moindre mot au travers des barbelés avec les camarades du block voisin, sans être menacé d'un coup de fusil. Nous couchons à 40 dans une pièce absolument nue, sur un plancher recouvert d'une impalpable poussière de charbon. De l'autre côté du grillage les officiers couchent sous la tente et dans celle qui abrite les officiers supérieurs l'autorité du camp a fait alterner, pour le couchage, un officier et un sénégalais.
Deux fois par jour, à heure fixe c'est le défilé, en colonne par un, la gamelle à la main pour toucher une portion de boule et un morceau de graisse ou une soupe, le tout servi par des cuisiniers polonais hirsutes et d'une saleté repoussante. La soupe, quatre jours durant, sera identique à elle-même, elle ne comporte que des pommes de terre non épluchées et non lavées et de laquelle il se dégage une odeur nauséabonde qui, à elle seule, nous soulève le cœur. Les plus affamés ferment les yeux, en mastiquent consciencieusement quelques cuillerées et courent bien vite la cracher à grands coups de haut-le-cœur.
Une impression atroce est aussi celle qui se dégage de ce camp à la lisière de la ville. Au loin nous apercevons la silhouette des maisons, des usines, la flèche d'un clocher. A travers une éclaircie dans les arbres, un tram passe avec son chargement de civils, des cyclistes vont et viennent. Plus près encore c'est une rue ombragée bordée de paisibles villas, un homme en sort qui part pour son travail, une ménagère rentre avec son filet à provisions, un couple passe, tendrement enlacé, des enfants se poursuivent à grands cris. C'est ce décor qu'il faut pour réaliser pleinement sa condition de prisonnier.
Le lendemain de notre arrivée, les cloches sonnent à toute volée. Nous saurons plus tard quelle date historique elles célèbrent.
Dans le camp nous voisinons avec des officiers belges, hollandais, des aviateurs anglais. Chaque jour un convoi se forme pour embarquer. C'est à qui en fera partie tant notre hâte, à tous, est grande de quitter ce triste lieu pour un camp définitif où nous pourrons nous installer, faire connaître notre adresse, recevoir des nouvelles.
Le 28 dans l'après midi notre tour est venu. Nous nous trouvons rassemblés à nouveau sur le même quai qui nous a vu débarquer quelques jours plus tôt. Nous sommes casés à 7 dans un compartiment de 3ème classe, la plupart de nos autres camarades ont retrouvé le classique wagon de marchandises. A cinq heures nous démarrons. A nouveau, le problème se pose. Quelle direction allons-nous prendre ? Pour nous repérer nous allons avoir la position du soleil ou des étoiles, le nom des grandes gares traversées et petit atlas de poche grand comme un mouchoir de poche.
Nous roulons plein est. Nous passons Hanovre, Marienbourg. Le lendemain matin le soleil se lève sur les plaines monotones et déshéritées du Brandebourg. Sans doute allons- nous rejoindre Berlin. Effectivement nous approchons de la capitale. Voici déjà les méandres de la Spree avec ses installations de sport, de bains, ses petits voiliers, et déjà la banlieue avec ses petits jardins ouvriers, propres, bien entretenus où pas la moindre parcelle n'est laissée à l'abandon. Tout près maintenant émergent la masse impressionnante des usines, la silhouette des grands immeubles de rapport. Nous avons l'impression de contourner Berlin par une ligne de ceinture, nous traversons successivement quelques gares connues de la capitale, nous longeons le champ d'aviation de Tempelhof. Le train ralentit pour s'immobiliser enfin sur une voie de garage. Nous allons y rester une bonne partie de l'après-midi.
A nos pieds, sur le ballast, une centaine de jeunes pilotes attendent les wagons qui leurs sont destinés et qui vont être accrochés à notre train. Ils vont à Konigsberg, en Prusse Orientale. C'est pour nous, une indication sérieuse, nous ne sommes, pas encore au terme de notre voyage. Tous ces aviateurs sont jeunes, 20 à 21 ans au plus. C'est une belle jeunesse, saine, sure d'elle-même, une élite, sans aucun doute et dans les rangs de laquelle la guerre n'a pas fini de faire de sombres brèches, hélas !
De notre compartiment nous apercevons un carrefour. La circulation y est intense, les trains se succèdent sans arrêt ainsi que les autobus à 2 étages, tous les immeubles sont pavoisés à chaque fenêtre un drapeau à croix gammée, des oriflammes le long des mâts, c'est une forêt de toiles rouges et noires qui claquent au vent. Berlin fête sa victoire et son couronnement, l'armistice avec la France.
Tout près de nous des rames électriques se croisent aussi rapidement que les rames de notre métro, ce sont des trains de banlieue qui rappellent ceux de la gare St Lazare, et qui passent bondés de voyageurs. Là aussi la vie se poursuit, ardente, exubérante et rend plus sensible l'amertume de notre condition.
A la fin de l'après-midi, après de multiples manœuvres dans l'enchevêtrement des voies de garage notre train s'ébranle. La nuit vient. De temps à autre un camarade met le nez à la portière et cherche des yeux la grande Ours ; nous marchons toujours plein est.
6 heures du matin. Le train a stoppé. Les dormeurs s'éveillent un à un et les têtes surgissent à la portière. Nous sommes en gare. Sur un panneau au-dessus de nos têtes je lis "Schneidemùhl". C'est un nom qui ne m'est pas méconnu, je cherche au fond de ma mémoire et finalement je renoue le fil. Nous sommes à la frontière de l'ancien couloir de Dantzig et je suis passé là, dans cette même gare en allant en Lituanie.
Malgré l'heure matinale, il y a déjà de l'animation sur les quais. C'est Dimanche et début de vacances. Des voyageurs endimanchés, des permissionnaires, des campeurs aux jambes nues, des colonies de vacances prennent les trains d'assaut. Deux heures de stationnement. Manœuvres, changement de locomotive. Le train repart. Nous regardons, anxieux, cette fois-ci, nous roulons nord-ouest en direction de la Baltique. Paysage de plus en plus pauvre mais qui n'est pas sans attraits, landes sablonneuses, forêts de pins, de bouleaux, marécages, petits lacs, gares minuscules, rustiques, fleuries. L'air est vif, d'un peu plus, l'imagination aidant nous reconnaîtrions la brise marine.
10 h le train ralentit et s'arrête. Nous semblons être en pleine campagne et cependant nous sommes invités à descendre. Notre voyage prend fin. C'est une halte, et derrière un bouquet d'arbres apparaissent des alignements de baraques, des tours de surveillance, des barrières de barbelés. C'est notre camp.
Deux cents mètres à parcourir et notre colonne se présente à l'entrée. Devant nous une grande pelouse entourée de rosiers en fleurs, au fond la façade d'un grand bâtiment en bois, à larges baies, sans étages. Tout alentour la campagne déserte, la lande, le sable, les pins. Quel soulagement de toucher au but. J'ai le sentiment que les plus mauvais jours ont pris fin, que là, nous allons connaître, la détente, l'apaisement. Une vie nouvelle commence.
La barrière blanche et rouge, telle une barrière de passage à niveau s'élève pour nous laisser entrer. Je me retourne pour la voir retomber. Ça y est, l'aventure a pris fin.
Nous sommes le 30 Juin.